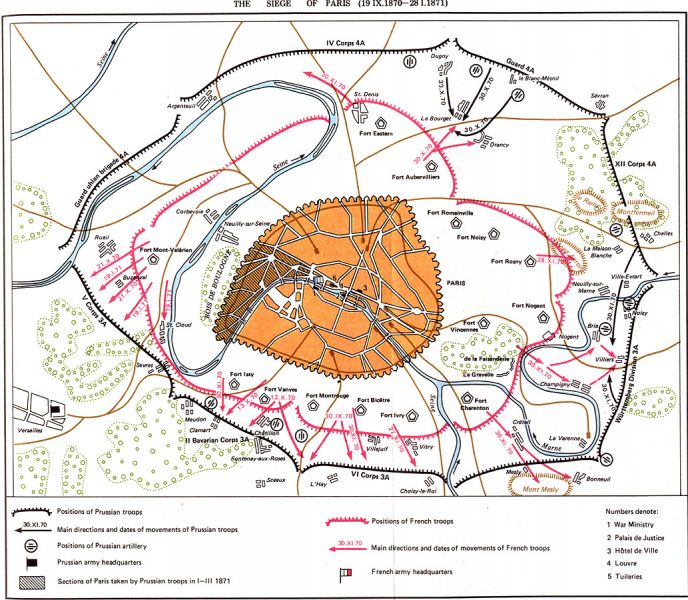
Presentation
POUR REPRENDRE L’HISTOIRE
Cette étude sur la Commune de Paris s’inscrit dans un travail plus vaste sur le mouvement ouvrier en France entrepris par notre Parti, à la suite de ce qui avait été fait dans les années soixante. Se réapproprier notre propre histoire, celle de notre classe, est une nécessité vitale pour les objectifs que nous nous fixons, la révolution communiste et l’instauration de la dictature du prolétariat, aboutissement logique du long parcours tourmenté de l’humanité. La restauration de la doctrine passe par l’étude du mouvement prolétarien, de ses défaites comme de ses victoires, afin d’en tirer tous les enseignements possibles profitables pour la reprise du mouvement de classe sur ces bases saines. Ce travail se fait conjointement à la vaste recherche sur l’Histoire de la Gauche Communiste dans ces années 20 si cruciales, travail et continuité que nous sommes, ici aussi, seuls à poursuivre sereinement.
Nous avons voulu décrire les principaux évènements de juillet 1870 à mai 1871, les forces en présence, les erreurs commises, les insuffisances objectives, les leçons à en tirer, en nous gardant de tomber dans le culte larmoyant du souvenir des martyrs qui n’a qu’un seul but: gommer tout enseignement utile pour la reprise future du mouvement prolétarien.
Une bibliographie succincte peut servir de référence, à la fin du texte.
Le texte comprend deux parties, que nous résumons brièvement ici (un sommaire détaillé se trouve à la fin de l’opuscule).
Le mouvement ouvrier, dans la décennie 1860, connaissait une renaissance, tant sur le plan politique que syndical, si bien que l’on arriva à une situation révolutionnaire dès 1858. Cela précipita le gouvernement de Napoléon III, non soutenu par la bourgeoisie, dans la guerre contre la Prusse – dans le but immédiat d’empêcher la réunification de ce pays.
La première partie, de la guerre à la révolution (de juillet 1870 au 18 mars 1871), explique le désastre militaire du Second Empire, régime qui s’écroule... sans que le prolétariat sache saisir l’occasion de prendre le pouvoir. Il impose cependant à la bourgeoisie la République le 4 septembre, et s’organise dans des Comités de quartier et un Comité Central.
Le 30 septembre, le prolétariat laisse de nouveau passer une grande occasion; la capitulation, le 2 janvier 1871, discrédite encore plus la bourgeoisie qui demande à Bismarck d’occuper Paris. Il refuse.
Élus par les “ruraux”, l’Assemblée nationale et Thiers à sa tête concluent hâtivement une paix payée très chère à Bismarck, puis prennent de suite différentes mesures contre Paris.
La nuit du 17 au 18 mars est marquée par la tentative avortée de reprise des canons de la Garde nationale: les troupes fraternisent avec le prolétariat. Thiers, paniqué, s’enfuit à Versailles.
La deuxième partie traite à proprement parler de la Commune de Paris, du 18 mars au 28 mai 1871.
Vraie république universelle, la Commune se comporte comme le seul gouvernement légal de la France: on peut parler de première de dictature du prolétariat. Avec 10 000 employés (au lieu de 60 000 auparavant), la Commune administre Paris: elle est un vrai “gouvernement à bon marché”. En son sein, toutes les organisations du prolétariat reprennent vie.
Malheureusement, le prolétariat n’a guère l’initiative. C’est la bourgeoisie qui revient rapidement à l’offensive, attisant la guerre civile que les communards n’osent prendre à bras le corps, restant sur des positions défensives. La seule sortie en direction de Versailles est un désastre.
En mai, le rapport des forces bascule en faveur de Versailles, grâce aux prisonniers libérés par Bismarck. Dès le 21, les Versaillais entrent à Paris, du fait d’une trahison, et Thiers donne l’ordre du massacre général. Si les communards se battent héroïquement, ils sont une fois de plus victimes de l’absence de stratégie militaire, ou plutôt de la pire possible, celle proclamée par Delescluze: le combat quartier par quartier.
Du 21 au 28 mai, la semaine sanglante: 30 000 Parisiens tués, 45 000 arrêtés, dont beaucoup sont fusillés. Au total, avec les morts et les déportés, Paris perd 100 000 de ses fils, parmi lesquels beaucoup de femmes et d’enfants.
Le texte passe ensuite en revue l’attitude de Marx et d’Engels, et de l’A.I.T. face aux évènements français, et tire les deux enseignements cardinaux de la Commune de Paris. La Commune marque la fin du socialisme utopique, le début de l’ère du socialisme scientifique; elle sanctionne l’échec du marxisme en France: il faudra une bonne dizaine d’années à Guesde et Lafargue pour tirer les leçons de la Commune et fonder le Parti Ouvrier Français, en 1882, premier parti prolétarien indépendant français.
Le premier enseignement: si 1848 avait montré la nécessité de la prise du pouvoir politique, la Commune démontre autre chose de plus : on ne peut utiliser ce pouvoir, cet État bourgeois. «Toutes les révolutions politiques n’ont fait que perfectionner cette machine au lieu de la briser» (Marx); la destruction de l’État bourgeois, «déduction essentielle dans la doctrine marxiste de l’État» (Lénine), qui passe par l’instauration de la dictature du prolétariat, est un des points centraux du programme communiste que nous revendiquons à 100%. Non pas parce que nous tenons à être des “puristes” distingués, mais parce que le marxisme est une construction que l’on doit accepter ou rejeter en bloc: on ne peut accepter “l’originalité” du matérialisme historique et mettre de côté la théorie marxiste de l’État ou de la violence sans trahir effrontément le communisme.
L’ex-Institut Maurice Thorez (l’élite créatrice de nos nationaux communistes), “célébrait” à sa façon le centenaire de la Commune, en organisant un colloque le 6-7-8 mai 1971 à Paris. Sur la question de l’État, une seule “contribution”, celle de... Guy Mollet, cette vieille carne social-démocrate qui a sur les mains le sang des mineurs du Nord (il créa les Compagnies Républicaines de Sécurité pour intervenir contre eux en 1947) et de milliers de prolétaires de l’ex-Indochine et d’Algérie (son gouvernement vota, tous partis confondus, les crédits aux militaires en 1954). Nos staliniens, au plus profond de leur nullité doctrinale, ont écouté les insanités (qu’ils défendent les premiers!)... débitées par un “socialiste” tant honni. il est vrai que dans le reniement et la falsification des principes communistes, ces charognes se valent bien.
Le deuxième enseignement: 1871 marque un changement d’époque historique, du moins pour l’aire européenne. Il n’y a plus de guerres bourgeoises progressives, mais que des guerres impérialistes, auxquelles le prolétariat ne doit pas donner son appui. 1871 termine l’époque, pour toute l’Europe occidentale, des doubles révolutions et des guerres nationales progressives. «L’année 1871 constitue un tournant historique évident. La lutte contre Napoléon III et sa dictature est déjà clairement dirigée contre une forme capitaliste et non féodale; elle est à la fois le produit et la preuve d’une concentration antagonique des forces de classe de la société moderne, et bien qu’il voit en Napoléon III un obstacle militaire au développement historique bourgeois et moderne de l’Allemagne, le marxisme se place immédiatement sur le front de la lutte exclusivement prolétarienne, contre la bourgeoisie française, de tous les partis de la Commune, première dictature des travailleurs (...) La réponse à la seconde [vague de l’opportunisme] était cette autre formule tactique: aucune alliance (depuis 1871) avec l’État et sa bourgeoisie» (“Thèses caractéristiques du Parti”, Florence,1951).
A partir de 1871, avec l’écrasement de la Commune, «toutes les armées bourgeoises européennes sont alliées contre le prolétariat» (Marx). Les pays continentaux de l’Europe occidentale ont alors rejoint la situation de l’Angleterre: la révolution bourgeoise est accomplie, l’unité nationale a été réalisée partout, seule la révolution prolétarienne est à l’ordre du jour.
Que de mensonges déversés sur l’oeuvre de la Commune!
Toujours pour le centenaire, l ’opportunisme, habile et rôdé dans les commémorations destructives, avait apposé d’immenses panneaux contre le mur des fédérés, avec inscrit: «La lutte pour la démocratie et le socialisme, c’est la Commune toujours vivante»...
C’est bien là le trait fondamental de l’opportunisme: laminer le mouvement prolétarien en occultant ou en déformant ses points forts. Détruire le marxisme en “l’enrichissant”! Opposons ce simple passage de notre “Dialogue avec les morts” (1957): «Nous en savons déjà long sur cet “enrichissement”: passage démocratique du pouvoir aux “communistes” ; impérialisme sans guerre; renonciation à l’usage de la violence; discipline constitutionnelle; imitation du capitalisme considéré comme une fabrique de bien-être; compétition honnête avec lui; promesse signée de ne pas le rouler, faite aujourd’hui à Londres, demain à Washington. Enrichissez encore un tout petit peu le marxisme de cette façon-là (...) et vous l’aurez mis complètement en pièces!» (p.101).
Oui, la Commune est bien tout l’inverse de cela!
Elle couche noir sur blanc l’importance vitale de la question militaire, la haine de la bourgeoisie qui, elle, est conséquente – elle est capable des pires massacres pour voir son pouvoir maintenu, comme toute classe dominante – la question cruciale du parti centralisé et indépendant, véritable état-major sans lequel aucune victoire n’est possible face à une classe et à un État hyper-centralisé et armé, parti et dictature du parti qui ont cruellement manqué.
Pour la bourgeoisie, tous les moyens sont bons. Écoutons “L’Officiel de Versailles” donnant ses ordres: «Afin que comme au 18 mars l’armée ne levât pas la crosse en l’air, on gorgea les soldats d’alcool mêlé, suivant l’ancienne recette, avec de la poudre...» (in Louise Michel, “La Commune”, Stock 1978, p.303).
Le même procédé sera utilisé lors de la première guerre mondiale en France, et l’est couramment à travers le monde de notre jours.
Jusqu’où pouvait aller la HAINE DE CLASSE de la bourgeoisie? «Mais tout étant plein de morts, l’odeur de cette immense sépulture attirait sur la ville morte l’essaim horrible des mouches des charniers, les vainqueurs craignant la peste suspendirent les exécutions» (op.cit. p.326). Les procédés modernes lèvent ces barrières sanitaires, seuls freins (et encore!) à la curée de la bourgeoisie menacée.
Le texte mis en Archives est “Dictature prolétarienne et parti de classe”, paru dans “Battaglia Comunista” n.3,4,5 de 1951. (Ce texte avait déjà été publié en français dans notre revue d’alors, “Programme Communiste” n°23, 1963). Il reformule la question de l’État et explique le rôle central du parti, rôle qui ira non pas en diminuant mais en prenant une importance toujours plus cruciale au fur et à mesure du développement des forces productives et des antagonismes de classe.
Le parti est nécessaire AVANT la révolution prolétarienne: il a pour tâche l’élaboration et la diffusion de la théorie communiste. Il assure la continuité de l’organisation prolétarienne et prépare l’offensive pour la conquête du pouvoir.
Le parti est nécessaire PENDANT la révolution prolétarienne: il la dirige consciemment afin d’en assurer la victoire; le choix se résume simplement, sans ambiguïté: ou destruction de l’État bourgeois ou écrasement de la révolution.
Le parti est nécessaire APRÈS la révolution prolétarienne, dans la phase de construction du socialisme, dans la défense du nouvel État prolétarien érigé sur les ruines de l’ancien contre tout signe de revanche de la part des classes maintenant dominées, et ce par tous les moyens. Cet État prolétarien sera une dictature ouverte de classe dirigée par le Parti Communiste, et, comme la Commune de Paris, balaiera la distinction législatif-exécutif qui est le propre des régimes bourgeois. L’abolition progressive des classes amènera la disparition de l’organe de domination de la classe ouvrière, l’État prolétarien.
A la dictature de la bourgeoisie DOIT répondre la dictature du prolétariat ; à la violence bourgeoise DOIT répondre la violence prolétarienne, organisée et visant la plus grande efficacité dans l’intérêt du prolétariat, du communisme.
Le parti est présent partout dans ce processus tourmenté: sur le plan théorique, syndical, politique, militaire...; il n’est lié à aucun code, si ce n’est celui de la guerre de classe: que le plus fort et le mieux préparé gagne, et malheur aux vaincus!
Démocratie et Liberté: ce sont ces deux poisons que l’opportunisme insufflait hier à la classe ouvrière, ce sont les mêmes qu’il distille jour et nuit au prolétariat aujourd’hui; c’est contre ces “cris menteurs” que s’élève le texte d’Archives, constituant le fil conducteur du travail sur la Commune dont nous recommandons la lecture attentive à nos lecteurs.
Cet opuscule se termine par la rubrique initiée dans les précédents
numéros, Vie du Parti, résumant nos dernières réunions générales
(septembre 1984 et février 1985).
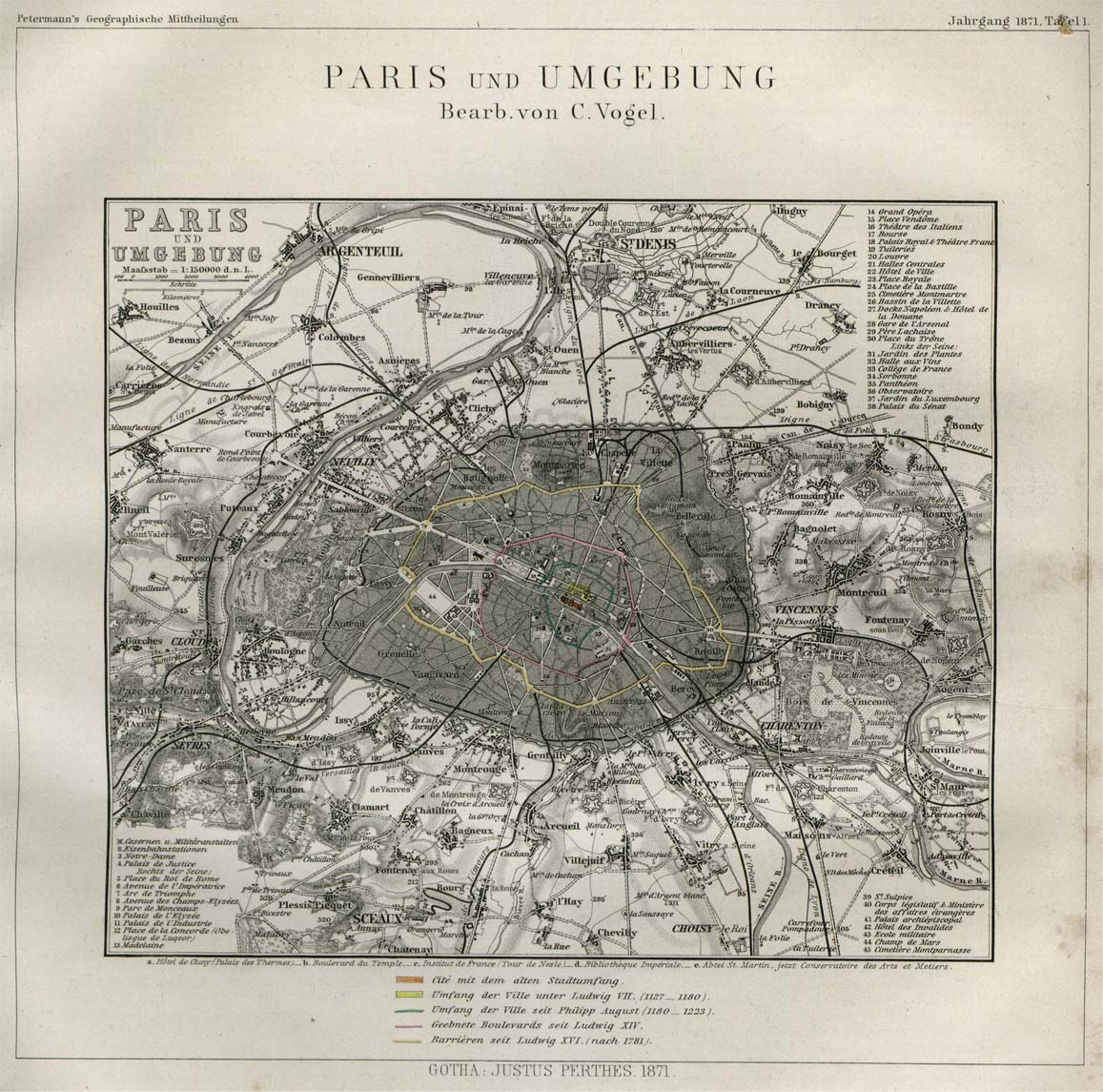
Ancienne carte allemande
montrant
la position des forts
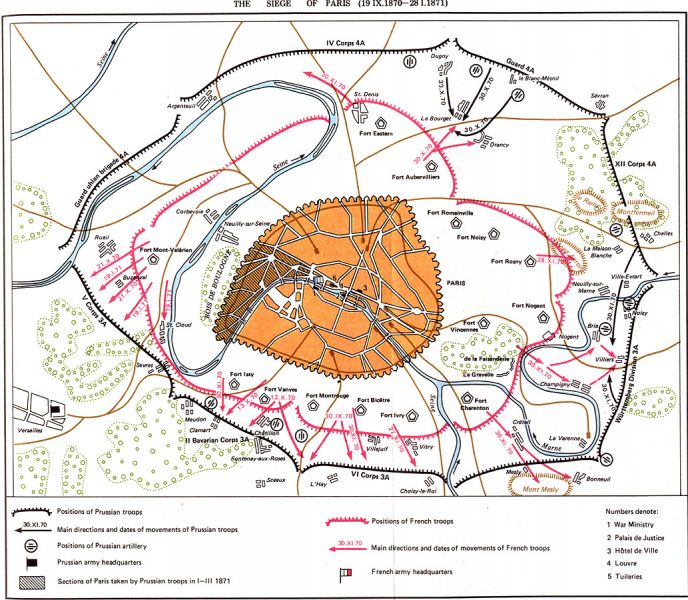
1. LA GUERRE DYNASTIQUE
De la déclaration de guerre du 19 juillet 1870 à
la capitulation du 23 janvier 1871
a. Les circonstances et les
causes
Le heurt des impérialismes gaulois et teutons avec la montée des luttes sociales
L’impérialisme napoléonien lorgnait depuis longtemps la rive gauche allemande du Rhin et flattait en cela le chauvinisme d’une bonne partie de la population française. La guerre austro-prussienne de 1866 excita la hargne du petit coq bonapartiste; en effet, en échange de sa neutralité dans le conflit, Bismarck avait promis à Napoléon III des compensations territoriales qu’il n’obtint en fait jamais. Dans son introduction de 1891 à “La guerre civile en France”, Engels écrit: «Mais le second Empire, c’était l’appel au chauvinisme français, c’était la revendication des frontières du premier Empire, perdues en 1814, ou tout au moins de celles de la première République (...) Mais il n’était pas de conquête qui fascinât autant l’imagination des chauvins français que celle de la rive gauche allemande du Rhin (...) Une fois le second Empire un fait acquis, la revendication de la rive gauche du Rhin, en bloc ou en morceaux, n’était qu’une question de temps. Le temps en vint avec la guerre austro-prussienne de 1866; frustré des “compensations territoriales” qu’il attendait par Bismarck et par sa propre politique de tergiversations, il ne resta plus alors à Bonaparte que la guerre qui éclata en 1870 et le fit échouer à Sedan et de là à Wilhemshoehe».
La guerre de 1870 s’annonçait donc dès 1866, comme le souligne Engels (“Rôle de la violence dans l’histoire. Rôle de la violence et de l’économie dans l’instauration du nouvel empire allemand“, dans les “Écrits Militaires”, p.566: «Que la paix avec l’Autriche (août 1866) portât dans son sein la guerre avec la France, cela Bismarck non seulement le savait, mais il le voulait. En effet, cette guerre devait fournir le moyen de parfaire cet Empire prusso-allemand que la bourgeoisie lui prescrivait de réaliser».
Napoléon III et Bismarck voulaient donc tous les deux la guerre
Le premier pour redorer son blason, régler ses problèmes intérieurs et briser la menace prolétarienne qui connaissait un paroxysme en raison de la crise économique 1. Le second pour sceller l’unité nationale allemande sous l’égide de la Prusse, par une guerre commune aux États du Sud et du Nord, et donc réaliser l’unité d’en haut en se passant des classes prolétarienne et bourgeoise contrairement au modèle français. L’Allemagne n’était alors qu’une fédération d’États indépendants divisés en États du Nord et du Sud (Bavière, Wurtemberg, grand duché de Bade, etc...). Les États du Nord étaient au nombre de 16 et réunis depuis 1866 en une confédération présidée par le roi de Prusse. Les deux États du Nord, la Prusse et le Hesse, les plus riches des États allemands, connaissaient aussi une crise industrielle avec des troubles sociaux.
Le prétexte sera fourni par la question de la succession au trône d’Espagne pour lequel la Prusse avait proposé la candidature du prince de Hohenzollern. La France s’y opposa violemment en raison du risque de voir se créer un axe Berlin-Madrid, et demanda impérativement le retrait de cette candidature provocatrice. Le roi Guillaume de Prusse, en villégiature dans la ville d’eaux d’Elms, envoya un télégramme le 13 juillet où il confirmait officiellement à la France le retrait de cette candidature 2. Bismarck intercepta cette “dépêche d’Elms”, la travestit de façon à laisser croire que le roi de Prusse avait congédié l’ambassadeur de France, et la publia dans la Gazette de Cologne. Cette manoeuvre était destinée “à produire sur le taureau gaulois l’effet d’un chiffon rouge”, et conduisit le gouvernement français à déclarer la guerre à la Prusse le 19 juillet 1870.
Qui a donc permis à Louis Bonaparte de faire la guerre à
l’Allemagne?
Et Marx de répondre: LA PRUSSE! (Marx, “La guerre civile...”, 1ère
Adresse du Conseil général, E.S., p.279-80): «N’oublions pas que
ce sont les gouvernants et les classes dominantes de l’Europe qui ont
permis
à Louis Bonaparte de jouer pendant dix huit ans la farce féroce de
l’Empire
restauré (...) C’est Bismarck qui a conspiré avec ce même Louis
Bonaparte,
afin d’écraser l’opposition populaire à l’intérieur et d’annexer
l’Allemagne
à la dynastie des Hohenzollern [ guerre de 1866] (...) Le régime
bonapartiste,
qui jusqu’alors n’avait fleuri que sur une rive du Rhin, avait
maintenant
sa réplique sur l’autre (...) avec son despotisme effectif et son
démocratisme
de carton, ses trompe-l’oeil politiques et ses tripotages financiers,
sa
phraséologie ronflante et ses vils tours de passe-passe».
L’armée prussienne était préparée moralement et techniquement. Elle était dirigée depuis 1857 par un militaire excellent, Helmut Von Moltke, qui fit de cette armée un corps moderne. Elle avait l’expérience des combats européens avec la guerre victorieuse contre l’Autriche en 1866 et avait déjà mis au points des plans de préparation méthodique de la guerre contre la France avec des plans de mobilisation et de transport de troupes. Elle comptait 462 000 hommes, 57 000 cavaliers, 80 000 chevaux . Six lignes de chemins de fer étaient aménagées entre le Rhin et la Moselle pour le transport des troupes. Elle avait ainsi deux atouts majeurs : un déplacement rapide des troupes, et une puissance de feu avec une artillerie lourde et des canons qui portaient plus loin que ceux français.
En effet la France n’était pas prête!! Les officiers français n’avaient pas d’expérience de guerre européenne et de plus souffraient d’autosuffisance. Rien ne fut sérieusement préparé. Les troupes françaises partirent ainsi pour l’Allemagne sans cartes de l’Alsace et de la Lorraine ce qui les fit s’égarer de nombreuses fois! Les chemins de fer français étaient développés mais non organisés militairement. L’armée avait moins de soldats que ceux de l’armée prussienne (à laquelle devaient s’ajouter ceux des autres États), une cavalerie plus importante mais qui s’avéra inutile, une artillerie lourde médiocre; seul le fusil chassepot était techniquement supérieur à celui de l’ennemi!
Comme Engels l’écrira en 1887 (“Écrits Militaires”, L’Herne, p.5), Louis Napoléon fut pris de court: «Non seulement, il voyait qu’il était tombé dans un piège, mais encore il savait qu’il y allait de son empire. En effet, il n’avait guère confiance en la bande de vauriens bonapartistes qui lui assurait que tout était prêt jusqu’au dernier bouton de guêtre, et pas confiance du tout en leurs talents militaires et administratifs. Mais les conséquences logiques de son propre passé le poussèrent à sa perte (...) En revanche Bismarck était fin prêt pour la guerre, et, de plus, il avait, cette fois, vraiment derrière lui le peuple qui, à travers tous les mensonges diplomatiques des deux filous,ne voyait qu’une chose: c’est une guerre non seulement pour le Rhin, mais encore pour l’existence nationale (...) Dans cet élan national, on vit disparaître toutes les différences de classe».
La bourgeoisie française fut elle-aussi très surprise par l’annonce de la guerre pour laquelle elle eut tout d’abord une attitude de refus. Toujours dans la première Adresse (“La guerre civile...”, p.278), Marx explique: «Le complot guerrier de juillet 1870 n’est qu’une édition corrigée du coup d’État de décembre 1851. A première vue, la chose parut si absurde que la France ne voulait pas la prendre réellement au sérieux (...) Quand le 15 juillet, la guerre fut enfin officiellement annoncée au Corps législatif, l’opposition entière refusa de voter les crédits provisoires; même Thiers la flétrit comme “détestable”; tous les journaux indépendants de Paris la condamnèrent, et, chose curieuse, la presse de province se joignit à eux presque unanimement». Les crédits de guerre furent donc votés.
Le maréchal Bazaine était nommé le 12 aôut en pleine guerre
commandant
en chef de l’armée du Rhin qui représentait l’ensemble des forces
armées françaises; il avait servi en Algérie, en Crimée et au Mexique.
Le Maréchal Patrice de
Une guerre de défense du côté allemand
Le conflit prend donc l’aspect d’une guerre de défense de
l’Allemagne
contre l’agression française; il exprime l’impérialisme français qui
veut empêcher l’unité allemande et annexer la rive gauche du Rhin.
L’empereur
Guillaume 1er affirmera hypocritement dans son discours du trône qu’il
s’agit d’une guerre contre Napoléon III, non d’une guerre contre le
peuple
français, d’une guerre défensive et non d’une guerre offensive!! Et les
États allemands répondirent à l’appel de la “patrie” allemande.
Bismarck avait gagné!
b. Attitude des mouvements ouvriers
Dès 1866, la menace de la guerre pesait sur l’Europe. En juillet 1866, le bureau parisien de l’Association Internationale des Travailleurs (AIT) conseille la neutralité aux ouvriers. Un appel est lancé par les ouvriers de Berlin en faveur de la paix, auquel le bureau parisien de l’AIT avec Varlin, Tolain, Fribourg, répond par un manifeste qui réclame l’abolition des armées permanentes et l’organisation de milices nationales.
Puis vient le scandale de l’affaire du journaliste républicain Victor Noir. Le prince Pierre Bonaparte, cousin de l’empereur, tue le 10 janvier 1870 le journaliste venu organiser un duel entre le prince et le rédacteur en chef du journal anti bonapartiste “La Marseillaise”. 100 000 personnes participent le 12 janvier à ses funérailles à Neuilly sur seine 4. Parmi la foule se trouvent Eugène Varlin, Louise Michel, Jean Baptiste Millière. Une agitation anti napoléonienne commence. Charles Delescluze, rédacteur en chef du journal républicain “Le réveil” et les partisans de l’Internationale appellent au calme. Pierre Bonaparte sera acquitté en mars.
Le 12 juillet 1870, les membres parisiens de l’AIT publient un autre manifeste “Aux travailleurs de tous les pays”, suivi de nombreuses adresses d’autres organisations adhérant complètement à la protestation du bureau parisien contre la guerre. Les menaces de guerre donnent lieu également à des manifestations ouvrières, comme le souligne Marx dans la Première adresse du 23 juillet 1870, in “La guerre civile...”, p.279: «Les vrais ouvriers des faubourgs répondirent par des manifestations en faveur de la paix si écrasantes que Piétri, le préfet de police, jugea bon de mettre fin sur-le-champs à toute politique de rue...».
Marx, dans le même texte, rappelle les réactions des ouvriers allemands. Ceux-ci ont répondu à l’appel de la paix des ouvriers français. En principe, la classe ouvrière allemande s’opposait à la guerre du fait que Bismarck voulait consolider la prédominance de la Prusse en Allemagne et faire l’unité allemande non par le bas avec l’appui populaire, mais par le haut ; en pratique, elle n’avait pas la force de s’y opposer et elle acceptait la guerre comme un mal nécessaire et inévitable. «Avec un profond regret et avec douleur, nous nous voyons contraints de nous soumettre à une guerre de défense comme à un malheur inévitable». C’est ce qu’exprima un meeting ouvrier de masse, tenu à Brunswick le 16 juillet 1870. A Chemnitz, un meeting de délégués représentant 50 000 ouvriers saxons, adoptait à l’unanimité la résolution suivante: «Nous déclarons que la guerre actuelle est exclusivement dynastique... Nous sommes heureux de saisir la main fraternelle que nous tendent les ouvriers de France».
Mais en France, la guerre qui va mobiliser les ouvriers, augmenter
la
misère et le chômage, va aussi entraîner l’effondrement des
organisations
ouvrières qui s’étaient extraordinairement développées dans les années
précédentes, c’est-à-dire l’AIT et les sociétés ouvrières. La
déclaration
de guerre de juillet 1870 par le gouvernement bonapartiste sera le
premier
coup porté à ce mouvement ouvrier qui croît vigoureusement; le deuxième
coup que la bourgeoisie internationale voudra fatal, sera avec la
Commune
de Paris et d’autres villes de France, d’écraser sauvagement et
définitivement
– du moins le crût-elle – son mortel ennemi.
c. La débâcle militaire
française
Retraite de Bazaine à Metz le 16 août et
capitulation
à Sedan de Napoléon III le 2 septembre
«Le glas du second Empire a déjà sonné. L’Empire finira comme il a commencé, par une parodie». Telle était la sentence de Marx dans la Première Adresse du 23-7-1870. La société française, après 18 ans de “bas-Empire” (comme disait Engels) était minée par la corruption, l’incurie du système bonapartiste; elle ne peut faire face honorablement au conflit et l’Empire s’écroule comme un “château de cartes” (Engels, Introduction à “La guerre civile...”, 1891).
De juillet 1870 à février 1871, Engels suivit de très près les évènements et produisit ainsi une soixantaine d’articles militaires sur la guerre franco-prussienne. En 1887, il écrit:
«Les troupes de Louis Napoléon furent défaites à chaque combat
et les ¾ de son armée finirent en captivité allemande. Ce n’était pas
la faute des soldats qui s’étaient bravement battus, mais bien celle
des
chefs et de l’administration. Mais Louis Napoléon n’avait-il pas édifié
son Empire avec l’aide d’une bande de canailles et ne l’avait-il pas
maintenu
pendant 18 ans en livrant la France à l’exploitation? N’avait-il pas
cédé
tous les postes décisifs de l’État aux membres de sa bande, et les
postes
subalternes à leurs acolytes? Il est clair que, dans ces conditions, il
ne pouvait engager de lutte à la vie et à la mort sans risquer de se
voir abandonner par tout ce beau monde.
«Il ne fallut pas cinq semaines pour que s’écroulât tout l’édifice
impérial, si longtemps admiré par les philistins d’Europe. La
révolution
du 4 septembre ne fit qu’en balayer les débris, et Bismarck qui était
entré en guerre pour fonder l’Empire de la Petite-Allemagne, se trouva
un beau matin le fondateur de la République française» (“Écrits
Militaires”, 1887-88; L’Herne, p.572).
Et Marx écrira à Engels le 8 août 1870: «Tout à fait dans le même esprit de bas Empire, cette guerre, son intendance et sa diplomatie s’effectuent suivant la formule: s’escroquer et se mentir mutuellement» (“La Commune”, p.54).
Ainsi, dès le 4 août, les troupes de l’Empire connaissent leurs premières défaites 5. L’armée impériale, lancée dans une stratégie offensive (envahir le territoire ennemi à travers le pays de Bade et couper l’Allemagne du nord de celle du sud) se voit contrainte à la défensive parce que les Prussiens l’ont prise de vitesse en envahissant eux-mêmes les deux régions frontalières: l’Alsace défendue par le général Mac Mahon, et la Lorraine défendue par les généraux Frossart et Bazaine.
Le Maréchal de France Patrice de Mac Mahon, comte de Mac Mahon, monarchiste convaincu, commandant le premier corps de l’armée du Rhin depuis le 17 juillet 1870, va accumuler les erreurs en Alsace.
En effet, les troupes bavaroises avec des troupes prussiennes, soit 60 000 hommes, arrivent en Alsace du Nord, à Wissembourg dominée par une citadelle militaire. C’est le point de départ réel de la guerre. Le général Douay et ses troupes (8000 hommes) y ont été envoyés, en raison des approvisionnements qui s’y trouvent, pour organiser des brigades de boulanger de façon à alimenter l’armée. La cavalerie partie en reconnaissance ne décèle pas la présence des troupes ennemies!! L’attaque est donc une surprise. La petite ville de Wissembourg est bombardée. Les attaques bavaroises sont repoussées héroïquement, mais l’aide des troupes prussiennes décide le général Douay à la retraite. Il sera tué par un éclat d’obus. Le chef de bataillon, Liaud, décide de rester pour défendre la petite ville de Bitche avec sa citadelle. Le siège par des troupes bavaroises durera jusqu’à la fin de la guerre; malgré les bombardements de la ville et les pertes, la citadelle ne voudra pas se rendre!
L’armée d’Alsace se retire avec de graves pertes sur Chalons-sur-Marne: 2300 tués du côté français contre 1551 du côté allemand. Le maréchal Mac Mahon est contraint de battre en retraite pour livrer des combats autour de Woerth-Froeschwiller. C’est là la désastreuse bataille de Reichshoffen du 6 août où pour couvrir sa retraite, Mac Mahon sacrifiera les tirailleurs algériens au nombre de 1700 dont 800 furent massacrés par la mitraille ennemie. Cette bataille reste également marquante par une série de charges meurtrières et inutiles des cuirassiers français face aux canons allemands.
Les erreurs commises du côté français se répéteront tout au cours de la guerre. Alors que les chefs prussiens marchent au canon, les Français restent l’arme au pied. L’artillerie est numériquement inférieure et la portée des canons français est également inférieure à celle allemande. Tout le poids de la bataille repose sur l’infanterie qui sera exemplaire, courageuse comme les tirailleurs algériens, mais qui ne peut vaincre une armée supérieure en nombre et mieux équipée en canons. Les combats seront une suite de carnages, massacres et les visions d’horreur hanteront longtemps les soldats des deux camps!
Le gros de l’armée du Rhin dirigée par le Maréchal de France Bazaine opère en Lorraine. Le 16 août, à l’étonnement général, il décide de replier son armée de 180 000 hommes à Metz, se laissant ainsi couper de la France libre. La forteresse de Metz est aussitôt investie par les Prussiens et commence ainsi un siège qui se terminera le 27 octobre par la capitulation de Bazaine!
Le 9 août, le ministère Ollivier tombe. L’impératrice Eugénie, régente, le remplace par un cabinet de défense dynastique dirigé par le comte de Palikao, général. Le 23, Eugénie et Palikao obligent l’armée de Châlons menée par Napoléon et Mac Mahon à marcher vers celle de Bazaine, encerclée à Metz. C’est ainsi un série d’ordres et de contre ordres pour les soldats qui tournent ainsi en rond... Renseignés par les journaux, le chef d’état major prussien envoie des troupes en direction de Chalons au devant des troupes françaises qui indécises vont errer jusqu’à Sedan.
Cette triste épopée se clôt avec les combats désastreux le 31 août et le 1er septembre de Beaumont et autour de Sedan, sur la route de Metz. Les troupes françaises comptent environ 120 000 hommes et 564 canons commandés par le général Mac Mahon (blessé, il sera remplacé par le général Auguste Alexandre Ducrot). Dans l’autre, on compte 200 000 soldats (Prusse et Bavière) commandés par Von Moltke avec 774 canons. Le roi Guillaume de Prusse et Bismarck assisteront aux combats du haut d’une colline La bataille fait 28 000 morts et blessés français, contre 3000 tués et 6000 blessés allemands. Encerclée et complètement désorganisée, l’armée française reflue en désordre à l’intérieur de la ville citadelle de Sedan. C’est un flot épouvanté d’hommes, de chevaux, de chariots, de canons se mêlant, s’écrasant, et le tout sous les bombes. Face à cette débâcle, Napoléon III donne l’ordre de hisser le drapeau blanc pour demander un armistice le 1 er septembre. Bismarck exige une capitulation sans condition et refuse que Napoléon III rencontre le roi Guillaume pour négocier. Le 2 septembre, Napoléon III est conduit au château de Bellevue qui domine la Meuse et la ville de Sedan pour signer avec les généraux en chef des deux camps et les deux souverains l’acte de reddition. Cet acte précise que la place forte ainsi qu’armes, munitions, matériels, chevaux et drapeaux seront remis aux vainqueurs et que l’armée prisonnière sera conduite sur la presqu’île d’Iges à l’ouest de Sedan. 550 officiers qui donnent leur parole de ne plus combattre les Allemands durant la durée de la guerre sont libérés sur le champ et pourront ainsi aller renforcer les rangs des réactionnaires! 6000 chevaux et 419 canons sont livrés. L’empereur et une partie de ses officiers seront détenus dans une prison dorée, au château de Wilhemshöhe en Hesse. Le maréchal Mac Mahon sera détenu à Wiesbaden et libéré en mars 1871! 83 000 soldats et officiers se retrouveront dans un camp à ciel ouvert au bord de la Meuse sur la presqu’île d’Iges, parqués sans abris et sans vivres. Beaucoup mourront de faim ou de maladies. Le camp sera évacué progressivement en Allemagne et restera un paysage de désolation!
Le 2 septembre jour de la capitulation française deviendra une fête nationale de l’Empire allemand jusqu’en 1918.
La chute de Napoléon aurait dû mettre un terme à la guerre, puisque
Bismarck et Guillaume 1er avaient proclamé que la guerre était dirigée
contre Bonaparte et non contre le peuple français, mais il n’en fut
rien...
Les armées prussiennes et leurs alliés déferlent sur le nord de la
France
pour mettre le siège devant Paris.
2. LES CONSÉQUENCES DE LA
DÉBÂCLE
a. La République est
proclamée
le 4 septembre 1870!
La révolution du 4 septembre 1870: Sauver la patrie en danger
Début août, des manifestations populaires contre l’Empire et ses premières défaites militaires avaient éclaté à Paris. Le 14 août, Blanqui 6 et ses amis avaient même tenté de dresser Paris contre Napoléon III en tentant un coup de force mais leur tentative de s’emparer des armes à la caserne des pompiers du boulevard de la Villette échoua. A l’annonce de la défaite de Sedan, où Napoléon fut fait prisonnier, Palikao s’enfuit en Belgique! La révolution du 4 septembre éclatait à Paris.
Après l’écroulement de l’Empire, le terrain de la lutte des classes se trouve ainsi déblayé du bonapartisme dont la fonction était précisément d’empêcher depuis 1851 le heurt entre la bourgeoisie et le prolétariat. A Paris, le 4 septembre, c’est la révolution: le peuple de Paris, avec à sa tête les internationalistes, les socialistes proudhoniens et surtout les blanquistes, s’insurge, et, renversant les barrages des gardes nationaux placés devant l’Assemblée du Corps législatif, pénètre dans la salle où le blanquiste Granger intime l’ordre aux députés de décréter la chute de l’Empire et la proclamation de la République. C’est la répétition de la scène de février 1848 au cours de laquelle la Seconde République fut imposée par Raspail à la tête du peuple armé. Gambetta, malgré l’opposition du corps législatif et sous la pression des parisiens annonce la déchéance de l’empereur. Un peu plus tard à l’Hôtel de Ville, avec Jules Favre et Jules Ferry et d’autres députés républicains, il proclame la République. Un gouvernement de défense nationale est instauré, composé de 11 députés de Paris. Malgré le désastre de Sedan et alors que l’armée de Bazaine est enfermée à Metz, le gouvernement refuse la défaite et décide de reconstituer une armée.
Ce gouvernement comprenait des républicains modérés (Jules Ferry, Jules Favre, Léon Gambetta, Ernest Picard), le député d’extrême gauche Henri Rochefort, Jules Simon, et avait le général Trochu, gouverneur militaire de la ville, comme président. Adolphe Thiers (1797-1877), un des chefs historiques de la droite orléaniste, refusa de participer à ce gouvernement.
Gambetta est ministre de la Guerre et de l’Intérieur. Le général et comte breton, de Kératry, est nommé préfet de police; il démissionnera rapidement, quittera Paris en ballon pour prendre la tête de l’armée de Bretagne (triste épisode du camp de Conlie près du Mans! 7) à la demande de Gambetta, parti lui aussi en octobre pour organiser des armées en province, et surtout pour s’opposer à tout mouvement révolutionnaire. Les proclamations officielles de Trochu et de Favre vont dans le sens d’une résistance à outrance contre l’envahisseur, mais Trochu, bien conscient que le plus grand ennemi reste le prolétariat parisien, fait entrer dans Paris l’armée de 40 000 hommes de Vinoy! Le gouvernement ayant choisi de rester à Paris, une délégation sera envoyée à Tours pour coordonner l’action en province sous les ordres d’Adolphe Crémieux, ministre de la Justice. Le 15 septembre, Adolphe Thiers est mandaté et envoyé en mission auprès des capitales européennes pour rechercher des appuis contre la Prusse.
Comme en 1830 et 1848, la province suit; Lyon a même précédé Paris
en proclamant la République avec quelques heures d’avance!
Les républicains modérés se méfient de la classe ouvrière
Si le prolétariat de 48, aveuglé par des illusions de fraternité , se laissa dépouiller du pouvoir qui pourtant lui revenait, il n’en fut pas exactement de même pour celui de 1870: il remit bien le pouvoir aux mandataires en place,mais parce qu’il ne pouvait pas faire autrement, comme nous l’explique Marx dans le premier chapitre de “La guerre civile...”. L’ennemi était aux portes, les armées impériales étaient ou enfermées sans recours dans Metz ou prisonnières en Allemagne; les véritables dirigeants de la classe ouvrière se trouvaient encore dans les prisons bonapartistes. Dans cette extrémité, le peuple permit aux députés parisiens de l’ancien corps législatif de se constituer en “gouvernement de la défense nationale”; il le permit à la condition expresse que cette prise de pouvoir ne serait exercée qu’aux seules fins de défense nationale; et il le permit d’autant plus volontiers, afin d’assurer la défense durant le siège de Paris, que tous les parisiens en état de porter les armes entrèrent dans la Garde nationale 8 de sorte que les ouvriers en constituaient maintenant la grande majorité.
Mais Thiers et ses amis veulent la paix au plus vite par peur de
la révolution!
Le 18 septembre 1870, les armées allemandes en provenance de Sedan, qui n’avaient pas rencontré de résistance, se trouvaient devant Paris et le menaçaient de siège. Les jours suivants, elles dispersaient les troupes françaises sur le haut plateau de Chatillon, encerclant également la ville par le sud où elle était moins défendue par les 16 forts distribués sur un périmètre de 53 Kms. L’encerclement de Paris et des forts et redoutes extérieurs est donc terminé. Les armées allemandes se tiennent à distance dans un rayon de 10 à 20 km et s’étirent en un long cordon d’une centaine de kms. Mais cet encerclement ne dépasse pas 300 hommes au km ce qui rendrait possible d’en briser l’étau 9. Le commandement allemand avec Bismarck et l’empereur Guillaume s’est installé à Versailles le 19 septembre. Au début, il dispose de 672 canons, 150 000 hommes (Prussiens, Saxons, Badois, Wurtemburgeois, Bavarois), mais ce chiffre progresse au fur et à mesure de la libération des troupes de siège (Metz, Toul, Strasbourg) pour atteindre 400 000 hommes. L’acheminement de l’artillerie lourde ne commence que fin novembre, une fois contrôlés les axes ferroviaires. Une administration allemande des territoires occupés se met en place entre mi-septembre et mi-octobre avec trois zones d’occupation (Lorraine, Champagne, Nord et Ile de France) Côté français, Paris compte 80 000 soldats de l’armée de ligne, 14 000 marins, 20 000 corps spéciaux (train, gendarmerie, douaniers...) La garde nationale mobile essentiellement levée dans les départements, comprend 100 000 hommes mal encadrés et peu exercés. La garde nationale sédentaire s’élèvera jusqu’à 300 000 hommes parisiens hâtivement armés et sans discipline. Ainsi Paris se prépare à la lutte avec 540 000 fusils dont 200 000 chassepots – le meilleur fusil du temps – 2600 canons; 230 autres pièces seront fabriquées durant le siège. 500 000 hommes sont mobilisés dans Paris et pour ses défenses extérieurs, forts et redoutes, contre au début 180 000 soldats allemands. Trochu va laisser ces forces dans l’inaction, ou bien organiser des opérations désastreuses. Et au lieu de regrouper les troupes, il maintient trois formations: l’armée active, les mobiles et les civils armées, c’est-à-dire la Garde nationale, sédentaire qu’il laisse sans instruction militaire 10. Quelques groupes de francs tireurs 11 ou “partisans” interviennent en avant de la ligne des forts. D’autres groupes de francs tireurs feront des actions de guérillas (sabotages de voies ferrées, de tunnels et de ponts) aidés par la résistance populaire des zones occupées. Ces phénomènes de francs tireurs irriteront les armées allemandes qui rétorqueront par des réquisitions et autres représailles (évènements de Chateaudun en octobre 70). La chute de Napoléon, selon les dires de Bismarck et de Guillaume 1er, devait être le but de cette guerre; évidemment il n’en était rien. Le conflit continua, révélant ainsi l’impérialisme bismarckien: il s’agissait bien d’une guerre dirigée contre le peuple français, et dès lors contre son prolétariat insurgé à Paris et ailleurs! Les hobereaux prussiens levèrent donc de lourds tributs dans les villes et les départements français occupés; ils fusillèrent sans pitié les résistants (francs-tireurs), pillèrent les maisons abandonnées, réquisitionnèrent en affichant une impitoyable rigueur.
Le siège de Paris débute donc le 19 septembre et inaugure la période que Victor Hugo appellera “l’année terrible”. Le siège sera dur pour la population qui connaîtra la famine, une mortalité multipliée par trois, mais qui résistera héroïquement.
Seul le sentiment patriotique fort vivace et donc la nécessité de défendre la Patrie unissaient les éléments révolutionnaires à ce gouvernement; ainsi, les premiers jours suivant le 4 septembre, les internationalistes et les délégués des chambres syndicales vinrent trouver Gambetta à l’Hôtel de Ville pour demander au gouvernement d’organiser la défense, et Blanqui, dans son journal “La Patrie en danger” soutint le gouvernement. Mais Marx et Engels, dès le début, ne se faisaient aucune illusion. Dans sa lettre du 7 septembre 1870, Engels écrit à Marx: «Toute cette république dont l’origine est exempte de luttes est jusqu’à présent une farce pure et simple (...) Les orléanistes détiennent pratiquement le pouvoir: Trochu le commandement militaire et Kératry la police, les messieurs de la Gauche ont les postes de bavards».
Ce gouvernement avait promis aux ouvriers les élections immédiates
de la Commune, mais il ne tint pas parole. Et très vite, il s’avéra
qu’il
avait plus peur de la classe ouvrière, qui lui avait donné le pouvoir,
que de l’ennemi prussien. «Entre ce conflit entre le devoir national
et l’intérêt de classe, le gouvernement de la défense nationale se
changea
en un gouvernement de la défection nationale» (Marx, “La guerre
civile...”, p.23).
b. Le gouvernement de la défection nationale
«Comment défendre Paris sans défendre sa classe ouvrière, l’organiser en une force effective et instruire ses rangs par la guerre elle-même? Mais Paris armé, c’était la révolution armée. Une victoire de Paris sur l’agresseur prussien aurait été une victoire de l’ouvrier français sur le capitaliste français et ses parasites d’État» (“La guerre civile...”, p.23).
Tandis que Thiers faisait le tour des cours européennes pour mendier leur intervention, Jules Favre avoue dans une lettre à Gambetta que ce contre quoi ils se défendaient, ce n’était pas des soldats prussiens, mais des travailleurs de Paris (cité dans “La guerre civile...”, p.24). D’ailleurs Trochu, le soir même du 4 septembre, harangua les maires de Paris en disant que la ville n’était pas en état de soutenir un siège contre l’armée prussienne; son plan était déjà la capitulation de Paris, mais au lieu de mettre au courant le peuple de Paris, “ils résolurent de le guérir de sa folie héroïque”. Et ce fut la bonne farce de la défense qui se termina par la capitulation du 23 janvier 1871. Ainsi, le gouvernement ne s’occupa-t-il pas sérieusement des préparatifs de défense, ni des opérations du siège: on traîna en longueur le terrassement des ouvrages extérieurs, les sorties faites étaient mal organisées et sans but précis.
Jules Favre rencontre Bismarck à Ferrières, les 19 et 20 septembre. Le général Ducroc convainc Trochu de reprendre la redoute de Châtillon aux Prussiens. Les moyens engagés étant insuffisants, Ducroc doit se replier!
Quoiqu’il en soit Von Moltke et Bismarck ont décidé d’éviter d’exposer leurs troupes et comptent sur la lassitude et la faim pour obtenir la capitulation de Paris.
Dans la Seconde Adresse de l’AIT du 9 septembre 1870, Marx avait prévenu ainsi les ouvriers français: «Les orléanistes se sont emparés des positions fortes de l’armée et de la police alors qu’aux républicains sont échus les ministères où l’on parle. Quelques uns de leurs premiers actes montrent assez clairement qu’ils ont hérité de l’Empire non seulement les ruines, mais encore la peur de la classe ouvrière» (“La guerre civile...”, p.288)
En effet, les classes dominantes savaient très bien que la classe ouvrière armée ferait une guerre révolutionnaire qui conduirait à remettre en cause l’existence même de la bourgeoisie; cette dernière préféra donc pactiser avec l’ennemi pour pouvoir écraser la révolution communiste que le prolétariat parisien représentait: «Les gouvernements nationaux ne font qu’un contre le prolétariat» (“La guerre civile...”, p.62).
Mais dès octobre, face à l’inefficacité de leur gouvernement,
l’agitation
populaire reprenait...
Dès le 5 septembre, un comité de vigilance est nommé dans des assemblées publiques, et ceci pour chaque arrondissement. Les forces révolutionnaires représentées par les internationalistes, les blanquistes et les républicains cherchent ainsi à organiser une défense. Lissagaray raconte: «Le 5 septembre, voulant centraliser pour la défense et le maintien de la République les forces du parti d’action, ils avaient invité les réunions publiques à nommer dans chaque arrondissement un Comité de Vigilance chargé de contrôler les maires et d’accueillir les réclamations. Chaque comité devait nommer quatre délégués, l’ensemble des délégués serait un Comité central des 20 arrondissements. Ce mode d’élection tumultuaire avait donné un comité composé d’ouvriers, d’employés, d’écrivains connus dans les mouvements révolutionnaires et les réunions de ces dernières années. Il s’était installé à la salle de la rue de la Corderie prêtée par l’Internationale et la Fédération des Chambres syndicales».
Bien que le Comité garda son autonomie et ne se confondit ni avec l’Internationale ni avec les représentants des Chambres syndicales, la “Corderie” était devenue le coeur du Paris révolutionnaire là se faisant la liaison entre les tendances. Certains membres du Comité, Lefrançais, Malon, Pindy, faisaient partie de l’Internationale. Gabriel Ranvier 12 était blanquiste, Millière représentait les intellectuels républicains. Dès le 15 septembre, ce Comité affirme son programme: élection des municipalités, la police remise en leurs mains, l’élection et la responsabilité de tous les magistrats, le droit absolu de presse, de réunion, d’association, l’expropriation de toutes les denrées de première nécessité, l’armement de tous les citoyens, l’envoi de commissaires pour faire suivre la province.
En outre, les clubs “rouges” où l’on discute de tous les problèmes
se multiplient; et la Garde nationale, composée avant le conflit d’une
soixantaine d’hommes fidèles à l’Empire, comprend maintenant une majorité
d’ouvriers qui s’y enrôlent pour défendre Paris, faisant ainsi
passer les effectifs à plus de 200 000 hommes.
b. La Commune de 1792 est
réclamée
dès le 22 septembre
Devant l’inertie du gouvernement qui repousse les élections et ne mentionne plus le mot de République dans ses textes officiels, devant les échecs successifs des sorties de Paris mal organisées, Paris s’agite.
Le 22 septembre, les délégués du Comité des 20 arrondissements et les représentants de la Garde nationale réclament les élections de la Commune. «Que la Commune, comme en 1792, sauve la ville et la France!» s’exclame Lissagaray.
Le 30 septembre, à la nouvelle de la capitulation de Strasbourg, les républicains révolutionnaires (qui s’opposent aux républicains parlementaires qui acceptent que la République soit une forme politique du vieil État), avec à leur tête blanquistes et internationalistes, commencent leur agitation surtout parmi les gardes nationaux.
Le 5 octobre, le savant Gustave Paul Flourens, commandant d’un secteur de la défense, descend de la colline de Belleville à Paris avec ses 10 bataillons de gardes nationaux pour demander des armes, la levée en masse, des sorties pour débloquer Paris du siège prussien, l’épuration du personnel bonapartiste toujours en place, et les élections immédiates de la Commune. Jules Ferry, secrétaire du gouvernement, refuse le 9 octobre de recevoir une autre délégation de bataillons ouvriers.
Le gouvernement cherche par ailleurs à arrêter Flourens et Blanqui!
c. L’insurrection du 30
octobre
Thiers, chargé par le gouvernement de trouver des soutiens auprès des autres pays européens, revient penaud.
La capitulation sans combat à Metz de l’armée du Rhin commandée par le général Bazaine 13, bonapartiste, le 27 octobre, est la preuve de la trahison du gouvernement de la contre-révolution bourgeoise. Voici comment Bazaine mendia l’armistice: «La société est menacée par un parti violent... mon armée est destinée à être la sauvegarde de la société; c’est la seule force qui puisse dompter l’anarchie... Elle offrirait à la Prusse, par effet de cette action, une garantie de gages que la Prusse pourrait réclamer, elle contribuerait à la venue d’un pouvoir régulier» (Bourdin, “La Commune de Paris”).
Les répercussions de la chute de Metz ne tardèrent pas à se manifester avec la mémorable journée du 30 octobre.
Les ouvriers organisés entre autres dans la Garde Nationale s’insurgent et font prisonnier presque tout le gouvernement de l’Hôtel de Ville, car, avec la reddition de Metz, «il n’existe pas dans l’histoire de plus haute trahison» (Lissagaray). Blanqui et ses partisans prennent la tête du mouvement. Le nouveau pouvoir comprend Blanqui, Delescluze, Flourens, Félix Pyat, et également Ranvier, Dorian, V.Hugo, Rochefort, Vaillant, Louis Blanc et Raspail. Mais il négocie, et relâche le 31 au soir ses prisonniers qui promettaient des élections à la Commune et la non poursuite des insurgés. Rochefort démissionne du gouvernement le 1er novembre.
Engels décrit ainsi l’issue de l’insurrection: «La trahison, un véritable parjure de la part du gouvernement et l’intervention de quelques bataillons de petits bourgeois leur rendirent la liberté et pour ne pas déchaîner la guerre civile à l’intérieur d’une ville assiégée par une armée étrangère, on laissa en fonction le même gouvernement» (Introduction à “La guerre civile...”, p.295).
Et Marx, dans le premier essai de “La guerre civile...”, (p.206),
note:
«A Paris, les différentes actions de début octobre visaient
à instaurer la Commune en tant que mesure de défense contre l’invasion
étrangère, concrétisant véritablement l’insurrection du 4 septembre.
Si l’action du 31 octobre n’aboutit pas à l’instauration de la Commune,
c’est que Blanqui, Flourens, et les autres chefs du mouvement firent
confiance
aux “gens de parole” qui avaient donné leur “parole d’honneur”
de démissionner et de céder la place à une Commune librement élue par
tous les arrondissements de Paris. Elle échoua parce que ses chefs
sauvèrent
la vie de gens qui ne cherchaient qu’à tuer leurs sauveurs. Ils
laissèrent
s’échapper Trochu et Ferry, mais ceux-ci les assaillirent avec les
Bretons
de Trochu (...)
«Si la Commune avait remporté la victoire au début de novembre
1870 (à un moment où elle était déjà instaurée dans les grandes
villes du pays), elle aurait sûrement trouvé un écho et se serait
étendue
à toute la France (...) elle aurait changé complètement la nature de
la guerre. Elle serait devenu la guerre de la France républicaine
hissant
l’étendard de la révolution sociale du 19e siècle contre la Prusse,
porte-drapeau de la conquête et de la contre-révolution (...)
En
escamotant la Commune du 31 octobre, les Jules Favre et Cie ont assuré
la capitulation de la France devant la Prusse et suscité l’actuelle
guerre
civile».
d. La farce du plébiscite du
3 novembre
Le 3 novembre, le gouvernement de la Défense nationale, fortement ébranlé par les actions révolutionnaires du 30 octobre, organisa en toute hâte un vote. Dans un Paris assiégé, au milieu d’un climat de peur et de contrainte, et sous l’action d’une intense propagande démagogique (le gouvernement dénonça le mouvement du 30 octobre comme une conspiration nouée avec les Prussiens; il nomma Clément Thomas commandant de la Garde nationale, sollicita la frayeur des classes moyennes à l’égard des bataillons ouvriers), un plébiscite était lancé sur la question de savoir si la population acceptait ou non de maintenir les pouvoirs du gouvernement.
Du plébiscite résultèrent 557 000 oui contre 62 000 non. Lissagaray
commente comme suit: «Comment 60 000 clairvoyants (...) ne
purent-ils
jamais gouverner l’opinion? C’est qu’ils se fractionnèrent en 100
courants
(...) Delescluze et Blanqui vivaient dans un cercle exclusif d’amis ou
de partisans. Félix Pyat (...) ne devenait pratique que pour sauver sa
peau. Les autres Ledru-Rollin, Louis Blanc, Schoelcher, etc...,
l’espoir
des républicains sous l’Empire, étaient rentrés d’exil poussifs (...)
Les radicaux, soucieux de leur avenir, n’allaient pas se compromettre
au
Comité des 20 arrondissements (...) Je vois bien à la Corderie les
enfants
perdus de la petite bourgeoisie qui tiennent la plume ou prennent la
parole
(...) Tout se tait. Sauf les faubourgs, Paris est une chambre de malade
où personne n’ose dire un mot».
e. La répression ouverte
commence
Le 5 novembre se déroulent à Paris les élections des maires et adjoints qui donnent 12 mairies favorables au gouvernement et 8 acquises à des partisans de la Commune dont Delescluze dans le 19e et Ranvier, Millière, Flourens dans le 20e, et aussi dans le XI ème, XVIII ème arrondissement. Devant ces succès des révolutionnaires, le gouvernement passe à l’attaque et lance des mandats d’arrêt contre les chefs populaires. Flourens est ainsi arrêté et ne sera libéré que le 21 janvier par les gardes nationaux.
De novembre à janvier, les armées françaises vont de défaite en défaite; le 28 novembre, le général Ducrot 14, après avoir exposé les gardes nationaux lors d’une sortie hors de Paris à d’inutiles sacrifices, ordonne la retraite.
Les conditions de vie à Paris pendant l’hiver 70-71 sont très
difficiles
du fait du manque de ravitaillement.
f. L’armistice du 28 janvier
1871
Le 6 janvier, le Comité central des 20 arrondissements fait placarder “L’affiche rouge”: “Place au peuple, place à la Commune!”, rédigée en bonne partie par Jules Vallès, mais aussi par Tridon, Vaillant, et qui réclame aussi la démission du gouvernement et la poursuite de la guerre. Le 9 janvier, le Comité s’élève à nouveau contre les capitulards.
Pour refroidir l’ardeur de la Garde nationale, Trochu lance une sortie-suicide vers Buzenval (vers Rueil Malmaison à l’est de Paris) le 19 janvier. Trois colonnes sont conduites par les généraux Vinoy, Bellemare, Ducrot. C’est une hécatombe de 5000 morts qui découragea toute autre tentative de sortie!
Après l’inutile et sanglante sortie de Buzenval le 19 janvier, le général Trochu est remplacé par le général Vinoy; mais la population est exaspérée. Le 21 au soir, des membres des clubs et des comités de vigilance convient les gardes nationaux à se rendre en armes sur la place de l’Hôtel de Ville, tandis que des révolutionnaires vont délivrer Flourens et d’autres prisonniers arrêtés le 31 octobre 1870. Le 22, l’Alliance Républicaine adresse une délégation à l’Hôtel de Ville qui est renvoyée. Une manifestation dirigée par les blanquistes a lieu le même jour et est un nouvel échec ; de l’Hôtel de Ville fortifié et garni de mobiles bretons, une fusillade éclate, qui balaye la place et fait 30 morts. Delescluze est arrêté, les clubs sont fermés, les journaux républicains sont supprimés. Le gouvernement de la Défense nationale est maître de la situation et peut accomplir le dessein qu’il projette depuis le début du siège: arrêter la résistance et livrer Paris aux Prussiens.
Le 28 janvier 1871, fournissant le prétexte de la famine, Jules Favre négocie à Versailles un armistice (le gouvernement n’ose pas encore signer la paix); et ceci survient dix jours après la réunion des États du nord et du sud de l’Allemagne qui ont offert à Versailles la couronne impériale à Guillaume de Prusse! L’armée française doit rendre ses canons...
La nouvelle de la capitulation fut pour les Parisiens comme un coup
sur la nuque, la ville assommée ne bougea qu’à peine. Pour secouer les
masses, il fallut l’entrée des Allemands à Paris, la capitulation lâche
et hâtive de la bourgeoisie.
g. Bismarck, complice du
gouvernement
français 15
S’il reste prudent, Bismarck ne veut pas moins en finir avec Paris.
Avec la capitulation, le gouvernement français ouvrait la guerre civile
qu’il allait maintenant engager avec l’aide de la Prusse, contre la
République,
contre Paris et surtout contre la Révolution en marche. Le traquenard
était tendu dans les clauses mêmes de la capitulation. Bismarck y
exigeait
ainsi l’élection nationale d’une Assemblée 16
dans les 8 jours, qui devait décider de la paix ou de la guerre. Marx
commente cette clause: «A ce moment, plus d’un tiers du
territoire
était aux mains de l’ennemi, la capitale était coupée des départements,
toutes les communications étaient désorganisées. Élire dans ces
circonstances
une véritable représentation de la France était impossible sans prendre
largement le temps nécessaire aux préparatifs. C’est précisément
pourquoi la capitulation stipula qu’une Assemblée nationale devait
être élue dans les 8 jours, de sorte qu’en bien des parties de la
France
la nouvelle des élections à faire n’arriva qu’à la veille du scrutin»
(“La guerre civile...”, p.29).
4. LA CONTRE-RÉVOLUTION SE
DÉCHAÎNE
a. Les élections de
l’Assemblée
des ruraux
Thiers, avant même que le secret de l’armistice ait été divulgué dans Paris, était parti en tournée électorale à travers les départements pour y galvaniser et y rappeler à la vie le Parti légitimiste, qui devait désormais prendre à côté des orléanistes la place des bonapartistes que l’on n’eut pas tolérée. Il fallait une nouvelle chambre pour négocier la paix!
Les élections donnèrent une majorité monarchiste: sur 750 députés, 450 monarchistes composés d’aristocrates, de la haute bourgeoisie orléaniste, des hobereaux légitimistes, donc qui représentaient surtout la grande propriété foncière, d’où son appellation d’ “Assemblée des ruraux” clamée par le député radical marseillais, Gaston Crémieux, des tribunes lors de la séance du 13 février à Bordeaux.
A Paris, sur 43 élus, 6 sont partisans de la capitulation (Thiers qui sera d’ailleurs élu dans treize départements, et Jules Favre évidemment). Lissagaray commente: «La liste qui sortit le 6 février fut un arlequin de toutes les nuances républicaines et de toutes les fantaisies politiques (...) Louis Blanc, que tous les comités portaient sauf la Corderie, ouvrit la marche avec 216 000 votes, suivi de Victor Hugo, Gambetta, Garibaldi. Delescluze réunit 154 000 suffrages. Millières fut élu (...) La sentinelle vigilante qui pendant tout le siège avait toujours montré de la sagacité, Blanqui, ne trouva que 52 000 votes – à peu près les opposants du plébiscite – tandis que Félix Pyat en recevait 145 000 pour ses fifreries du “Combat” (...) Ce scrutin confus attestait au moins l’idée républicaine».
Des représentants de l’Internationale et du Comité des 20
arrondissements,
comme Tolain, Malon, Gambon, furent aussi élus.
b. Le gouvernement livre la
France
aux Prussiens
Avec la capitulation du 28 janvier, le masque de l’imposture de la bourgeoisie était enfin jeté. Marx note, dans “La guerre civile...”, (p.25): «Dans une véritable frénésie d’avilissement, le gouvernement de la Défense nationale apparut dans la capitulation de Paris comme le gouvernement de la France par des prisonniers de Bismarck».
En effet, la bourgeoisie avait hâte d’en finir avec la révolution ; comme elle comptait sur Bismarck pour l’y aider, elle se jeta à ses pieds ignoblement et livra, sans en discuter honorablement le prix, la France au vainqueur prussien.
Le 13 février, l’assemblée des ruraux qui de Tours était passée à Bordeaux, se réunissait. Garibaldi dut renoncer à son mandat en raison de sa nationalité italienne, et il fut hué par la majorité monarchiste des députés. Les débats furent très agités entre une minorité républicaine et une majorité monarchiste. Le 17, elle élit comme chef de gouvernement Adolphe Thiers, «expression intellectuelle la plus achevée de sa corruption de classe» (Marx dans “La guerre civile...”), chef du pouvoir exécutif. Ce dernier choisit ses ministres, tout aussi peu reluisants que lui: Jules Favre, Picard, Dufaure, Jules Simon, Pouyer-Quertier. Marx dépeint sarcastiquement dans “La guerre civile...” les vices peu cachés de chacun de ces tristes personnages.
Le 26 février, les préliminaires de paix sont signés à Versailles entre Thiers, Favre et Bismarck; les conditions sont draconiennes pour la France: Bismarck extorque à la France la somme fabuleuse de 5 milliards de francs-or 17; il exige l’entretien d’un demi million de ses soldats sur le sol français et l’intérêt à 5% des échéances en retard; les Prussiens devaient rentrer à Paris par groupes de 30 000 hommes à partir du 3 mars et occuper les Champs Elysées; les forts de l’est devaient être occupés jusqu’au versement des 500 premiers millions et les départements de l’est jusqu’au paiement final. Enfin, Bismarck arrache à la France l’Alsace moins Belfort, et le tiers de la Lorraine germanique avec Metz et Strasbourg pour les incorporer à l’Allemagne. Ce même jour, les Parisiens s’emparent des canons de la garnison et les installent à Belleville et à Montmartre!
Engels écrit: «Paris capitula et paya 200 millions de tribut de
guerre. Les forts furent livrés aux prussiens. La garnison dut déposer
les armes devant les vainqueurs et livrer son artillerie de campagne,
tandis
que les canons des remparts furent démontés de leurs affûts. Toutes
les pièces pouvant servir à la résistance et appartenant à l’État
furent saisies sans exception, mais on ne toucha pas aux véritables
défenseurs
de Paris – la Garde nationale et le peuple en armes. Personne n’osa
imaginer
qu’ils livreraient leurs armes, canons aussi bien que fusils. Pour que
le monde entier sût que l’armée allemande s’était respectueusement
arrêtée
devant le peuple parisien en armes, les vainqueurs n’entrèrent pas dans
la ville, mais se contentèrent d’occuper pendant trois jours... les
Champs
Elysées, un jardin public, en étant gardés, surveillés, cernés par
des parisiens en faction! Pas un soldat allemand ne mit les pieds dans
l’Hôtel de Ville, pas un ne se risqua sur les boulevards, et les rares
qui furent admis au Louvre pour y admirer les trésors artistiques
avaient
dû demander l’autorisation.
«La France était écrasée, Paris affamé; mais le peuple de Paris
s’était assuré ce respect en raison de son glorieux passé: nul n’osait
le désarmer, nul n’avait le courage d’aller le trouver chez lui.
«En procédant à ces annexions, Bismarck appliqua pour la première
fois sa politique propre. Il n’exprimait plus, à sa façon, un programme
prescrit de force par les conditions existantes, mais traduisait dans
les
faits les chimères de son propre cerveau. C’est ainsi qu’il commit sa
première lourde gaffe...» (“Écrits Militaires”, p.573). Engels
fait allusion aux conséquences internationales de cette annexion, que
nous développerons plus loin.
Thiers fit entendre à l’Assemblée que les préliminaires de paix devaient être agréés sur le champ, sans même avoir les honneurs d’un débat parlementaire. Marx commente: «A cette condition seulement la Prusse leur permettrait d’ouvrir les hostilités contre la République et Paris, sa place-forte. La contre-révolution, en effet, n’avait pas de temps à perdre» (“La guerre civile...”, p.30).
Le 1er mars, l’Assemblée ratifia le traité malgré la protestation désespérée des députés alsaciens et lorrains, par 546 voix contre 107. Félix Pyat, Malon, Rochefort démissionnèrent.
C’est le traité de paix de Francfort signé le 10 mai 1871 qui mit fin officiellement à guerre franco-prussienne. Napoléon III s’exila en Grande Bretagne avec sa famille!
Le bilan politique de cette guerre est fondamental. La France a perdu l’Alsace Lorraine (annexés au 18 ème siècle). Les quatre États du sud de l’Allemagne ont vu la fin de leur existence au profit de la Prusse. Les relations entre l’Allemagne, devenue une puissance dangereuse, et la Russie vont se détériorer et la France va se rapprocher de la Russie. L’Allemagne sera ainsi encerclée par l’hostilité de la France, de la Russie et de l’Angleterre ce qui conduira inéluctablement à l’affrontement de 1914-18 prévu par Engels.
Délivrés de la guerre extérieure, l’Assemblée pouvait désormais
s’occuper de Paris.
c. Lourd bilan de la guerre
franco-allemande
de mi-juillet 1870 à janvier 187118
265 000 soldats français réunis dans l’Armée du Rhin s’affrontèrent aux 500 000 soldats prussiens auxquels s’ajoutèrent 300 000 soldats des états allemands du sud, soit 800 000 soldats!
Les pertes humaines sont estimées à 44 000 morts dans les rangs
allemands
(14% des effectifs) dont la moitié de maladie, 128 000 blessés et 100
000 malades. Du côté français, 139 000 morts (dans le combat ou par
maladie), 143 000 blessés et 320 000 malades! Ces chiffres comprennent
les civils touchés par les bombardements et la famine, et les tragédies
du camp des Bretons de Coulie. La variole a décimé les rangs des deux
armées, mais les Prussiens connaissant l’efficacité du rappel
antivariolique
ont eu nettement moins de pertes par cette maladie (8500 Prussiens
contaminés
et 450 morts, 125 000 français contaminés et 23 500 décès!).
Cette guerre marquera un changement déterminant dans la tactique
militaire.
La cavalerie, qui avait dominé les batailles depuis des siècles, n’a
plus de rôle en raison de la précision des fusils comme le chassepot
français et l’utilisation d’obus percutants. L’artillerie lourde est
déterminante
et finit désormais la bataille.
d. La contre-révolution n’a
pas
de temps à perdre
Continuons avec Marx (“La guerre civile...”, p.30): «La
contre-révolution,
en effet, n’avait pas de temps à perdre. Le second Empire avait enflé
les charges d’une manière effrayante et ravagé sans pitié les
ressources de la nation. Pour compléter la ruine, le Shylock prussien
était là exigeant (...) son indemnité de 5 milliards (...) Qui allait
payer la note? Ce n’est qu’en renversant la République par la violence
que ceux qui s’appropriaient la richesse pouvaient espérer faire
supporter
aux producteurs de cette richesse les frais d’une guerre qu’ils avaient
eux-mêmes provoquée. Ainsi, c’est précisément l’immense ruine de la
France qui poussait ces patriotiques représentants de la propriété
terrienne
et du capital, sous les yeux mêmes et la haute protection de
l’envahisseur,
à greffer sur la guerre étrangère une guerre civile, une rébellion
de négriers.
«Il y avait un grand obstacle qui barrait la route au complot:
Paris. Désarmer Paris était la première condition du succès».
Paris fut d’abord sommé par Thiers de rendre les armes; le 6 mars, une tentative d’enlever les canons de Paris parqués au Luxembourg fut un échec.
Puis Paris fut harcelé par les frénétiques manifestations anti républicaines de l’Assemblée des ruraux et par les déclarations équivoques de Thiers lui-même sur le statut légal de la République; par la menace de décapiter et de décapitaliser Paris (le 10 mars, l’Assemblée choisit Versailles et non Paris comme lieu de résidence); par la nomination d’ambassadeurs orléanistes; par les lois Dufaure sur les échéances commerciales et les loyers qui ruinaient le commerce et l’industrie parisiens. Lissagaray, à propos des lois Dufaure, écrit: «300 000 ouvriers, boutiquiers, façonniers, petits fabricants et commerçants qui avaient dépensé leur pécule pendant le siège et ne gagnaient rien encore furent jetés à la merci du propriétaire et de la faillite». Et plus loin: «Ce que les périls du siège n’avaient pu, l’Assemblée le fit : l’union de la petite bourgeoisie avec le prolétariat».
De plus, la taxe Pouyer-Quertier sur chaque exemplaire de toutes les
publications, les sentences de mort contre Blanqui et Flourens à cause
de l’insurrection du 30 octobre (Blanqui sera arrêté le 17 mars dans
le Lot, où il se reposait), la suppression des journaux républicains,
le renouvellement proclamé par Palikao de l’état de siège aboli le 4
septembre, la suppression des 30 sous accordés aux gardes nationaux; et
enfin la nomination de Vinoy, le décembriseur 19,
comme gouverneur de Paris, celle de Valentin, le gendarme de l’Empire,
comme préfet de police, celle de Burelles de Paladine, le général
jésuite,
comme commandant de la garde nationale à la place de Clément Thomas,
qui avait préféré donné sa démission... Thiers avait remis Paris à
la tendre sollicitude de ce triumvirat. Et ces messieurs du
gouvernement
étaient d’autant plus pressés, comme le souligne toujours Marx, dans
“La guerre civile...” (p.31), qu’ils avaient contracté un emprunt
de 2 milliards, avec un énorme pot de vin pour chacun d’eux, qui ne
devaient
être versés, emprunt et pots de vin, qu’après la “pacification”
de Paris. Et Marx de conclure: «En tout cas, il faut que la chose
ait
été très urgente car Thiers et Jules Favre, au nom de la majorité de
l’Assemblée de Bordeaux, sollicitèrent sans vergogne l’occupation
immédiate
de Paris par les troupes prussiennes. Mais cela n’entrait pas dans le
jeu
de Bismarck...».
5. LE PARIS RÉVOLUTIONNAIRE
S’INSURGE
On sait que début septembre Paris avait déjà nommé des comités de vigilance chargés d’organiser la défense et le ravitaillement des quartiers populaires. Durant le siège, la Garde nationale s’était toujours plus renforcée en nombre et en matériel avec des armes et des canons acquis par souscription; elle constituaient maintenant une armée de plus de 200 000 hommes divisés en 260 bataillons, équipés de 450 000 fusils, de 2000 canons et de leur approvisionnement (selon Talès). Thiers demanda à Paris de déposer les armes sous un prétexte qui était le plus criant des mensonges, à savoir que l’artillerie de la Garde nationale appartenait à l’État; or cette artillerie avait été officiellement reconnue comme la propriété privée de la Garde nationale dans la capitulation du 28 janvier et à ce titre elle avait été exceptée de la reddition générale. Mais la révolution ne voulait pas déposer les armes; elle voulait toujours défendre Paris et la France.
Marx dans le premier essai de “La guerre civile...”, écrit: «Aussi
le soulèvement de tout le Paris ouvert à la vie (...) contre le
gouvernement
de la Défense ne date-t-il pas du 18 mars, bien qu’il ait emporté ce
jour-là sa première victoire sur la conjuration. Il date du 31 janvier,
du jour même de la capitulation.
«La Garde nationale – c’est-à-dire tous les Parisiens armés
– s’est organisée et a vraiment gouverné Paris à partir de ce jour-là,
indépendamment du gouvernement usurpateur des capitulards mis en place
par la grâce de Bismarck. Elle a refusé de livrer les armes et son
artillerie
qui lui appartenaient et qui lui avaient été laissées à la
capitulation,
parce qu’elles étaient sa propriété. Ce n’est pas la magnanimité de
Jules Favre qui a sauvé ces armes des mains de Bismarck, c’est la
promptitude
des combattants parisiens à lutter pour les arracher à Jules Favre et
à Bismarck».
b. La fédération de la Garde
nationale
Lissagaray nous apprend que vers la fin janvier quelques républicains avaient essayé de grouper les gardes nationaux dans un but électoral. Une grande réunion avait d’abord eu lieu au Cirque d’Hiver sous la présidence d’un négociant, Courty. Une deuxième réunion eut lieu le 15 février dans la salle du Vauxhall 20, mais on ne songeait plus aux élections. Une seule pensée occupait tous les coeurs: l’union des forces parisiennes contre les ruraux triomphants pour la défense de la République. L’idée de fédération jaillit de la réunion, et on décida que les bataillons se grouperaient autour d’un Comité Central (CC). Une commission fut chargée d’élaborer les statuts de la nouvelle organisation, c’est-à-dire la fédération des compagnies avec la création d’un comité central formé de délégués des différentes compagnies.
Chaque arrondissement représenté dans la salle – 18 sur 20 – nomma sur place un commissaire pour cette commission. «Qui sont-ils? Les agitateurs du siège, les socialistes de la Corderie, les écrivains en renom? Nullement. Il n’y a parmi les élus aucun nom ayant notoriété bourgeoise. Les commissaires sont de petits bourgeois, boutiquiers, employés, étrangers à toutes les coteries, jusque-là même à la politique pour la plupart» (Lissagaray, “Histoire de la Commune de Paris 1871”).
Parmi le CC, on trouve déjà Georges Arnold (architecte de la ville de Paris), André Alavoine (typographe, blanquiste, il s’occupera de l’imprimerie nationale), Gaston Da Costa (étudiant blanquiste), des futurs communards. Leur président, le commerçant Courty, est un républicain modéré.
Le 24 février, l’Assemblée générale réunissant 2000 délégués des gardes nationaux au Vauxhall approuve ces statuts, se prononce pour la suppression des “armées nationales” et s’engage à intervenir si les Prussiens entrent à Paris comme le prévoit le traité. Des manifestations ont lieu à Paris au cri de “Vive la République!”. L’atmosphère est donc explosive.
Le 27 février, quelques jours avant l’entrée des Prussiens prévue par le traité, les bataillons de la Garde nationale décident d’aller chercher les 237 canons et mitrailleuses payés par les souscriptions de Paris et qui ont été traîtreusement abandonnés par les capitulards dans les quartiers que les Prussiens doivent occuper (dans les parcs de Passy, la place Wagram, le Ranelagh).. Ces canons sont transportés à l’est de Paris, Montmartre, Belleville, Ménilmontant, la Villette, place des Vosges et à la barrière d’Italie, tandis que des groupes armés attendent aux Champs Elysées et avenue de la Grande Armée l’arrivée des Prussiens. Le 28, une réunion des chefs de bataillons et de délégués des comités militaires présidée par Jules Bergeret 21 voulut appliquer les décisions du 24, c’est-à-dire empêcher l’entrée des Prussiens, mais les membres de la commission qui se comportait comme un comité central les en dissuadèrent. Le 28 au matin, les trois groupes de la place de la Corderie – c’est-à-dire le Conseil Général de l’Internationale parisienne, la Fédération des chambres syndicales, le CC des 20 arrondissements – avaient placardé un manifeste 22 adjurant les travailleurs de s’abstenir, mais ces trois groupes désorganisés et réduits avaient peu d’audience par rapport aux représentants de la masse armée.
Le 1er mars, la Chambre ratifie les préliminaires de paix, malgré la protestation des députés alsaciens et lorrains, par 546 voix contre 107; les Prussiens entrent dans les beaux quartiers: 30 000 défilèrent silencieusement sous l’oeil des insurgés, et l’empereur Guillaume renonça à sa visite. Ils quitteront d’ailleurs Paris le 2. La ville ne pouvait oublier l’outrage, et les nouvelles de l’Assemblée de Bordeaux ne firent que l’exciter davantage (avec les projets de loi sur les loyers, le vote des conditions de paix,etc...).
Le 3 mars, l’assemblée des délégués de 200 bataillons vote les statuts de la Fédération républicaine de la Garde nationale. La Garde nationale devient Fédération républicaine et les gardes nationaux des “fédérés”. Elle nomme une commission exécutive qui doit préciser le rôle du comité central et qui, en attendant, doit concentrer les pouvoirs de la Garde nationale. On y trouve Jules Bergeret, Auguste Viard (employé de commerce), Jean Louis Pindy (menuisier, membre de l’AIT), Eugène Varlin (membre de l’AIT), Jacques Louis Durand (ouvrier cordonnier).
Le 8 mars, Victor Hugo démissionne en pleine séance de l’Assemblée,
après un nouvel incident au sujet de Garibaldi. Le 10 mars, l’Assemblée
vote son transfert à Versailles. 23
Le même jour, Jules Favres écrit à Thiers: «Nous sommes décidés
à en finir avec les redoutes de Montmartre et de Belleville» (cf
Louise Michel, “La Commune, histoire et souvenirs”). La Chambre décide
de suspendre la solde des gardes nationaux et le moratoire des loyers,
mesure qui avait été prise pour compenser les effets du siège et du
blocus économique. Georges Clémenceau, médecin des pauvres et maire
de Montmartre depuis septembre 1870, tente vainement de réconcilier
Paris
et Versailles. Thiers s’installe à Paris le 16 mars pour “pacifier”
la ville!
c. Le gouvernement populaire
Le 13 mars, la Fédération de la Garde nationale est ratifiée par 215 bataillons sur 270, et elle élit ses délégués. Marx, dans le premier essai de “La guerre civile...”, écrit: «Sur la base existante de son organisation militaire, Paris édifia une fédération politique, selon un plan très simple. Elle consistait en une association de toute la Garde nationale, unie en toutes ses parties par les délégués de chaque compagnie, désignant à leur tour les délégués des bataillons, qui, à leur tour, désignaient les délégués généraux, les généraux de légion – chacun d’eux devant représenter un arrondissement et coopérer avec les délégués des 19 autres arrondissements. Ces 20 délégués, élus à la majorité par les bataillons de la Garde nationale, composaient le Comité Central».
Le Comité Central (CC) constitué va siéger place la Corderie 24, ce foyer révolutionnaire, au local qu’occupent déjà le Conseil général de l’Internationale parisienne (qui dans l’ensemble reste hésitant quant à sa participation à ce CC; quatre membres en feront tout de même partie), la Fédération des chambres syndicales, et le CC des 20 arrondissements. Qui sont les membres du CC? Lissagaray nous fait le récit de la séance des élections (p.106): «Garibaldi fut acclamé général en chef de la Garde nationale. Un orateur transporta l’assemblée, Lullier, ancien officier de marine (...) Il se fit nommer commandant de l’artillerie. On proclama ensuite le nom des élus du CC – une trentaine environ; plusieurs arrondissements n’avaient pas encore voté. C’est le CC régulier, celui qui entrera dans l’Hôtel de Ville. Beaucoup des élus appartenaient à la précédente commission. Les autres tout aussi obscurs, de toutes les couches du peuple, connus seulement des conseils de famille ou de leurs bataillons. Les hommes en vedette n’avaient pas brigué les suffrages. La Corderie, les blanquistes aussi, ne voulaient pas admettre que cette fédération, ce Comité, ces inconnus fussent une force. Ils ne marcheront pas, il est vrai, pour un programme quelconque. Le CC n’est pas la tête d’une colonne d’un parti; il n’a pas d’idéal à produire. Une idée très simple, se défendre de la monarchie, a seule pu grouper tant de bataillons. La Garde nationale se constitue en compagnie d’assurance contre un coup d’État; le CC est la sentinelle, voilà tout» (p.106).
On trouve ainsi parmi les membres du CC quatre internationaux (E.Varlin, Assi, Alavoine, Jules Babick 25), et d’autres comme Jourdes, Fleury, Ranvier, Bergeret, Eudes, Duval, Lullier, Brunel, E.Moreau, etc...
Ce CC se comporte donc comme le gouvernement populaire de la capitale ; il fut reconnu par tous les comités de quartiers; le comité de la rue des Rosiers (18ème arrondissement), le plus important des comités par sa situation et le nombre de ses canons, traita d’abord sur pied d’égalité avec le CC auquel il n’envoya de délégués que fort tard. Engels parle ainsi du CC (exposé sur la Commune au conseil général du 21 mars 71; “La Commune” p.120): «Aucun des hommes du CC n’est célèbre; il n’y a pas parmi eux de Félix Pyat et individus de son espèce; mais ces hommes sont bien connus de la classe ouvrière. Quatre membres de l’Internationale font partie du Comité. Le CC proclama qu’il respecterait la liberté de presse, mais ne tolérerait pas la presse pourrie des bonapartistes. La résolution la plus importante qu’il adopta déclarait que les préliminaires de paix seraient respectés».
Et Marx (“La guerre civile...”, p.250): «Du jour même de la capitulation, par laquelle le gouvernement de la Défense nationale avait désarmé la France, mais s’était réservé un garde du corps de 40 000 hommes dans le but de mater Paris, Paris se tenait sur le qui-vive (...) Pendant toute la période qui s’étend entre la réunion de l’Assemblée nationale à Bordeaux et le 18 mars, le CC avait été le gouvernement populaire de la capitale, et il était assez fort pour maintenir avec fermeté son attitude de défense, malgré les provocations de l’Assemblée, les violentes mesures de l’Exécutif et les menaçantes concentrations de troupes».
La situation était explosive; le peuple parisien hésitait à
déclencher
une guerre civile alors que la bourgeoisie complotait déjà contre lui
et la Révolution depuis le 4 septembre. Le Prussien ne voulait pas
aider
ouvertement la bourgeoisie française à faire sa sale besogne en
occupant
Paris; il ne restait plus à cette dernière qu’à s’y mettre; le 18 mars,
elle passa donc de nouveau à l’attaque: désarmer Paris, puisque Paris
armé, c’est la révolution!
6. 18 MARS:
L’ENNEMI N’EST PLUS L’ALLEMAGNE
a.La bourgeoisie passe à
l’attaque
Engels commente (Introduction de 1891 à “La guerre civile...”, p.295): «Pendant la guerre, les ouvriers parisiens s’étaient bornés à exiger la continuation énergique de la lutte. Mais maintenant qu’après la capitulation de Paris, la paix allait se faire, Thiers, le nouveau chef du gouvernement, était forcé de s’en rendre compte: la domination des classes possédantes – grands propriétaires fonciers et capitalistes – se trouverait constamment menacée tant que les ouvriers parisiens resteraient en armes. Son premier geste fut pour tenter de les désarmer. Le 18 mars, il envoya des troupes de ligne avec l’ordre de voler l’artillerie appartenant à la Garde nationale, fabriquée pendant le siège de Paris aux frais d’une souscription publique. La tentative échoua, Paris se dressa comme un seul homme pour se défendre et la guerre entre Paris et le gouvernement français qui siégeait à Versailles fut déclarée».
Nous pouvons reconstituer les faits à l’aide de Lissagaray (p.110) ; Thiers avait donné l’ordre à ses troupes dirigées par Vinoy d’occuper les Buttes Chaumont, Belleville, le Temple, la Bastille, l’Hôtel de Ville, Montmartre, les Invalides et de reprendre les canons parqués “au champ des polonais” (espace sur lequel fut construit en 1873 le Sacré Coeur!) de Montmartre, avec pour prétexte que ces canons auraient pu être récupérés par les Prussiens! Ceci fut fait à trois heures du matin sans coup férir, car un seul garde national avait été affecté à la garde du parc d’artillerie! Louise Michel et le Dr Clémenceau, maire du 18ème, accoururent très vite pour soigner le garde blessé. Mais Vinoy n’avait pas prévu les chevaux pour déménager les canons, ce qui demanda du temps et laissa les faubourgs s’éveiller. Des affiches signées de Thiers et de ses ministres avaient été déjà placardées sur les murs de Paris. Réveillée, la population réalise alors l’agression, réagit immédiatement, interpelle les soldats et donne l’alerte. Le rappel est battu, des gardes nationaux parcourant le 18e arrondissement (Montmartre). Les troupes du général Claude Lecomte, qui devaient occuper Montmartre, fraternisent avec les gardes nationaux et la foule. Le général Lecomte par trois fois demande à ses soldats de tirer sur la foule, puis les insulte. Ses soldats veulent le fusiller, mais les gardes nationaux présents les en empêchent et conduisent Lecomte au Château-Rouge 26, quartier général des bataillons de la Garde nationale de Montmartre.
La réaction populaire et le revirement de situation est identique pour les autres quartiers. A onze heures, le peuple a vaincu l’agression sur tout les points, a conservé presque tous ses canons et gagné des milliers de fusils.
D’Aurelles de Paladine fait battre depuis six heures du matin le rappel des gardes nationaux; 500 à 600 répondirent!
L’agression du matin surprend le CC de la Garde nationale comme tout Paris. Les comités de vigilance et les gardes nationaux stationnés sur les quartiers ont pu appuyer le réflexe de défense du peuple parisien. Ainsi, Louise Michel et Ferré, membres du comité de vigilance du 18e arrondissement, participent à la reprise des canons de Montmartre. Vers 16heures 30, Clément Thomas, l’homme de juin 1848 27, est arrêté rue des martyrs (dans le 18e arrondissement). Les soldats et la foule, luttant contre les gardes nationaux qui veulent s’y opposer, fusillent rue des rosiers 28 le général Lecomte, arrêté le matin, et Clément Thomas, «cet ennemi personnel de la classe ouvrière de Paris».
Peu à peu, les bataillons fédérés prennent l’offensive et occupent les casernes, l’imprimerie nationale. Ainsi le CC de la Garde nationale dirige l’action, organise les combats (rassembler les bataillons, faire passer les troupes du côté de la Garde nationale, élever des barricades, s’emparer de points vitaux). Les fédérés cernent l’Hôtel de Ville et les troupes de Brunel 29 en prendront possession après que les membres du gouvernement et les gendarmes s’en soient enfuis 30.
Quand il apprend la débandade de ses troupes et leur fraternisation
avec la population, Thiers donne l’ordre de les faire replier sur le
Champ
de Mars. Lorsque, devant le ministère où il s’est réfugié, passent
trois bataillons de gardes nationaux, le gouvernement se croit perdu.
Thiers,
paniqué
(C.Talès, “La Commune” de 1871, écrit en 1924, édition Paris 1983,
p.44), s’enfuit par un escalier dérobé et se fait escorter jusqu’à
Versailles
par un escadron. Le soir du 18 mars, il donne l’ordre d’évacuer Paris
à tous les services gouvernementaux, à toutes les casernes. Il pense
refaire une armée à Versailles; il ordonne même d’évacuer les forts
du sud restitués par les Prussiens 15 jours auparavant, et parmi eux
celui
du Mont Valérien 31,
point stratégique de la défense de Paris et de Versailles, car Thiers
ne pense qu’à se protéger à Versailles! C’est la débandade!
Malheureusement, les insurgés, “trop honnêtes”, mal organisés et
mal dirigés, n’en profitent pas.
«La glorieuse révolution ouvrière du 18 mars établit sa domination incontestée sur Paris. Le CC fut son gouvernement provisoire» (Marx, “La guerre civile...”, p.33).
Dans ce Paris qui commence à se vider de tout ce qui représentait le régime précédent 32, le CC, bien malgré lui, doit faire figure de gouvernement provisoire, car il est le seul à Paris à pouvoir le faire.
Les hommes “obscurs” qui le composent, délégués de bataillons populaires seulement connus dans leurs quartiers (Lissagaray p.118) sont surpris par l’évènement et projetés à l’Hôtel de Ville par l’insurrection. Ils sont hésitants, et leur premier acte est de vouloir remettre le pouvoir au peuple parisien, c’est-à-dire de préparer les élections à la Commune, qu’ils fixent au 23 mars, mais qui seront repoussées au 26 par la suite. Mais en attendant ces élections, ils gouvernent Paris!
Le 19 mars, le CC publie deux proclamations: il remercie l’armée de
n’avoir pas voulu «porter la main sur l’arche saine de nos libertés»
et appelle Paris et la France à «jeter ensemble les bases d’une
république
acclamée avec toutes ses conséquences, le seul gouvernement qui fermera
pour toujours l’ère des invasions et des guerres civiles». En
conséquence,
le CC appelle le peuple parisien à de nouvelles élections. Un appel
comparable
est adressé aux gardes nationaux. Mais s’il décide «de conserver,
au nom du peuple» l’Hôtel de Ville, le CC ne se considère donc pas
comme un gouvernement révolutionnaire, mais comme l’agent qui va
permettre
au peuple d’affirmer sa volonté par de nouvelles élections.
Il faut que malgré le désarroi des services, la vie de Paris continue. Poussé par la nécessité, le CC prend conscience de son rôle et de la révolution qui vient de s’accomplir le 18 mars. Il envoie avec ardeur des délégués s’emparer des ministères désertés et des différents services: l’ouvrier Adolphe Assi, membre de l’AIT, reçoit le gouvernement de l’Hôtel de Ville; l’artisan relieur, membre de l’AIT, Eugène Varlin, et le clerc de notaire et comptable François Jourde vont aux finances ; Lucien Combatz aux Postes; Ed. Moreau, blanquiste, est délégué à la surveillance du Journal Officiel (JO) et de l’imprimerie; Duval et Raoul Rigault, blanquistes aussi, à la préfecture de Police; Eudes, journaliste blanquiste, à la Guerre; le capitaine de bataillon de la Garde nationale Jules Bergeret est nommé commandant en chef de la place de Paris.
Les membres de l’Internationale et les blanquistes se partagent donc les postes importants.
Lissagaray écrit (p.131): «En 1831, les prolétaires, maîtres de Lyon pendant 10 jours n’avaient pas su s’administrer. Combien plus grande la difficulté pour Paris (...) Le CC ne trouvait que des rouages disloqués. Au signal de Versailles, la plupart des employés avaient abandonné leurs postes (...) On vint de partout au CC. Les comités d’arrondissement fournirent le personnel aux mairies; la petite bourgeoisie prêta son expérience».
La question urgente, celle de régler la solde des gardes nationaux, se dénoue sans violence. Varlin et Jourdes n’osent pas forcer les coffres du ministère des Finances qui contiennent plusieurs millions de francs et dont les clés se trouvent à Versailles. Le CC obtient un crédit de un million de francs du gouverneur de la Banque de France.
Le CC considérant que la solidarité des soldats avec la Garde nationale a causé le succès du 18 mars, vote à l’unanimité l’abolition des conseils de guerre. Le 21, il suspend la vente des objets engagés au Mont de Piété, proroge d’un mois les échéances, interdit aux propriétaires de congédier leurs locataires, accorde l’amnistie à tous les condamnés politiques. Le CC se comporte donc comme un gouvernement provisoire. Mais son programme reste modéré; d’ailleurs Varlin, membre de l’AIT, écrira aux internationalistes suisses groupés autour de Bakounine et de Guillaume qui voyaient dans le 18 mars la révolution sociale universelle: «...qu’il ne s’agissait pas de révolution internationale; que le mouvement du 18 mars n’avait eu d’autre but que la revendication des franchises municipales de Paris et que ce but était atteint».
Un tel programme n’a rien de subversif et n’implique nullement une action militaire contre Versailles!
En effet, le CC a au fond une horreur superstitieuse de
l’illégalité,
car il a peur de sa conséquence: la guerre civile. Il prêche
constamment
la modération, vote à l’unanimité la levée de l’état de siège, rétablit
la liberté de la presse. Dès le 23 mars, il précise son programme. Il
constate d’abord la faillite d’un pouvoir qui a mené la France à la
défaite
et à la capitulation: «le principe d’autorité est désormais
impuissant
pour rétablir l’ordre dans la rue, pour faire renaître le travail dans
l’atelier, et cette impuissance est sa négation». Il faut donc
retrouver
un ordre et réorganiser le travail sur de nouvelles bases «qui
feront
cesser l’antagonisme des classes et assureront l’égalité sociale».
L’émancipation des travailleurs et la délégation communale doivent
assurer
le contrôle efficace des mandataires du peuple chargés par lui des
réformes
sociales. Ces réformes sociales sont: l’organisation du crédit, de
l’échange
et de l’association, afin d’assurer au travailleur la valeur intégrale
de son travail, c’est-à-dire la disparition du profit capitaliste;
l’instruction
gratuite, laïque et “intégrale”; les libertés des citoyens (réunion,
association, presse); l’organisation sur le plan communal de la police
et de l’armée. Le principe qui doit gouverner la société tout entière,
c’est celui qui organise le groupe et l’association. Il y a donc refus
de toute autorité imposée du dehors, que ce soit celle d’un
administrateur,
d’un maire ou d’un préfet, et contrôle permanent des élus 33.
Faire la paix avec la Prusse
équivaut
à
Le CC se prononça clairement le 19 mars pour la paix avec la Prusse: «Nous déclarons dès à présent être fermement décidés à faire respecter ses préliminaires afin d’arriver à sauvegarder à la fois le salut de la France républicaine et la paix générale» (Talès, p.59).
Or, cette résolution permettait la transformation de la guerre
impérialiste
en guerre civile, comme le souligne Lénine: «La transformation de
la guerre impérialiste actuelle en guerre civile est le seul mot
d’ordre
prolétarien juste, enseigné par l’expérience de la Commune»
(Oeuvres,
t 21 p.28).
Le CC va se mettre ainsi sur la défensive. Il va lever l’état de siège pour organiser les élections, alors qu’il a la force des fusils, donnant à Thiers du répit pour réorganiser l’armée à Versailles avec l’aide de Bismarck qui s’y trouve. Ainsi alors que la contre-révolution s’enfuit de Paris, les bataillons fédérés ne tentent rien contre elle. Dès l’après-midi du 18 mars, le CC offre le commandement de la Garde nationale et donc des forces de Paris à l’ancien commandant de vaisseau déjà mal noté par ses supérieurs, Charles Lullier, alcoolique et vantard. Qu’il y ait eu trahison ou incompétence, ce dernier est d’une extraordinaire inertie.
Loin de fermer les portes de Paris, il laisse passer tous les fuyards (Jules Ferry ne s’enfuit que le 18 dans l’après midi). Il laisse toutes les issues à l’armée dont de nombreux soldats, échappant à l’emprise de leurs chefs et au contact de la population parisienne, auraient pu passer du côté de la Garde nationale. Il ne fait pas occuper immédiatement les forts abandonnés par les troupes de Thiers: les forts d’Ivry, de Bicêtre, Montrouge, Vanves et Issy ne seront ocupés que le 19 et 20 mars; quant au fort du Mont Valérien, point stratégique pour défendre Paris et alors Versailles, il y songera après que Vinoy ait enfin décidé Thiers à y mettre une garnison suffisante. Au sujet du Mont Valérien, Lissagaray écrit (p.132): «Pendant trente six heures, l’imprenable forteresse était restée vide. Le 18 au soir, après l’ordre d’évacuation envoyé par M.Thiers, elle n’avait que vingt fusils et les chasseurs de Vincennes internés pour avoir manifesté à la Bastille (...) Députés et généraux suppliaient M.Thiers de faire réoccuper le Mont-Valérien. Il refusait opiniâtrement, soutenant que ce fort n’a aucune valeur stratétique. Enfin Vinoy, harcelé par les députés, parvint à lui arracher un ordre, le 20, à une heure du matin. Une colonne fut expédiée et le 21, à midi, un millier de soldats occupaient la forteresse...».
Enfin, Lullier n’ordonne pas la marche sur Versailles, alors sans défense. Vu son incompétence et ses discours “ambigus”, il sera démis le 22 34. Tous les fuyards ont quitté tranquillement Paris, et Versailles se sera organisée!!
Lullier est remplacé par trois hommes pleins d’énergie: le patriote exalté Brunel, et les deux blanquistes Eudes et Duval. Ils déclarent tout de suite: «Le temps n’est plus au parlementarisme; il faut agir et punir sévèrement les ennemis de la République. Tout ce qui n’est pas avec nous est contre nous. Paris veut être libre». Duval demande la marche sur Versailles, mais la majorité du CC préfère se cantonner dans la préparation des élections, dans l’administration de Paris plutôt que d’affronter les réalités de la guerre civile.
Le CC s’en est donc remis aux militaires pour réorganiser la Garde nationale et la défense de Paris, contrairement à Thiers qui a gardé en main la direction des opérations. C’est pour Paris la source de sanglants déboires et de rivalités avec les sorties mal organisées, tragiques, et ceci malgré le dévouement de Flourens, Eudes, Duval, La Cécilia, Brunel. Ces deux derniers avec Dombrowski, Wroblewsli, tous anciens officiers, seront les meilleurs tacticiens de l’armée de la Commune. Malheureusement l’organisation générale de la défense et de la stratégie confiées à Lullier, Cluseret et Rossel, est désastreuse! Seule une direction politique déterminée aurait donné à la Commune l’État major qui lui a manqué.
Marx écrit dans “La guerre civile...” (p.36): «Dans sa
répugnance
à accepter la guerre civile engagée par Thiers avec sa tentative
d’effraction
nocturne à Montmartre, le CC commit cette fois cette faute décisive en
ne marchant pas aussitôt sur Versailles, alors entièrement sans
défense,
et en mettant ainsi fin aux complots de Thiers et de ses ruraux. Au
lieu
de cela, on permit encore au parti de l’ordre d’essayer sa force aux
urnes
le 26 mars, jour de l’élection de la Commune» 35.
Si le CC ainsi que la population parisienne, nullement effrayée et d’excellente humeur, oublient la guerre civile, la bourgeoisie, elle, résiste hargneusement.
A Paris, les quartiers du centre des 1° et 2° arrondissements deviennent le lieu de ralliement de tous les mécontents. La“résistance” comprend d’abord tous les inconsolables de l’Empire, puis les bourgeois et intellectuels républicains (les intellectuels du quartier latin, les étudiants de l’école polytechnique, de la faculté de médecine condamnent ce CC sans mandat populaire), les maires élus qui se réclament être une Commune légale et sont donc hostiles à de nouvelles élections municipales, les députés de Paris (dont Louis Blanc, Tolain, membre de l’AIT, et Clémenceau), et quelques chefs de bataillons. Les positions de ces résistants sont très variables: les uns sont pour trouver une solution de conciliation entre Paris et Versailles, les autres font la politique de Thiers et cherchent à faire gagner du temps à la contre-révolution.
Des manifestations ont lieu le 21 et le 22 mars et prennent comme but la place Vendôme, où est installé l’état-major de la Garde Nationale dirigé par Bergeret. Le 21, l’incident est bénin, les manifestants acclament l’Assemblée et l’ “ordre”, et sont dispersés. Le 22, il est plus sérieux: les manifestants malmènent des gardes nationaux, une fusillade éclate et fait des dizaines de morts du côté des “amis de l’ordre”, surtout des bonapartistes.
Le CC a beaucoup de mal à briser la résistance des maires aux élections. Dès le 19 mars, on annonce que les maires, les députés de la Seine et des chefs de bataillons sont réunis à la mairie du 3ème arrondissement et délibèrent sur la convocation des électeurs. Le CC, conciliant, leur fait savoir qu’il est prêt à négocier, débutant ainsi d’interminables négociations. Quatre hommes sont délégués: Varlin, Moreau, Jourde, et Arnold. Ils vont céder sur tous les points, dont celui de remettre l’Hôtel de Ville aux parisiens. Le comité des 20 arrondissements s’oppose à la transaction, et le CC est obligé de désavouer ses délégués. De leur côté, les maires sont très mal accueillis par l’Assemblée de Versailles qui ne veut pas d’une conciliation.
Le CC repousse les élections au 26 mars et fait occuper les mairies;
celles du centre résistent. Brunel s’y rend avec 600 gardes nationaux
et, après négociation, les mairies et les gardes nationaux qui s’y
trouvent
barricadés se rendent et pactisent. En fait, cette “résistance”,
non soutenue par Versailles, s’effondrera bientôt.
c. L’attitude des
internationalistes
A part Varlin, membre du CC, les internationalistes parisiens ont jusque là gardé une grande réserve, bien que la presse bourgeoise les accusât d’être responsables des évènements.
Le 23 mars, une réunion mixte de l’Internationale parisienne et de
la Chambre fédérale des sociétés ouvrières a lieu. Un manifeste, qui
doit renforcer le CC de “toute notre force morale”, réclamé par
Frankel,
est rédigé dans la nuit, ainsi qu’un appel à la révolution communale
et un programme politique. Les internationaux parisiens cherchent donc
maintenant à donner au mouvement insurrectionnel un programme, des
lignes
directrices: l’organisation du crédit, de l’échange; l’instruction
gratuite
et laïque; le droit de réunion et d’association; la liberté de la
presse;
l’organisation municipale de la police, de la force armée, de l’hygiène
et des statistiques.
7. Conclusion
SIGNIFICATION DES RÉVOLUTIONS DU 4 SEPTEMBRE 1870
«Le prolétariat assuma deux tâches, l’une nationale, l’autre sociale : libération de la France de l’invasion allemande et libération socialiste des ouvriers du joug du capitalisme. La réunion de ces deux tâches constitue le trait le plus original de la Commune» (Lénine, “Les enseignements de la Commune”, 1908, tome 13, p.499).
Si dès le 4 septembre, la bourgeoisie, consciente de la partie qui s’engageait, trahissait sans vergogne sa nation par la comédie de la défense, les autres classes avec à leur tête le prolétariat, c’est-à-dire la Révolution, se dressaient courageusement contre l’ennemi. C’est la Révolution qui avait pris le pouvoir laissé vacant et qui redonnait de la vigueur et de la vie à cette France décomposée et dégénérée par 18 ans de parasitisme bonapartiste. Elle régénéra la France en deux étapes: d’abord avec la République qu’elle imposa le 4 septembre à la bourgeoisie; le gouvernement bourgeois qu’elle laisse en place tiendra donc sa légalité des ouvriers. Ensuite, en instituant la Commune, organisme juvénile, édifié sur les ruines du vieil État, cadavre putride dont elle débarrasse la société française.
Dans le premier essai de rédaction de “La guerre civile...”, Marx écrit (p.181): «Le seul pouvoir légitime en France est donc la révolution elle-même dont le foyer est à Paris. Cette révolution n’avait pas été faite contre Napoléon-le-petit, mais contre les conditions sociales et politiques qui avaient engendré le second Empire. Elles avaient reçu leurs formes définitives sous ce régime et elles n’auraient laissé de la France qu’un cadavre si elles n’avaient pas été renversés par les forces régénératrices de la révolution accomplie par la classe ouvrière française».
Le 18 mars, la révolution ouvrière parisienne releva le gant que lui tendait la bourgeoisie, pour empêcher «l’escamotage de la République que préparaient les princes d’Orléans et leur chargé d’affaires, M. Thiers». Marx explique pourquoi les Parisiens ne devaient pas reculer: «Les canailles bourgeoises placèrent les Parisiens devant l’alternative ou de relever le défi ou de succomber sans combat. Dans le dernier cas, la démoralisation de la classe ouvrière aurait été un malheur bien plus grand que la perte d’un nombre quelconque de “chefs” (...) De quelque façon que les choses tournent dans l’immédiat, le résultat sera un nouveau point de départ d’une importance historique mondiale» (Lettre à Kugelmann du 17 avril 1871).
Les Parisiens ne reculèrent pas.
«Portant sur son visage les traits de sa longue famine, sous la menace même des baïonnettes prussiennes, la classe ouvrière parisienne s’élança d’un bond à l’avant-garde du progrès» (“La guerre civile...”, p.251), même si ce ne devait être qu’un assaut au ciel!
Le 18 mars, le peuple parisien révolutionnaire comprit la trahison
de la bourgeoisie et s’affirma «le champion dévoué jusqu’au
sacrifice
de la France» (id. p.33) qu’il fallait régénérer en détruisant
les conditions politiques et sociales qui avaient engendré le second
Empire
et avaient mûri jusqu’au pourrissement. Mais pour cela, le prolétariat
révolutionnaire visait plus loin que la République qui n’était qu’une
étape. Le 18 mars révéla la véritable signification de la République;
le peuple parisien fit de son réflexe de défense le premier acte d’une
révolution sociale, d’une révolution communiste.
«Oui, messieurs, la Commune entendait abolir cette propriété de
classe, qui fait du travail du grand nombre la richesse de quelques
uns.
Elle visait à l’expropriation des expropriateurs (...) Mais, c’est du
communisme, c’est l’ “impossible” communisme!» (Marx, “La guerre
civile en France”, 1871). «Que l’on compare les Parisiens se
lançant
à l’assaut du ciel aux esclaves célestes du Saint Empire romain
prusso-germanique
avec ses mascarades posthumes, ses relents de caserne, d’Eglise, de
féodalité
racornie, et surtout de philistinisme» (Marx à Kugelman, 12 avril
1871). «Nous sommes dans d’autres conditions, parce que grimpés sur
les épaules de la Commune de Paris et profitant du long développement
de la social-démocratie allemande, nous pouvons voir clairement ce que
nous faisons en créant le pouvoir des Soviets» (Lénine, VIIème
Congrès du PC(b)R, 6-8 mars 1918). «La Commune de Paris de 1871 a
été la première tentative historique – faible encore – de domination
de la classe ouvrière» (Trotsky, “Terrorisme et Communisme”,
1919).
1. L’ORGANISATION DE LA
COMMUNE
«La Commune, forme positive de la révolution contre l’Empire et
les conditions de son existence, fut d’abord instaurée dans les villes
du midi de la France et fut sans cesse proclamée au cours des actions
spasmodiques durant le siège de Paris (...) Elle finit par triompher le
26 mars, mais elle n’est pas née ce jour-là. C’était l’invariable but
de la révolution ouvrière» (Marx, 1er essai de “La guerre
civile...”)
a. Les résultats des
élections
du 26 mars:
Il y eut 229 000 votants sur 485 000 inscrits. Cette différence s’explique par la diminution de la population parisienne par suite de la guerre, du siège, des départs en province et à Versailles. La participation électorale fut plus forte dans les quartiers ouvriers que les quartiers bourgeois. Les faubourgs votèrent à bulletin ouvert. Comme toutes les couches de la population pouvaient voter, de nombreux adversaires du CC furent élus et seulement 13 membres du CC furent choisis. Les suffrages s’étaient donc détournés de ces “inconnus” si pressés de partir, mais la nouvelle assemblée comprenait une majorité de révolutionnaires issus du CC, des clubs rouges, des sociétés ouvrières, de l’Internationale, des partis républicains liés au jacobinisme, etc.
Le 28 mars, lors d’une cérémonie sur la place de l’Hôtel de Ville,
le CC des fédérés de la Garde nationale proclame la Commune et lui
remet
ses pouvoirs. La Commune s’installa au Château d’eau. 92 conseillers
municipaux
furent donc élus au suffrage universel dans les divers arrondissements
de Paris (les 11 et 18ème arrondissements en élurent 7 chacun, et le
16ème 2) pour une population qui était en temps normal de 1 873 713
habitants 36.
Composition sociale de la Commune
En dehors des bourgeois du parti de l’Ordre qui donneront rapidement
leur démission, il y a une très grande variété de conditions sociales
et aussi d’opinions. Il y a beaucoup de petits-bourgeois (employés
comptables,
médecins, instituteurs, hommes de loi, de nombreux publicistes) et des
ouvriers qui seront au nombre de 25 (E.Varlin, le relieur, le commis
Benoît
Malon, le menuisier Pindy, le blanchisseur Grêlier, le chapelier
Amouroux,
le ciseleur Theiz, le fondeur Duval, le mécanicien Assi, le tourneur
Langevin,
etc...). Ces ouvriers étaient plus des artisans que des ouvriers de la
grande industrie, et la moitié appartenait à l’Internationale.
22 membres de la Commune ne voudront pas siéger et démissionneront; ils seront remplacés lors des élections complémentaires du 16 avril (très peu de Parisiens se déplaceront; seront élus: l’aventurier Cluseret, l’ouvrier Eugène Pottier 37, l’ouvrier membre de l’Internationale Serraillier, E.Dupont, membre du Conseil général de l’Internationale à Londres, le peintre Gustave Courbet, Charles Longuet, futur gendre de Marx, Garibaldi, Viard, etc.).
Les trois principaux groupes politiques sont constitués par les internationalistes, les blanquistes et les jacobins.
Les internationalistes sont plus d’une quinzaine: l’infatigable E.Varlin, le proudhonien B.Malon, l’ouvrier hongrois Léo Frankel, qui avait fondé à Paris une section allemande de l’AIT et qui connaît Marx et ses théories dont il sera un des représentants au sein de la Commune, l’ouvrier proudhonien Thiez, l’ouvrier Dupont, Pindy, l’ouvrier mécanicien Assi qui avait déjà organisé les grèves au Creusot en 1870 dont il sera un des représentants au sein de la Commune, Langevin, Avrial, les ouvriers bijoutiers Combault et Camelinat, Serraillier, le journaliste proudhonien Charles Longuet, l’employé de commerce blanquiste Cournet qui rejoint l’AIT en 1871, le blanquiste Edouard Vaillant; l’ouvrier blanquiste Duval déjà membre du CC comme Varlin; Babick. Ces membres de l’Internationale, à l’exception de quelques blanquistes, sont attachés aux doctrines de Proudhon: mutuellisme et autonomie des communes. Ils s’opposent à l’utilisation de la phraséologie et des méthodes de 1793 (comité de salut public) et font figure de modérés.
Les blanquistes étaient principalement représentés par Eudes, Duval (membre de l’AIT), Ranvier, Ferré, Rigault, hommes d’un courage, d’une énergie et d’un fanatisme révolutionnaire incontestable. Ils ont le culte de 1793, et, dressés à la discipline d’après les principes de l’ancienne charbonnerie, ils ont besoin de leur chef qui leur fera défaut (Blanqui fut arrêté le 17 mars 1871, alors que malade, il se reposait loin de Paris).
Les jacobins constituaient la majorité de la Commune. Moins agissants que les blanquistes, ils étaient attachés comme eux aux traditions de 1793. Ils rêvaient d’une révolution politique qui devait amener à sa perfection le régime démocratique. Ce groupe était dominé par le vieux républicain de 60 ans, Charles Delescluze; combattant des journées de 1830 et 1848, il en imposait à tous les révolutionnaires. Il y avait aussi le rhéteur vaniteux, le “mauvais génie de la Commune”, Félix Pyat; il travailla à diviser, soulevant les plus violentes polémiques, aiguisant les rivalités personnelles les plus sordides; il s’en prit aux membres de l’Internationale – à ce propos, Marx écrivit une lettre aux internationalistes pour les aider à répondre aux attaques de Pyat.
Cette division est en fait très schématique 38,
car il existait d’autres personnages qu’il est difficile de ranger dans
un des blocs. Le proudhonien et fouriériste de 72 ans Beslay à qui l’on
confia la présidence de la première séance de la Commune: chef
d’industrie,
il fut un des fondateurs de l’AIT dont il se sépara bien vite; il
s’occupa
avec trop d’esprit conciliateur des relations avec la Banque de France.
Le savant de tendance blanquiste Gustave Flourens qui avait fait la
connaissance
de Marx en 1870; Don Quichotte qui avait déjà fait de folles tentatives
sous l’Empire, il périt lors de la sortie du 3 avril. Le millionnaire
blanquiste Tridon, favorable aux idées de l’Internationale. Le
journaliste
proudhonien Vermorel, qui avait été en relation avec Engels et qui fut
calomnié durant la Commune par Pyat; il mourut volontairement sur une
barricade. Il y eut aussi le grand peintre Gustave Courbet, le
comptable
Jourde, proudhonien, qui militera par la suite dans le Parti Ouvrier
Français,
l’ancien officier blanquiste Brunel, l’écrivain Jules Vallès 39,
l’auteur de la chanson “Le temps des cerises” Jean Baptiste Clément.
Conflit entre majorité et minorité
Cette séparation entre deux parties nettes se fit à partir du 28
avril,
lors de la discussion sur la création ou non d’un comité de Salut
Public. 22 membres de la Commune, dont les internationalistes
auxquels
s’étaient joints entre autres Tridon, Vallès, Courbet, Vermorel et
Jourde,
formèrent cette minorité qui selon Lissagaray comprenait les membres
les plus intelligents, les plus éclairés de la Commune, mais opposés
à la création du comité de Salut Public. Ce fut entre majorité et
minorité
une querelle fastidieuse qui alla s’exaspérant. Ses membres ayant été
évincés des services, la minorité annonça même son retrait de la
Commune
en publiant un manifeste dans les journaux à la grande joie des
versaillais
qui jubilaient de ces querelles. Elle se reprendra le 17 mai, mais trop
tard
b. La Commune, corps
législatif
et exécutif
Dès le 29 mars, la Commune décide de former des commissions correspondant aux différents ministères que le CC avait pris en mains, à l’exception de celui des cultes, qui est supprimé.
Aux Finances, se trouvent Varlin – qui, infatigable, passera des Finances aux Subsistances, puis à l’Intendance – et Jourde, proudhonien de droite et homme intègre. Ce dernier s’efforça de percevoir les recettes traditionnelles et d’éviter le gaspillage. L’intermédiaire entre la Banque de France et la Commune fut le proudhonien Beslay, bien trop modéré. Bourgin écrit: «Pour neuf semaines de gouvernement et en entretenant une armée de 170 000 hommes en moyenne, le CC et la Commune ont dépensé un peu plus de 46 300 000 francs, dont 16 696 000 ont été fournis par la Banque, le reste par les services remis sur pied, en particulier l’octroi qui rapporta 12 millions»... alors que Thiers tirait sur la Banque de France pour 257 630 000 francs de traites!!
Aux Subsistances, Viard dut prendre des mesures rapides car Paris avait souffert de la faim durant le siège. Il taxa le pain et la viande, et, en liaison avec les mairies, il assura le contrôle des halles et des marchés.
La Sûreté Générale fut confiée au blanquiste Rigault, qui y fit avec ses amis un gachis turbulent, et par ses “razzias de soutanes” exaspéra les catholiques. Cet étudiant de 24 ans prit comme chef de cabinet Da Costa qui n’avait que 20 ans.
L’Hôtel des Postes fut confié à l’ouvrier ciseleur Theiz, qui le trouva en grand désarroi. Il fit fonctionner régulièrement le service des postes dans Paris, et “se débrouilla” pour la province.
Camélinat, monteur en bronze, fit fonctionner la Monnaie; Alavoine, l’Imprimerie Nationale; Avrial, la Direction du matériel d’armement; Combault et Faillet, le service des contributions directes et indirectes. A la Justice, l’avocat blanquiste Protot décida la gratuité du recours au juge, le principe de leurs élections et la suppression de la vénalité des officiers de justice: ces mesures avaient pour but d’enlever de l’exercice de la justice son caractère de classe.
Le délégué à l’instruction publique fut Edouard Vaillant 40. Il parvint à réorganiser les écoles primaires désertés par les religieux. Il promut l’école gratuite et laïque, tenta de valoriser l’éducation des filles et l’enseignement professionnel. Courbet fut nommé président de la Fédération des artistes.
A la commission du Travail, de l’Industrie et de l’Echange, Léo Frankel était assisté d’une commission d’initiatives composée d’ouvriers; avec lui, travaillaient aussi B.Malon, Theiz, Dupont, Avrial. Ils prirent des mesures sociales concernant le Mont de Piété, les loyers, le travail de nuit.
La commission des Relations Extérieures, présidée par le modéré J.B Paschal-Grousset, journaliste et écrivain, n’eut qu’un rôle insignifiant, et ne fit rien pour se tenir en liaison avec l’étranger. Le délégué n’envoya que quelques émissaires en province. Des proclamations furent envoyées par ballon pour les départements dont celle de la journaliste Léo André qui s’adressait ainsi aux paysans: «Frère, on te trompe. Nos intérêts sont les mêmes».
La Délégation à la guerre fut d’abord confiée au délégué Eudes, au commandant militaire de la Préfecture de Paris Duval et au commandant de la Place, Bergeret. Puis la Commune adjoignit à Eudes le général aventurier Cluseret.
La machine administrative de Paris fonctionna ainsi avec 10 000
employés
au lieu des 60 000 précédents. La Commune était donc à la fois
un corps législatif et exécutif. Le pouvoir exécutif fut confié à
une commission exécutive qui devait donner l’impulsion à ce
système;
elle comprenait: Eudes, Tridon, Vaillant, Duval, Pyat, Bergeret. Mais
le
premier mai, la situation militaire s’aggravant, la création d’un Comité
de Salut Public fut décidé, malgré l’opposition de la minorité.
c. Son programme: une
République
universelle!
Le 19 avril, dans une déclaration, la Commune explique ses buts au peuple français. Elle y parle de la reconnaissance et de la consolidation de la République, une république non centralisée, mais qui serait le résultat de la fédération de toutes les communes de France. Suit l’énumération des droits de la Commune: vote du budget communal, organisation de la magistrature, de la police, de l’enseignement, recrutement de tous les fonctionnaires par élection ou concours 41, administration des biens appartenant à la Commune, garantie absolue de la liberté individuelle, de la liberté du commerce, de la liberté du travail; intervention permanente des citoyens dans les affaires de la Commune, organisation de la Garde Nationale par l’élection des chefs. La Commune refuse la centralisation «despotique, inintelligente, arbitraire ou onéreuse» qui a été imposée à la France par la monarchie, l’Empire et la république parlementaire. «Nous avons la mission d’accomplir la révolution moderne, la plus large et la plus féconde de toutes celles qui ont illuminé l’histoire».
Evidemment, la Commune chercha à faire connaître ce programme au reste de la France, mais elle n’en eut guère le temps. Les Parisiens affirmaient la fraternité des peuples, concevaient le monde entier uni sous la forme républicaine: «Vive la République universelle!» fut acclamé durant la Commune et inscrit au bas des proclamations.
La révolution parisienne reçut en effet l’appui de nombreux étrangers. Deux mille d’entre eux grossirent les rangs des Communards: majoritairement des Belges (la Légion fédérale belge occupa des fonctions importantes dans l’armée communarde), Luxembourgeois, des Italiens (Almicare Cipriani 42, Giuseppe Garibaldi43), des Polonais (les généraux de la Commune, Dombrovski et Wroblevski 44 d’une bravoure exceptionnelle) qui étaient nombreux à Paris après l’échec de l’insurrection nationale de 1863 contre le tsarisme, des Hongrois (Léo Frankel 45) mais aussi quelques Suisses, Russes (Elisabeth Dmitrieff, corespondante de Marx), etc... que la Commune considérait comme «des soldats de la République universelle».
Dans “La guerre civile...”, Marx écrit: «La Commune annexait
les travailleurs du monde entier (...) La Commune a admis tous les
étrangers
à l’honneur de mourir pour une cause immortelle (...) La Commune a fait
d’un ouvrier allemand son ministre du travail (...) La Commune a fait
aux
fils héroïques de la Pologne l’honneur de les placer à la tête des
défenseurs de Paris».
Ce ne sont pas seulement ces hommes de la Commune qui sont au
pouvoir,
mais le peuple de Paris tout entier à travers les sections de l’AIT,
les
chambres syndicales qui reprennent vie, les coopératives, les comités
de vigilance des arrondissements coiffés par le CC des 20
arrondissements,
les clubs.
Participation des femmes et des enfants
En effet, les femmes participèrent à cette révolution. Louise Michel 46 participa au 18 mars à Montmartre et avec elle, bien d’autres femmes et enfants. Jules Vallès, dans “Le Vengeur” du 12 avril 1871, décrit avec enthousiasme: «J’ai vu trois révolutions, et, pour la première fois j’ai vu les femmes s’en mêler avec résolution, les femmes et les enfants. Il semble que cette révolution est précisément la leur et qu’en la défendant, ils défendent leur propre avenir».
Est alors créé le premier mouvement féminin de masse avec “L’Union des femmes pour la défense de Paris et les secours aux blessés” fondée par la russe de 20 ans, Elisabeth Dmitrieff 47, correspondante de Marx, et Nathalie Lemel, bretonne de 45 ans, ouvrière relieuse; la journaliste Léo André 48 et bien d’autres... Le proudhonisme, dont de nombreux membres de la Commune se réclamaient, était pourtant adepte de la femme au foyer!!
La Commune proposa pour les femmes l’instruction publique, à travail égal-salaire égal. Elles participèrent à la gestion communale, à des ateliers autogérés. La Commune officialisa l’union libre, conférant à la famille constituée hors mariage sa première reconnaissance légale. Enfin la Commune bannit la prostitution considérée «comme l’exploitation commerciale de créatures humaines par d’autres créatures humaines».
Les femmes se manifestèrent dans les comités de vigilance des citoyennes 49, les clubs, et Louise Michel réclama le droit des femmes à défendre la révolution les armes à la main.Le Journal Officiel du 13 avril 1871 publia une adresse des citoyennes à la Commission exécutive de la Commune de Paris où les femmes réclamaient le droit de combattre et de mourir pour la défense de la Commune, la possibilité d’obtenir des salles dans les mairies pour se réunir, et d’avoir de l’argent pour imprimer des avis.Elles furent si actives que le journal anglais “The Times” s’exclama: «Si la nation française ne se composait que de femmes, quelle terrible nation ce serait!» (Lissagaray, p.216)
Beaucoup d’ouvrières avaient été contraintes par la misère effroyable qui suivit la guerre franco-prussienne et le siège de Paris à se prostituer pour survivre. Mais durant la Commune, elles se firent cantinières, ambulancières, barricadières, soldats sur les remparts, employées des hôpitaux, ou bien elles traquaient les réfractaires.
Durant la semaine sanglante, les femmes combattirent farouchement.
Arthur Rimbaud, qui écrivit en mai 1971 d’autres hymnes désespérés à la Commune de Paris, les glorifia avec sa Jeanne-Marie 50 et JB Clément dédia le “Temps des cerises” à Louise, l’infirmière de la Fontaine-au-roi (rue du 10ème arrondissement) qui était à ses côtés pour défendre la barricade 51. Le dévouement des enfants et des adolescents fut tout aussi extraordinaire. Ils donnèrent leur vie joyeusement sur les barricades et devant les pelotons d’exécutions; les témoignage de leur héroïsme sont nombreux.
Chez les Versaillais, les communardes suscitèrent la haine: elles
furent
qualifiées de pétroleuses (elles allumèrent des incendies), et
Alexandre Dumas fils, auteur du tristement célèbre drame de “La dame
aux Camélias”, osa écrire: «Nous ne dirons rien de leurs femelles
par respect pour toutes les femmes à qui elles ressemblent quand elles
sont mortes»!!
Composition sociale des insurgés
Les statistiques des individus arrêtés, faites par la justice militaire, permettent de se faire une idée de l’insurgé de 1871, et de confirmer, s’il le fallait, que les insurgés sont principalement des ouvriers52.
Ainsi, parmi les arrêtés du gouvernement de Thiers au cours et après la semaine sanglante, on compte:
8% d’employés; 8% de petits commerçants, petits rentiers, membres de professions libérales; 5% de domestiques.
15% de journaliers; 16% d’ouvriers rudes du bâtiment; 12% d’ouvriers plus qualifiés du métal. Il s’agit là de la masse des insurgés.
Enfin des artisans des vieux métiers parisiens (8% du meuble, 8% du
vêtement, 10% des travaux d’art) dont beaucoup constituèrent des
cadres,
des officiers et sous-officiers de la Commune.
2. L’HISTOIRE DE LA COMMUNE
26 mars-28 mai 1871
«Quand la Commune de Paris prit la direction de la révolution
entre
ses mains; quand de simples ouvriers, pour la première fois, osèrent
toucher au privilège gouvernemental de leurs “supérieurs naturels”,
les possédants (...) le vieux monde se tordit dans des convulsions de
rage à la vue du drapeau rouge, symbole de la république du travail,
flottant sur l’Hôtel de Ville» (Marx, “La guerre civile...”,
p.47).
La première tentative du complot des négriers pour abattre Paris fut de faire occuper la ville par les Prussiens; mais elle échoua devant le refus de Bismarck qui attendait une heure meilleure pour intervenir. La seconde, celle du 18 mars, avait abouti à la déroute de l’armée et à la fuite à Versailles du gouvernement et de l’administration.
A Versailles, la bourgeoisie, et son nabot Thiers, prépara
méthodiquement
sa prochaine attaque. Il fallait trouver une armée, couper Paris de la
province et, pour gagner du temps, simuler des négociations.
L’armée de la contre-révolution
Les restes des régiments de ligne étaient faibles en effectifs et
peu sûrs. Les pressants appels de Thiers aux provinces furent
accueillis
par un refus pur et simple. La Vendée seule fournit une poignée de
chouans
qui combattaient sous un drapeau blanc aux cris de: Vive Jésus, vive le
Roi! Thiers fut donc forcé de rassembler en toute hâte une bande
bariolée
composée de matelots, de fusiliers-marins, de zouaves pontificaux, des
gendarmes de Valentin, des sergents de ville et mouchards de Pietri.
Mais
cette armée eut été ridiculement impuissante sans les rapatriements
de prisonniers de guerre impériaux que Bismarck lâchait au
compte-goutte,
juste assez pour attiser la guerre civile et garder le gouvernement de
Versailles assujetti à la Prusse. Cette armée péniblement réunie
restait
si fiable à Thiers qu’elle était surveillée par la police
versaillaise!!
«Alors que le gouvernement de Versailles, dès qu’il eut recouvré
un peu de courage et de force, employait les moyens les plus violents
contre
la Commune; alors qu’il supprimait la libre expression d’opinion par
toute
la France, allant jusqu’à l’interdiction des réunions aux délégués
des grandes villes; alors qu’il soumettait Versailles et le reste de la
France à un espionnage qui surpassait de loin celui du Second Empire;
alors qu’il faisait brûler par ses gendarmes, transformés en
inquisiteurs,
tous les journaux imprimés à Paris et qu’il décachetait toutes les
lettres
venant de Paris et destinées à Paris; alors qu’à l’Assemblée Nationale,
les essais les plus timides de placer un mot en faveur de Paris étaient
noyés sous les hurlements (...) étant donné la conduite sanguinaire
de la guerre par les Versaillais hors de Paris et leurs tentatives de
corruption
et de complot contre Paris» (p.50). la Commune affectait d’observer
toutes les convenances et les apparences du libéralisme, comme en
pleine
paix. Car Thiers avait bien compris qu’il était fondamental que Paris
soit coupée de la province (le 13 mai, des délégués de la Ligue d’union
républicaine qui se rendaient à Bordeaux, furent arrêtés; une réunion
à Lyon de délégués fut interdite...). Des Communes éclataient par
intermittence dans les différentes grandes villes de France; seule
Paris
aurait été capable de les relier entre elles, de diriger la révolution
à l’échelle nationale.
Des députations et des adresses pleuvaient de toutes parts sur Thiers, réclamant la réconciliation avec Paris: les maires et députés de Paris le 25 mars, les francs maçons le 10 avril, les délégués des chambres syndicales le 11. Brunet, député de la Seine, le 20 avril proposa de nommer une commission de pacification, proposition qui fut accueillie par une explosion de haine des ruraux; la Ligue d’union républicaine des délégués du commerce et de l’industrie le 6 mai, et d’autres délégations de province tentèrent d’intervenir... Tant et si bien que Dufaure, ministre de la justice de Thiers, demanda le 23 avril aux procureurs de traiter «le mot de conciliation comme un crime»!
En fait, Thiers se préoccupa dès le début d’accompagner sa guerre de bandits contre Paris d’une petite comédie de conciliation qui devait servir plus d’un dessein. D’abord duper la province, puis tromper les éléments bourgeois de la Commune et gagner ainsi du temps; enfin donner aux républicains avoués de l’Assemblée nationale l’occasion de masquer leur trahison envers Paris.
Ainsi le 21 mars, comme il n’avait alors aucune armée,il déclara à l’Assemblée nationale que ô grand jamais il n’attaquerait Paris; le 27, qu’il était résolu à maintenir la République, mais il abattait la révolution communale à Lyon et à Marseille au nom de cette même République, alors que les beuglements de ses ruraux couvraient la simple mention de ce nom et que son Dufaure agissait en coulisses.
Dufaure, ce vieil avocat orléaniste, déjà là en 1839 sous Louis Philippe, en 1849 sous Louis Bonaparte, fit voter par l’Assemblée nationale une série de lois répressives qui devaient après la chute de Paris, extirper les derniers vestiges de liberté républicaine, abrogea la procédure des cours martiales et déposa une loi draconienne de déportation (la révolution de 1848 avait aboli la peine de mort qui fut ensuite remplacée par la déportation).
Enfin, Thiers se décida à organiser par tout le pays des élections
municipales pour le 30 avril, espérant, grâce aux intrigues de ses
préfets
et à l’intimidation policière que le verdict des provinces donnerait
à l’Assemblée, ce pouvoir moral et matériel dont il avait besoin pour
la conquête de Paris. A cette occasion, il joua le 17 avril une de ses
grandes scènes de conciliation en se présentant comme le défenseur de
la République attaquée par une “poignée” de conspirateurs parisiens,
poignée qu’il fallait, et elle seulement, punir! Mais les cervelles de
ruminants de ses ruraux ne comprenaient rien à son jeu et accueillirent
son discours sentimental avec d’autres beuglements de rage.
Les élections municipales du 30 avril
La France fit la sourde oreille au chant de sirène de Thiers! Sur les 700 000 conseillers municipaux élus par les 35 000 communes restantes, les légitimistes, orléanistes et bonapartistes n’en comptaient pas 8000. Pour achever la déconfiture, les conseillers municipaux nouvellement élus des villes de France menacèrent ouvertement l’Assemblée usurpatrice de Versailles d’une contre-assemblée à Bordeaux.
Thiers et ses ruraux se trouvaient donc dans une très mauvaise
posture.
Or Bismarck n’attendait qu’un mauvais moment de ce genre pour imposer
des
conditions de paix draconiennes et liquider la révolution parisienne
sans
trop de dommages pour la Prusse.
Bismarck manoeuvre la lâche bourgeoisie française
Bismarck somma Thiers d’envoyer à Francfort des plénipotentiaires pour le règlement définitif de la paix. Thiers obéit à l’appel du maître en dépêchant son fidèle Jules Favre et son ministre des finances Pouyer-Quertier. Ce dernier, filateur rouannais qui considérait la cession des provinces françaises comme un moyen de faire monter le prix de ses marchandises en France, était tout indiqué pour la besogne!
Les exigences de Bismarck – auxquelles les deux envoyés s’empressèrent de se plier – comportaient un raccourcissement des délais de paiement de l’indemnité de guerre, et l’occupation continue des forts de Paris par les troupes prussiennes jusqu’à ce que Bismarck se tînt pour satisfait de l’état de choses en France! La Prusse était ainsi reconnue comme l’arbitre suprême des affaires intérieures de la France! En retour, il offrait de libérer pour l’extermination de Paris, l’armée bonapartiste prisonnière, de prêter l’assistance directe des troupes de l’empereur Guillaume et il n’exigeait le paiement du premier versement de l’indemnité qu’après la “pacification” de Paris.
Le traité de paix fut signé le 10 mai et l’Assemblée de Versailles
le ratifia prestement le 18. Poussant un soupir de soulagement et plein
de reconnaissance à l’égard de son sauveur, la contre-révolution
française baisa les pieds de la contre-révolution allemande.
De même que le gouvernement bourgeois força le CC à assumer un rôle
gouvernemental en lui abandonnant Paris, de même en attaquant la
capitale
le premier, il força la Commune à prendre la voie belliqueuse. Le
pouvoir
militaire de la Commune se partageait entre trois personnes: le délégué
à la guerre Eudes auquel la Commune adjoignit l’aventurier Cluseret, le
commandant militaire de la préfecture de police Duval, et le commandant
de la Place Bergeret.
Après l’échec du 18 mars, le parti de l’Ordre dirigé par Thiers et qui avec l’aide de Bismarck avait reconstitué son armée (plus de 60 000 hommes) entreprit des opérations régulières contre Paris. Le 21 mars, Vinoy avait repris le fort du Mont Valérien que, dans la panique, Thiers avait abandonné.
Le 2 avril, les Versaillais attaquaient les fédérés conduits par
Bergeret lors d’une reconnaissance en direction de Courbevoie. Trop
inférieurs
en nombre, redoutant d’être coupés de Paris, les fédérés évacuèrent
Courbevoie et furent refoulés jusqu’au pont de Neuilly. Les gendarmes
de Versailles firent cinq prisonniers qu’ils fusillèrent au pied du
Mont
Valérien. Quand la nouvelle fut connue et que la nouvelle “le siège
recommence” courut à Paris, une même explosion vint de tous les
quartiers
et 50 000 hommes se rassemblèrent dans un cri unique: A Versailles! La
Commune se devait de réagir. La commission exécutive se réunit, afficha
une proclamation: “Les conspirateurs royalistes ont attaqué! (...)
Notre
devoir est de défendre la grande cité contre ces coupables agressions”.
En fait, la discussion était vive au sein de la commission. Duval,
Bergeret
et Eudes se prononcèrent énergiquement pour l’attaque; Tridon,
Vaillant,
Lefrançais, F.Pyat (qui criait depuis trois jours: A Versailles!...)
résistèrent,
adjoignirent Cluseret à Eudes, croyant mettre à la guerre un militaire
sérieux. Ce manque de cohésion explique en bonne partie l’échec de la
sortie du 3 avril: pas de plan sérieux, pas de coordination établie
entre
les différents officiers et entre eux et la Commune, pas de
détermination
à combattre énergiquement l’ennemi. Les quatre membres civils
demandèrent
aux généraux de présenter un état détaillé de leurs forces en hommes,
artillerie, munitions et transports. Mais les généraux partirent sans
ordre formel, lassés de ces atermoiements.
Marx écrivit à son sujet (“La guerre civile...”, premier essai, p.233): «La marche sur Versailles fut décidée, préparée et entreprise par le CC à l’insu de la Commune et même en opposition avec sa volonté nettement manifestée».
Le plan de sortie se fondait sur la certitude de la neutralité du Mont Valérien et sur l’illusion d’une “promenade” à Versailles sur trois colonnes qui devaient se rejoindre à un certain point: une de droite commandée par Bergeret assisté de Flourens avec 15 000 hommes se concentrait à Rueil pour attaquer Versailles par le nord, une de centre commandée par Eudes avec 10 000 hommes et une de gauche commandée par Duval avec 3 000 hommes. Les généraux expédièrent aux chefs de légion l’ordre de former des colonnes sur la rive droite et sur la rive gauche. Mais ces mouvements sans officiers d’état major expérimentés s’exécutèrent très mal. Beaucoup de bataillons étaient sans chefs depuis le 18 mars, les gardes nationaux sans cadres et les généraux improvisés sans expérience. Ils négligèrent les dispositions les plus élémentaires, ne réunirent ni artillerie, ni ambulances, oublièrent de faire un ordre du jour, laissèrent les hommes plusieurs heures sans vivres. Chaque fédéré prit le chef qu’il voulut. Beaucoup n’avaient pas de cartouches, croyant d’après les journaux à une simple promenade militaire, comme le raconte Lissagaray. Chacune de ces armées fut une cohue allant à l’aventure et dépourvue de tout. Des 100 000 dont on avait d’ailleurs parlé au début, on ne réussit à mobiliser que 23 000!
Pour la colonne de droite, le désordre commença dès que les premières canonnades du Mont Valérien, dont on était persuadé qu’il ne tirerait pas, commencèrent à pleuvoir; tandis que Bergeret était contraint de se replier vers Paris, le hardi Flourens continuait la marche sur Rueil, y trouvant une mort héroïque à l’arrivée des renforts envoyés par Vinoy. Une autre défaite frappa la colonne de gauche, incapable de répondre au feu de l’ennemi et donc contrainte à la retraite sur Chatillon; Duval y mourra au cri de “Vive la Commune!” face au peloton d’exécution des Versaillais. Enfin, la colonne du centre dut se retirer sur le fort d’Issy parce qu’impuissante à répondre à l’artillerie ennemie.
Pendant ce temps, la Commune tenait séance de 10 heures du soir à minuit, mais personne n’évoqua la sortie sur Versailles!
Au lieu de tirer des leçons de ce drame, de blâmer les auteurs des
erreurs, elle leur laissa toute liberté pour la conduite des opérations
militaires. Leur incurie, leur incapacité avaient été mortelles, mais
«la
Commune comprit qu’elle était responsable et que, pour être juste, elle
aurait dû s’accuser aussi» (Lissagaray, p.198).
Après ce désastre, l’ardeur des masses fut refroidie. La Commune perdit tous les hésitants et la défense parisienne renonça définitivement à l’offensive en se bornant à une tactique purement défensive. Cluseret devint ainsi le maître des destinées militaires de la Commune.
Cet officier formé à Saint Cyr, fils d’officier, ancien officier de la garde mobile qui en juin 48 avait écrasé les ouvriers révoltés sous les ordres de Cavaillac, qui s’engagea en Italie sous les ordres de Garibaldi, ensuite en Amérique, en Irlande, était devenu un général d’insurgés “professionnel”. Il rejoint l’AIT en 1868 et, à Lyon, le 28 septembre 1870, les émeutiers l’appelèrent; il vint avec Bakounine, fut acclamé, mais ne fit rien et disparut 53. Il fit une apparition à Marseille où il devint chef de la brève Commune de Marseille en novembre 1870. Le 30 mars il fut nommé chef de la Garde nationale et le 3 avril la Commune le délégua à la Guerre; mais il se garda bien d’empêcher la sortie du 3 avril qui devait discréditer ses rivaux.
Il utilisa l’art du bluff: il annonçait la réorganisation de l’armée fédérée à la presse,mais ne faisait rien. Il n’était là que pour enrichir sa carrière d’une nouvelle aventure. Dès son arrivée au ministère, il s’efforça d’éliminer toute une partie de la Garde nationale en formant pour les gardes nationaux mariés une “Garde nationale sédentaire”!
Il ne tenta aucune offensive sérieuse contre Versailles. Si l’on met
à part quelques coup de main dus à l’initiative de chefs comme
Dombrowski,
la défense de Paris apparut comme totalement passive.
La Commune ne tira pas de leçon de la sortie du 3 avril, hormis un décret sur les otages, pour répondre aux exécutions des Versaillais et qui ne fut pas appliqué. Les combats n’allèrent qu’en s’amplifiant. Le 7 avril, les Versaillais s’emparent du passage de la Seine à Neuilly sur le front ouest de Paris. Les bombardements de cette partie de Paris ne cessèrent pas, si bien que le 25 une suspension d’armes fut acceptée par Versailles pour permettre aux habitants de Neuilly (ce ne sont pas là les quartiers prolétariens!) d’évacuer leur localité. Le 8 avril, Mac Mahon avait été nommé chef de l’armée versaillaise. Le 26 avril, De Cissey et les troupes versaillaises occupaient les Moulineaux; le 27, ce fut le massacre de 4 fédérés faits prisonniers par les Versaillais à la Belle-Epine près de Villejuif. Le 28-29, des opérations versaillaises eurent lieu contre le fort d’Issy aux mains des fédérés, après avoir été abandonné un moment.
La Commission exécutive mise en place le 20 avril n’arrive pas à améliorer la situation interne et surtout militaire face aux Versaillais. Le 28 avril, Jules Miot, membre de la Commune, propose au Conseil de la Commune la création d’un Comité de Salut Public (imitant ce que les Montagnards de 1793 avaient fait pour faire face aux nombreux dangers qui menaçaient la République). Cette proposition rencontre l’opposition d’une minorité des élus de la Commune dont des internationalistes et autres. En effet le conseil fédéral des sections parisiennes de l’AIT voit dans ce comité un pouvoir dictatorial qui serait en opposition formelle avec les aspirations politiques démocratiques de la masse électorale de la Commune! Ce n’est que le 1er mai que le Comité est accepté par 45 voix contre 23.
Un comité de 5 membres est élu: Gabriel Ranvier, le seul d’une énergie véritable, Léo Meillet, Armand Arnaud, Charles Gérardin, Félix Pyat (qui démissionne le 5 mai); mais il ne valut guère mieux que la Commission exécutive. Le 8 mai un nouveau comité est élu avec des blaqnuistes ou des jacobins: Charles Delescluze (qui sera remplacé par Edouard Billioray le 10 mai), Emiles Eudes, Charles Gambon,
Le 1er mai, la Commune démet Cluseret, qui avait abandonné le fort d’Issy laissé sans troupes (il s’enfuira le 24 mai), et le remplace par le généreux colonel Louis Rossel, militaire de carrière, qui réessaye en vain de réorganiser l’armée des fédérés. Ce militaire, polytechnicien, avait rallié la Commune pour des raisons patriotiques. Il s’efforce de délimiter les responsabilités des chefs militaires comme Dombrowski, La Cécilia, Wrobleswski, Bergeret et Eudes. Mais il va négliger la défense intérieure de Paris, et se heurtant aux prétentions du CC, il préférera démissionner (il sera fusillé le 28 novembre).
Le Comité de Salut Public interfère avec les décisions du délégué
à la guerre, Louis Rossel. Il laisse le CC s’introduire dans les
services
de la guerre. En effet, dès le 30 mars, le CC de la Garde nationale a
repris de la vigueur et s’arroge à l’égard de la garde une autorité
singulière; le 1er avril, il réclame l’Intendance, le droit de nommer
le chef d’état major et depuis ce moment il ne cesse de prétendre à
l’administration de la guerre pour laquelle il constitue des
commissions
spéciales. La minorité de la Commune exigea sa dissolution,mais il
avait
l’appui de la majorité et du Comité de Salut public.
c. La victoire de la
contre-révolution
Paris n’eut jamais plus de 40 000 combattants auxquels il faut ajouter les femmes et les adolescents.
Thiers, au contraire, avec l’appui de Bismarck, avait renforcé son
armée: elle comptait 65 OOO combattants auxquels s’ajoutèrent 135 000
prisonniers libérés progressivement d’Allemagne. Cet avantage numérique
donna à partir de début mai aux Versaillais une supériorité décisive.
Ceci apparut dès le 23 avril quand Thiers rompit les négociations
entamées
par la Commune et visant à échanger des otages contre le seul Blanqui!!
Son langage, si prudent jusqu’alors, devint menaçant et brutal, et dès
que Mac Mahon lui assurât qu’il pourrait entrer sous peu dans Paris,
Thiers
ne parla plus à l’Assemblée de conciliation mais d’expiation complète!!
Dès les premiers jours de mai, Paris fut bombardée par les Versaillais et la lutte contre les troupes versaillaises ragaillardies absorba toutes les énergies de la Commune.
Sur le front sud, les Versaillais prirent par trahison le 3-4 mai la Redoute du Moulin-Saquet (à Vitry sur seine, à l’ouest de Paris); le 9, le fort d’Issy, assiégé, était détruit à coups de canon et occupé par les Versaillais. Dans une lettre à Jung du 10 mai, Engels estima que «les gaillards qui ont abandonné le fort d’Issy, sans même avoir été attaqués, méritent d’être fusillés. La situation militaire (de la Commune) s’est gravement détériorée à la suite de cet acte de lâcheté».
Las, Rossel donna sa démission et fut remplacé par le vieux jacobin Delescluze. Ce délégué civil connaissait mal les questions militaires. Dombrowski, ancien officier de l’armée russe, insurgé en Pologne, fut son meilleur collaborateur.
La situation de l’armée fédérée était plus que confuse. Paris fourmillait d’états majors puisqu’il n’y avait pas de tête: la délégation à la guerre, la Place, les généraux, chaque légion possédaient un état major! L’Intendance fut bien souvent un véritable chaos. Si bien qu’alors que l’armée versaillaise se renforçait, celle fédérée fondait, et l’inorganisation faisait que les bataillons dévoués restaient en ligne indéfiniment. Ainsi l’armée de la Commune n’opposait plus que 10 à 15 000 hommes à celles de Versailles qui en comptait plus de 100 000. Or il y avait dans Paris 120 000 gardes nationaux qui touchaient leur solde!
Le 13 mai, le fort de Vanves tomba.
d. La semaine sanglante: du
dimanche
21 mai
L’armée versaillaise de Mac Mahon, renforcée après le retour des prisonniers libérés par Bismarck, entra dans Paris sans tirer un coup de feu ni recevoir un seul obus le dimanche 21 mai par la Porte de Saint Cloud laissée sans défense par les fédérés, quand la trahison eut ouvert les portes de Paris au général Douayl! Les Prussiens qui occupaient les forts du nord et de l’est laissèrent les Versaillais s’avancer sur le terrain au nord de Paris, qui leur était interdit par l’armistice, leur permettant ainsi d’attaquer sur un large front que les Parisiens croyaient protégé par la convention, et qu’ils n’avaient de ce fait que faiblement garni de troupes. Aussi n’y-eut-il que peu de résistance dans la moitié ouest de Paris, la ville de luxe proprement dite. Elle se fit par contre plus violente à mesure que les Versaillais approchaient des quartiers ouvriers de la moitié est de Paris.
Thiers, voyant son armée toute prête d’un côté et les Prussiens
qui fermaient les yeux de l’autre côté, donna carte blanche aux cris
de: «Je serai impitoyable! L’expiation sera complète et la justice
inflexible»! La soldatesque sanguinaire se rua sur le Paris
révolutionnaire
pour perpétrer un abominable carnage. La cause de la justice, de
l’ordre
et de la civilisation bourgeoise devait triompher! Mac Mahon avec son
homme
de main, le général Galiffet, commença une reconquête méthodique de
Paris, par le feu des fusils, des canons et des incendies! Lors de leur
avancée, les Versaillais fusillaient tous ceux qu’ils prenaient les
armes
à la main.
La Commune se débat désespérément
Le soir du 21 mai, lorsque la Commune apprit l’entrée des
Versaillais,
elle leva la séance, se reposant sur le Comité de Salut Public qui
se contenta de couvrir les murs de proclamations et s’arrêta
brutalement
d’exister. Comme la Commune, le délégué à la Guerre, Delescluze,
renonça
à l’action au moment décisif. Le 22 au matin, il abdiqua son autorité
militaire et fit afficher: «Assez de militarisme (...) Place au
peuple,
aux combattants aux bras nus!». Comme l’écrit Lissagaray: «Au
lieu de 200 barricades stratégiques faciles à défendre, on en sema des
centaines impossibles à garnir»! La guerre des barricades, celle
que l’on fait chacun dans son quartier: une lutte désespérée enflamma
Paris! Et l’armée communale de se disperser ainsi dans les quartiers,
sans commandement centralisé. Le CC essaya d’intervenir, mais sans
effet:
la lutte se poursuivit au hasard, coup à coup, face à la machine de
guerre
versaillaise qui progressa volontairement lentement pour écraser
impitoyablement,
dans des combats exténuant pour les insurgés, le Paris révolutionnaire.
L’héroïsme du Paris révolutionnaire
Le Paris révolutionnaire se lança au combat avec l’énergie du désespoir, la générosité de celui qui ne se rend pas.
Il défendit sa révolution rue par rue, barricade par barricade
jusqu’à
succomber. Il utilisa l’incendie – au grand scandale de messieurs les
bourgeois qui, de leur côté, enflammaient Paris avec leurs obus; sans
parler des agents bonapartistes qui allumèrent des feux pour faire
disparaître
les traces de la gestion impériale – principalement pour se défendre
et ralentir l’avancée de l’ennemi. Ah, ces femmes “pétroleuses”
qui incendiaient Paris pour interdire aux troupes de Versailles ces
longues
avenues ouvertes expressément par Hausmann pour le feu de l’artillerie
bourgeoise, que de haine elles provoquèrent chez les bourgeois! Les
Tuileries,
le Conseil d’État, la Cour des Comptes, le ministère des Finances, la
Bibliothèque du Louvre, l’Hôtel de ville brûlèrent. Des incendies
furent
aussi allumés par les Communards à la préfecture de police et au palais
de justice dans le centre de Paris tout en épargnant Notre Dame et la
Sainte Chapelle!
Le 21, les Versaillais occupèrent ainsi le Trocadéro, les portes de Sèvres et de Versailles, le 15 ème arrondissement. Le 22, Douay et ses troupes étaient sur les Champs Elysées, de Cissey occupait la gare Montparnasse; le général Ladmirault longeait les boulevards extérieurs jusqu’aux portes d’Asnières et de Clichy et s’empara plus tard de la porte de Saint Ouen et de Montmartre. Des barricades étaient dressées aux Batignolles, rue de Rivoli, au carrefour de Chateaudun et dans le 9ème arrondissement.
Le 23, les Batignolles étaient prises et les buttes Montmartre proches encerclées par les Versaillais qui progressaient vers le centre et incendiaient les quais avec leurs obus.
Le 24, la Commune se transporta à la mairie du XI ème. Les Versaillais atteignaient ainsi la Banque de France et le Louvre, et massacraient les fédérés.
Le 25, les barricades étaient toujours défendues dans les 2 et 3 èmes arrondissements, de même que la Butte-aux-cailles et le Château d’eau. La dernière séance de la Commune eut lieu ce même jour à la mairie du 20 ème arrondissement alors située 136 rue de Paris (rue de Belleville). Y participent Ranvier, Trinquet, Ferré, Varlin, Vallès, Vaillant, Jourde. Delescluze est tué sur les barricades de la place du Château d’eau (place de la République).
Le 26, la Commune n’avait plus que trois ou quatre mille combattants pour faire face aux cinq corps d’armée de Mac Mahon. Les Prussiens avaient facilité le mouvement d’encerclement par le nord de Paris et formaient un cordon infranchissable de la Marne à Montreuil (le corps d’armée saxon laissa passer les jours suivants les communards traqués!). Les Versaillais prenaient Ménilmontant et Belleville. Et le 27, un îlot de résistance se maintenait dans le 20ème arrondissement, mais l’attaque des Versaillais contre le cimetière du Père Lachaise faisait 1600 tués ou fusillés au milieu des tombes; d’autres exécutions en masse à la mitrailleuse suivirent jusqu’au début juin.
Des insurgés dont Ferré tentèrent de répondre à cette violence en fusillant une soixantaine d’otages le 26 mai au 85 rue Haxo (34 gendarmes, 10 religieux dont l’archevêque Darboy, des mouchards furent fusillés contre le mur du 53 rue Borrego) que Varlin, Vallès et Serrailier essayèrent tout de même de sauver!!
Le 28 mai, les dernières barricades à Belleville, rue du Faubourg du Temple et rue Ramponneau, tombaient. Varlin y fut reconnu, lynché et fusillé. Vermorel, Delescluze, Dombrowski, Rigault, Vermorel, Lillière et tant d’autres étaient tués.
Le 29, le fort de Vincennes capitulait et ses neuf officiers furent fusillés sur le champ.
Les communards s’étaient battus avec la rage du désespoir faisant
des dégâts dans les rangs versaillais: 5 généraux tués et 10 blessés,
78 officiers tués et 420 blessés, 794 soldats tués et plus de 6000
blessés 54!
La vengeance fut terrible!
«Pour trouver un parallèle à la conduite de Thiers et de ses chiens, il nous faut remonter aux temps de Sylla et des deux triumvirats de Rome. Même carnage en masse, exécuté de sang froid, même insouciance, dans le massacre, de l’âge et du sexe; même système de tortures des prisonniers, mêmes proscriptions; mais cette fois d’une classe entière; même chasse sauvage aux chefs qui se cachent, de peur qu’un seul puisse s’échapper; mêmes dénonciations d’ennemis politiques et privés; même indifférence envers le carnage de gens entièrement étrangers à la lutte 55. Il n’y a que cette seule différence: les Romains n’avaient pas encore de mitrailleuses pour expédier en bloc les proscrits et ils n’avaient pas “la loi à la main”, ni sur les lèvres le mot d’ordre de ’civilisation ’» (Marx, “La guerre civile...”, p.58).
La rage des bourgeois en juin 1848 qui fit 3000 morts parmi les ouvriers ne fut qu’un jeu d’enfants comparée à l’indicible infamie de 1871 avec sa boucherie de dizaines de milliers de révolutionnaires – hommes, femmes et enfants. Le général De Gallifet se distingua par sa cruauté, qui fut bien supérieure à celle d’un Cavaignac. Le 9 juin, “Paris-journal” écrivait encore: «C’est au Bois de Boulogne que seront exécutés à l’avenir les gens condamnés à la peine de mort par la cour martiale. Toutes les fois que le nombre des condamnés dépassera dix hommes, on remplacera par une mitrailleuse le peloton d’exécution».
«Prés de 30 000 Parisiens furent massacrés par la soldatesque déchaînée, plus de 45 000 furent arrêtés, dont beaucoup devaient être exécutés par la suite; des milliers furent envoyés au bagne ou déportés. Au total, Paris perdit environ 100 000 de ses fils et parmi eux les meilleurs ouvriers de toutes les professions» (Lénine, tome 17, p.135).
Des charniers furent creusés au square Saint Jacques, au parc Monceau, au Père Lachaise (où se trouve “le mur des fédérés” contre lequel furent fusillés le 28 mai des centaines de fédérés). De mai 1871 à décembre 1874, il y eut 24 conseils de guerre pour 80 enfants, 132 femmes, 9950 hommes de la Commune, avec des condamnations aux travaux forcés, des déportations en enceinte fortifiée à Cayenne en Guyane ou en Nouvelle Calédonie, des condamnations à mort (Théophileié Ferré 56 et Louis Rossel furent exécutés). Certaines industries comme l’ameublement et la cordonnerie furent entièrement vidées de leurs ouvriers: «L’industrie parisienne, écrit Lissagaray, en fut écrasée».
Beaucoup de rescapés se réfugièrent à Londres, où le Conseil général de l’AIT s’occupa d’eux, en Belgique, en Suisse.
Evidemment l’AIT fut poursuivie dans toute l’Europe. En France, la loi de mars 1872 prévoyait la prison et l’amende à tout français affilié à l’Internationale. Désormais, la section française ne pouvait vivre que sous forme de société secrète et ne fut plus qu’un squelette.
L’amnistie de 1880 ramena en France les rescapés.
Gloire à la Commune, fourrier d’une société nouvelle!
Bismarck était satisfait; il contemplait les ruines de Paris et les cadavres des prolétaires parisiens. Pour lui, il s’agissait non seulement de l’extermination de la Révolution, mais aussi de l’extinction de la France, désormais décapitée, et par le gouvernement français même!
Marx s’exclame ainsi à la fin de “La guerre civile...”, à Londres
le 30 mai 1871: «Le Parti ouvrier, avec sa Commune, sera célébré
à jamais comme le glorieux fourrier d’une société nouvelle. Le souvenir
de ses martyrs est conservé pieusement dans le grand coeur de la classe
ouvrière. Ses exterminateurs, l’histoire les a déjà cloués à un pilori
éternel, et toutes les prières de leurs prêtres n’arriveront pas à
les racheter».
3. LA PROVINCE
57
La Commune de Paris ne fut pas un événement isolé dans la France du Second Empire. Des insurrections communalistes éclatèrent en Province, et certaines précédèrent celle de Paris. La situation révolutionnaire concernait donc toute la France, mais s’exprima le plus violemment à Paris qui, en tenant le rôle de coeur de la France, centralisa de ce fait toutes les énergies révolutionnaires et par conséquent toute la force de la vague révolutionnaire. La Commune de Paris fut l’épisode culminant d’un mouvement insurrectionnel dispersé qui dura presque un an: son aboutissement et sa fin. Le gouvernement provisoire, conscient du danger des mouvements provinciaux et de la liaison de ceux-ci avec celui de Paris, déléguera l’avocat Léon Gambetta, ardent républicain, pour ramener l’ordre en province. Ce dernier, patriote, fut contraint de subir la volonté capitularde du gouvernement Trochu, ayant en commun avec lui la peur du mouvement insurrectionnel. Ministre de l’Intérieur du gouvernement de défense nationale, il quitta Paris en ballon le 7 octobre avec deux autres ministres pour organiser à Tours puis à Bordeaux de nouvelles armées pour défendre Paris assiégé par les Prussiens, et calmer les agitations de la province. Il exécutait l’ordre du gouvernement de bloquer les élections communales en province et faire rester à son poste tout ce personnel bonapartiste qui sabotait la guerre et décourageait tous ceux qui affluaient pour “défendre la Patrie”. En février 1871, devant la victoire électorale des monarchistes et partisans de Thiers, il démissionna mais ne rejoignit point les révolutionnaires de la Commune. Il ne regagna Paris qu’en juin 1871!
Des Communes naquirent ainsi dans le sud-est, l’Isère, Saint
Etienne,
le Creusot, Limoges qui parfois ne durèrent que quelques jours.
A Marseille, la section de l’AIT fondée en 1867 à Marseille, sous influence bakouniste, était très organisée et active. Le bakouniste, typographe, André Bastelica, principal dirigeant de la section marseillaise de l’AIT, l’animait avec fougue. En mars 1870 eut lieu un congrès retentissant de l’AIT à Lyon avec la participation de Varlin, Bastelica et Bakounine, qui affirmait la volonté des fédérations d’intensifier l’action révolutionnaire. Le gouvernement impérial fit alors arrêter certains militants dont Varlin; Bastelica s’enfuit en Espagne.
Aux élections de 1869, l’apport de militants ouvriers avait assuré la victoire des candidats républicains. Marseille vota “non” au plébiscite bonapartiste du 8 mai 1870; à cette époque, Marseille était une ville florissante de 315 000 habitants, le plus grand port de France.
Après la proclamation de la République à Paris, s’installa le 5 septembre un pouvoir “populaire”; les idées de Commune révolutionnaire et de fédération y sont expérimentées dans une situation où les exigences de la défense nationale jouent un rôle déterminant. Cette Commune insurrectionnelle se constitua avec l’appui de la section de l’Internationale et de la garde civique formée le 4 septembre.
Le 14 septembre, à l’annonce de l’investissement de Paris par les Prussiens, des souscriptions pour la patrie en danger furent ouvertes; en quelques jours, 10 000 volontaires formèrent des corps francs. Le 8 septembre, l’Internationale déclarait: «Il faut briser la machine administrative et rendre l’initiative de l’action à toutes les communes révolutionnaires de France, appelées à former une nouvelle organisation en se fédérant entre elles pour la défense». Bastelica réclama un gouvernement du Midi s’appuyant sur les travailleurs, la levée en masse et l’impôt sur les riches! A la demande de l’Internationale, Bastelica rejoignit la Commune de Paris où il dirigea le service des contributions directes et indirectes. Il mourut, exilé en Suisse, en 1884 à l’âge de 39 ans.
La Ligue du Midi fut constituée avec 14 départements en vue de la défense nationale. Elle eut pour capitale Marseille. Léon Gambetta s’opposa à la Ligue, car il s’opposait à toute autonomie des provinces et surtout à toute rupture avec la bourgeoisie!
Une Commune révolutionnaire fut proclamée à Marseille le 31 octobre 1870: «C’est au salut de la France toute entière que la France méridionale veut travailler». Elle nomma Cluseret qui venait d’arriver après l’échec de la Commune à Lyon, commandant de la Garde nationale et général en chef. Mais cette Commune s’effondra le 3 novembre. Le 14 novembre, de nouvelles élections municipales permirent la victoire de la liste modérée: Alphonse Gent, ami de Gambetta, républicain, réussit à faire prévaloir la politique du gouvernement de Défense nationale.
Gambetta déclara aussitôt la Ligue du Midi illégale et celle-ci s’effondra dans le découragement général. L’annonce de la révolution du 18 mars 1871 à Paris fut le signal d’une nouvelle insurrection et une Commune fut proclamée le 23 mars sous l’impulsion de Gaston Crémieux, avocat républicain, qui contrairement à son ami Gambetta, n’abandonna pas la Commune (il sera fusillé le 30 novembre 1871). La bourgeoisie, en abandonnant la ville aux communards, appliqua la tactique de Thiers à l’égard de Paris. La répression, dirigée depuis Aubagne, le Versailles de Marseille, y fut tout aussi impitoyable. Deux bataillons d’infanterie fraternisèrent avec les insurgés. Une batterie de canons bombarda la ville depuis Notre-Dame-de-la-Garde, rebaptisée par les communards Notre-Dame-de-la-Bombarde! La ville demeura jusqu’en 1876 en état de siège.
Il y eut d’autres soulèvements à Narbonne, à Toulouse où Thiers
envoya Keratry, l’ancien préfet de police du 4 septembre, pour
reprendre
la ville le 27 mars.
La chute de l’Empire fut bien accueillie à Grenoble où fut décidée la levée d’une compagnie de francs-tireurs formée de volontaires après la capitulation de Sedan pour défendre la République. Des bataillons étrangers vinrent aussi offrir leurs services. Un envoyé de Gambetta essaya par ailleurs de mettre sur pied une armée des Alpes à partir des bataillons de gardes nationaux. Cette compagnie de francs-tireurs dauphinois se battit dans l’est sous les ordres de Giuseppe Garibaldi. Ce dernier avait été appelé sous l’impulsion de Gambetta en 1870 par les comités de défense nationale. Le 25 et 26 novembre 1870, avec ses deux fils, à la tête de 10 000 tirailleurs français de l’Armée des Vosges, il remportait la victoire de Dijon contre les Prussiens!
Dans la plupart des villes et des villages se formèrent des bataillons de gardes nationaux qui réclamèrent des armes à la préfecture. L’Isère rejoignit la Ligue du Midi, toujours en vue de l’organisation de la défense nationale.
A Lyon, le 4 septembre, une insurrection éclatait. Michel Bakounine, arrivé le 15 dans la ville, s’efforça de prendre la direction du mouvement. Mais son intervention et ses prises de position ne firent que souligner les divergences avec les partisans de Marx au sein de l’AIT qui se concluront par la séparation des anarchistes de l’Internationales en 1872.Marx, dans une lettre à Beesly du 19 octobre 1870, (“La Commune”, p.109), s’en prit violemment à Bakounine et Cluseret:
«Sous la pression de la section de l’Internationale, on proclama la République avant même que Paris n’ait fait ce pas. On forma aussitôt un gouvernement révolutionnaire – la Commune – composé en partie d’ouvriers appartenant à l’Internationale, en partie de républicains radicaux de la bourgeoisie. On abolit immédiatement les octrois, et ce avec raison (...) L’action lyonnaise eut aussitôt un effet sensible à Marseille et Toulouse, où les sections de l’Internationale sont fortes. Mais les ânes de Bakounine et de Cluseret arrivèrent à Lyon et gâchèrent tout. Comme tous deux appartenaient à l’Internationale, ils eurent hélas suffisamment d’influence pour fourvoyer nos amis. Ils s’emparèrent de la mairie – pour peu de temps – et proclamèrent les lois les plus insensées sur l’abolition de l’État et autres bêtises du même genre. (...) Pour ce qui est de Cluseret, il se comporta à la fois en fou et en lâche. Tous deux ont quitté Lyon après leur échec».
Dès le 19 mars, des réactions de sympathie se manifestèrent en faveur de Paris. La Commune fut proclamée à Lyon le 22. Garibaldi fut nommé général de la Garde nationale. Mais cette Commune se désagrégea le 25.
Dans l’ensemble, la population ouvrière de l’Isère mena à la fin
de l’Empire des luttes importantes pour l’amélioration de ses
conditions
de vie, mais ne put soutenir la Commune de Paris. Les républicains de
tendance radicale contribuèrent largement à désamorcer les actions en
faveur de Paris en lançant les travailleurs dans des campagnes de
pétitions
adressées à Versailles et en condamnant les actions plus
révolutionnaires.
4. DES MESURES POUR M
«La grande mesure de la Commune, ce fut sa propre existence et
son
action» (Marx, “La guerre civile...”, p.50).
a. Les mesures de la Commune
à
Paris
La Commission du Travail,
La plupart de ces mesures furent prises par la Commission du Travail, de l’Industrie et de l’Echange créée le 21 avril par la Commune. Elle avait à sa tête le bijoutier d’origine hongroise, Léo Frankel, membre de l’Internationale. Cette commission était composée presque exclusivement d’ouvriers et de membres de l’AIT; elle s’adjoignit une commission d’initiatives formée de travailleurs, et en liaison avec les chambres syndicales.
Cette commission dut faire face à deux urgences: améliorer la condition des travailleurs et procurer un emploi aux chômeurs qui s’étaient multipliés durant le siège (sur 600 000 ouvriers parisiens, à peine plus de 100 000 travaillaient).
Pour l’amélioration des conditions des travailleurs, les membres de la commission se heurtèrent à la tendance majoritaire des élus de la Commune qui estimaient ne pas avoir à intervenir dans les questions sociales; et à ceux qui insistaient pour que l’on s’entendît avec les patrons, Franckel répondait: «Je n’ai pas accepté d’autres mandats ici que celui de défendre le prolétariat, et quand une mesure est juste, je l’accepte et je l’exécute sans m’occuper de consulter les patrons». La commission agit surtout au coup par coup. Elle s’occupa ainsi du cas des ouvriers employés à l’édification des barricades (en effet, contrairement aux barricades “spontanées” de 1848, les plus grandes en 1871 ont été érigées par des entrepreneurs qui employaient des terrassiers payés à la journée qui réclamèrent une augmentation de salaire...). De la même façon ce furent les ouvriers boulangers qui s’adressèrent à la commission pour demander la suppression du travail de nuit et des “placeurs”. Mais il est tout de même remarquable que le livret ouvrier, qui faisait du travailleur un éternel surveillé (le Second Empire avait en effet rétabli en 1854 le livret ouvrier institué par Louis XV puis par Napoléon 1er, c’est-à-dire un livret d’embauche détenu par le patron et sur lequel on pouvait suivre le déroulement de la “carrière” du travailleur. Ce dernier était tenu de le présenter à la moindre requête des forces de police) ne fut pas supprimé par la Commune. Il fallut attendre pour cela 1890!
Pour lutter contre le chômage, on ouvrit dans chaque arrondissement des registres pour les offres et demandes d’emploi. Un bilan des ateliers abandonnés par les patrons fut dressé par les chambres syndicales et ces ateliers furent remis, matériel et machines compris, aux mains des ouvriers qui y étaient employés après qu’ils se furent organisés en coopératives. Environ dix ateliers furent confisqués au profit des ouvriers. Ce furent pour la plupart des fabriques travaillant pour l’armée. Les marchés de la Commune (habillement militaire) furent donnés de préférence aux corporations ouvrières.
Franckel confia l’organisation du travail des femmes à Paris à Elisabeth Dmitrieff qui fonda l’Union des femmes; les ouvrières se réunirent pour nommer des délégués afin des créer des chambres syndicales, puis une chambre fédérale des travailleurs.
Le mouvement des sociétés ouvrières, ralenti depuis juillet 1870,
reprit son activité avec 34 chambres syndicales, 43 associations de
production.
Les mesures en faveur de la classe ouvrière: communisme contre proudhonisme!
1. Suppression du travail de nuit des ouvriers boulangers et suppression des “placeurs”, véritables parasites auxquels ils étaient obligés de s’adresser pour trouver du travail. Les placements furent affectés aux mairies.
2. Interdiction de la pratique en usage chez les employeurs qui consistait à réduire les salaires des ouvriers en prélevant des amendes sous de multiples prétextes, «procédé par lequel l’employeur combine dans sa propre personne les rôles de législateur, de juge et de bourreau, et empoche l’argent par dessus le marché» (“La guerre civile...”, p.50).
3. Remise aux associations d’ouvriers, sous réserve de compensation aux propriétaires, de tous les ateliers et fabriques qui avaient fermé.
Engels, dans son introduction de 1891 à “La guerre civile...”, explique: «En 1871, même à Paris, ce centre de l’artisanat d’art, la grande industrie avait tellement cessé d’être une exception que le décret de loin le plus important de la Commune instituait une organisation de la grande industrie, et même de la manufacture, qui devait non seulement reposer sur l’association des travailleurs dans chaque fabrique, mais aussi réunir toutes ces associations dans une grande fédération, bref une organisation, qui, comme Marx le dit très justement dans La Guerre civile, devait aboutir finalement au communisme, c’est-à-dire à l’exact opposé de la doctrine de Proudhon. Et c’est aussi pourquoi la Commune fut le tombeau de l’école proudhonienne du socialisme».
4. Mont-de Piété: arrêt de la vente des objets déposés et les objets d’une valeur inférieur à 20 francs pouvaient être dégagés gratuitement. La Commune en ordonna la suppression, car il constituait une exploitation privée des travailleurs.
5. Les mairies ne devaient pas faire de distinction entre les femmes dites illégitimes, les mères et les veuves des gardes nationaux en ce qui concernait l’indemnité de 75 centimes.
6. Emancipation intellectuelle: réorganisation de l’instruction
publique
en écartant l’élément religieux et clérical, en nommant une commission
pour l’organisation de l’enseignement primaire et professionnel dirigée
par Edouard Vaillant. La Commune ordonna que tous les instruments de
travail
scolaire furent donnés gratuitement par les instituteurs qui les
recevaient
des mairies.
Autres mesures d’ordre général
1. Remise totale du loyer des trois derniers termes jusqu’en avril sans contrepartie pour les propriétaires, aucun congé donné par les propriétaires ne fut valable pour les trois mois à venir; réquisition de locaux abandonnés en faveur d’habitants dont les appartements ont été endommagés par les bombardements.
2. Les échéances (paiement des effets de commerce venus à échéance): toute poursuite pour échéance fut suspendue, tous les effets de commerce durent être remboursés sur trois ans, sans que cette dette portât intérêt. Ces mesures contrecarrèrent les effets des lois de Dufaure sur les baux et les effets de commerce qui avaient entraîné la banqueroute de la plupart des commerçants de Paris.
3. En ce qui concernait la Justice: les notaires, huissiers,
commissaires-priseurs, greffiers et autres officiers judiciaires furent
transformés en fonctionnaire de la Commune, recevant d’elle un salaire
fixe comme les autres travailleurs.
La Commune désigna l’avocat Rigault, procureur, pour faire le travail
le plus pressant du Tribunal civil de la Seine, dont les magistrats
s’étaient
enfuis, jusqu’à la réorganisation des tribunaux au suffrage universel.
9. Création d’une commission en vue de fonder des universités libres qui ne soient plus des parasites de l’État.
10. Autres mesures:
– La conscription était abolie; l’armée permanente et la police,
instruments matériels du pouvoir de l’ancien gouvernement, étaient
supprimés.
La Garde nationale était proclamée la seule force armée.
– La séparation de l’Église et de l’État était déclarée avec
la suppression du budget des cultes, la transformation de tous les
biens
ecclésiastiques en propriété nationale. Les prêtres devaient vivre
de l’aumône des fidèles.
– Le traitement d’un employé de la Commune, donc aussi de ses membres,
ne pouvait dépasser 6000 francs (soit un salaire ouvrier).
– Toutes les place de l’administration, de la justice, de
l’enseignement
étaient soumises au choix des intéressés par élection au suffrage
universel
et à la révocation à tout moment par ces mêmes intéressés. La Commune
cassa et arrêta ses généraux dès qu’ils étaient suspectés de négliger
leurs devoirs.
– Les deux guillotines furent brûlées, et on libéra tous les
prisonniers
politiques incarcérés comme suspects sous le régime bonapartiste après
une enquête.
– La colonne de la place Vendôme, coulée par Napoléon 1er avec
les canons conquis après la guerre de 1809 sur les armées russes et
autrichiennes
sur l’emplacement d’une statue de Louis XIV détruite en 1792, «comme
un symbole de force brute et de fausse gloire, une affirmation du
militarisme,
négation du droit international, une insulte permanente des vainqueurs
aux vaincus», fut démolie le 16 mai 1871. Elle fut reconstruite en
1873 (le peintre Gustave Courbet qui avait demandé cette
démolition
dès le 14 septembre 1870 fut contraint de rembourser une partie des
frais!!)
– La Commune valida l’élection de Léo Frankel, membre allemand
de l’Internationale, qui fut élu membre de l’Exécutif de la Commune en
tant que délégué de la Commission des Échanges et du Travail, car le
drapeau de la Commune était celui de la République universelle.
– La Commune abolit les serments politiques et professionnels.
– La Commune décida la destruction du monument dit “Chapelle expiatoire
de Louis XVI”, élevée en réparation de l’exécution de Louis XVI,
car elle était une insulte permanente à la première révolution et une
protestation perpétuelle de la réaction contre la justice du peuple.
Le désarmement des gardes nationaux “loyalistes” (obéissant au gouvernement de Versailles) par le CC de la Fédération de la Garde nationale après la manifestation réactionnaire de la place Vendôme le 21 mars fut décidé.
Le décret sur les représailles du 6 avril ne fut malheureusement
jamais
mis à exécution. Pour répondre au massacre des fédérés perpétrés
par les Versaillais, la Commune avait fait arrêter 64 otages:
l’archevêque
de Paris, Darboy, le curé de la Madeleine, tout le personnel du collège
des jésuites, les desservants de toutes les églises principales;
certains
avaient conspiré avec Versailles, les autres avaient essayé de sauver
les biens de l’Église des mains de la Commune. L’archevêque de Paris
et le curé de la Madeleine écrivirent à Thiers pour appuyer la demande
de la Commune d’échanger les 64 otages contre Auguste Blanqui, mais le
chef de la contre-révolution se garda bien d’accepter. Il savait
qu’avec
Blanqui, il donnerait une tête à la Commune. Les fédérés ne fusillèrent
pas un seul prisonnier, officier, soldat ou otage jusqu’au 23 mai, et
ceci
malgré le massacre, l’assassinat des gardes nationaux faits prisonniers
par Versailles. Ce n’est que le 24 mai, dans le tumulte et le désespoir
que 52 otages furent exécutés. Les rigueurs de la guerre ne furent
appliquées
qu’à trois espions, et après jugement.
b. La Commune et les classes
sociales
La révolution communale représentait toutes les classes qui ne vivent pas du travail d’autrui. Les mesures de la Commune, en contrecarrant les lois de Dufaure, sauvèrent de la banqueroute la petite-bourgeoisie des boutiquiers, négociants, commerçants. Cette dernière avait rejoint le camp du prolétariat car elle le reconnaissait comme le seul capable de la sauver du désastre.
La Commune s’adressait aussi aux paysans. Elle leur disait: «Notre victoire est votre seule espérance». Toutes les lois faites par le parti de l’ordre 59 entre janvier et février 1850 furent des mesures avouées de répression contre les paysans. La Commune publia le 28 avril une proclamation au peuple des campagnes. Seule la Commune pouvait résoudre en faveur du paysan le problème de la dette hypothécaire «qui pesait comme un cauchemar sur son lopin de terre» (Marx, “La guerre civile...”, p.48). «Les ruraux savaient que trois mois de communication entre le Paris de la Commune et les provinces amèneraient un soulèvement général des paysans; de là leur hâte anxieuse à établir un blocus de police autour de Paris comme pour arrêter la propagation de la peste bovine» (p.49).
Et Marx de conclure que «la Commune était donc bien la
représentation
véritable de tous les éléments sains de la société française, et
par suite le véritable gouvernement national».
c. L’organisation nationale
des
communes et la centralisation
Marx, dans “La guerre civile...”, p.42, écrivait: «La Commune
de Paris devait, bien entendu, servir de modèle à tous les grands
centres
industriels de France. Le régime de la Commune une fois établi à Paris
et dans les centres secondaires, l’ancien gouvernement centralisé
aurait,
dans les provinces aussi, dû faire place au gouvernement des
producteurs
par eux-mêmes (...) la Commune remplacée par une milice populaire à
temps de service extrêmement court. Les communes rurales de chaque
département
devaient administrer leurs affaires communes par une assemblée de
délégués
au chef-lieu du département, et ces assemblées de département devaient
à leur tour envoyer des députés à la délégation nationale à Paris;
les délégués devaient être à tout moment révocables et liés par
le mandat impératif de leurs électeurs. Les fonctions, peu nombreuses,
mais importantes qui restaient encore à un gouvernement central, ne
devaient
pas être supprimées (...) mais devaient être acquittées par des
fonctionnaires
communaux, autrement dit strictement responsables. L’unité nationale ne
devait pas être brisée, mais au contraire organisée par la Constitution
communale (...) le suffrage universel devait servir au peuple constitué
en communes, comme le suffrage individuel sert à tout autre employeur
en quête d’ouvriers et de personnel de direction pour son affaire».
La Commune était donc un monde agissant, exécutif et législatif à la fois. Elle réalisa “le gouvernement à bon marché” en abolissant ces deux grandes sources de dépense: l’armée permanente et le fonctionnarisme d’État. Elle employa deux moyens infaillibles pour éviter la transformation d’un gouvernement, serviteur de la société, en maître de celle-ci: les fonctionnaires furent élus au suffrage universel.
Les fonctionnaires étaient aussi révocables; la Commune ne rétribua tous les services que par le salaire que recevait les autres ouvriers mettant le holà à l’arrivisme. Mais tous ces points n’étaient que le corollaire d’un but final: l’émancipation économique du Travail, la société communiste!
Mais sans avoir avoir atteint ce but, la Commune avait déjà instauré un monde nouveau à Paris!
«Quel changement prodigieux, en vérité, que celui opéré par
la Commune de Paris! Plus la moindre trace du Paris dépravé du Second
Empire (...) ’Nous n’entendons plus parler, disait un membre de la
Commune,
d’assassinats, de vols, ni d’agressions; on croirait vraiment que la
police
a entraîné avec elle à Versailles toute sa clientèle conservatrice’.
Les cocottes avaient retrouvé la piste de leurs protecteurs (...) A
leur
place, les vraies femmes de Paris avaient reparu, héroïques, nobles et
dévouées comme les femmes de l’antiquité. Un Paris qui travaillait,
qui pensait, combattait, saignait, oubliant presque, tout à couver une
société nouvelle, les cannibales qui étaient à ses portes, radieux
dans l’enthousiasme de son initiative historique!
«En face de ce monde nouveau à Paris, voyez l’ancien monde à
Versailles – cette assemblée de vampires de tous les régimes défunts,
légitimistes et orléanistes, avides de se repaître du cadavre de la
nation – avec, en appendice, des républicains d’avant le déluge,
sanctionnant
par leur présence dans l’assemblée la rébellion des négriers (...)
C’était donc elle, cette Assemblée, la représentante de tout ce qui
était mort en France (...) Paris toute vérité, Versailles, tout
mensonge;
et ce mensonge exhalé par la bouche de Thiers!» (“La guerre
civile...”,
p.51-52).
5. MARX, ENGELS ET
L’ATTITUDE
DE L’AIT FACE
a. Les faiblesses du mouvement
ouvrier
français
Dès 1869, dans une lettre à Kugelmann du 3 mars, Marx écrivait: «En France, un mouvement très intéressant a lieu. Les Parisiens se remettent bel et bien à étudier leur passé révolutionnaire récent et se préparent ainsi à la nouvelle entreprise révolutionnaire qui se rapproche».
Et à Engels le 14 juillet: «J’ai passé une semaine à Paris où, soit dit en passant, la croissance du mouvement saute aux yeux».
Ce réveil de la classe ouvrière française, Marx et Engels le jugent sans se faire d’illusion, car le mouvement reste sous l’emprise des proudhoniens et des blanquistes. Malgré le développement des sections de l’AIT en France, ils savent que les ouvriers français, bercés toujours par des illusions démocratiques et nationalistes, et qui «sortent tout juste du bas empire» (Engels à Marx le 10 août 70), ont encore beaucoup à apprendre et que ce serait folie que de vouloir actuellement renverser Bonaparte.
Déjà en 1866, Marx, après le 1er Congrès de l’AIT à Genève, dans une lettre à Kugelmann du 9 octobre, parle ainsi des membres de la section française: «Messieurs les Parisiens avaient la tête pleine de phrases proudhoniennes les plus creuses (..); ils dédaignent toute action révolutionnaire surgissant directement de la lutte des classes, tout mouvement social centralisé, donc réalisable aussi par des moyens politiques (par exemple, la diminution légale de la journée de travail) sous prétexte de liberté, d’antigouvernementalisme ou d’individualisme anti-autoritaire. Ces messieurs, qui depuis 16 ans, ont supporté et supportent tranquillement le despotisme le plus vil, prônent en fait une vulgaire économie bourgeoise, mais enjolivée d’idéalisme proudhonien».
De même, le 11 férier 70, dans une lettre à Marx, Engels dénonce l’absence de chefs prolétariens: «Les chefs “sérieux” du mouvement sont vraiment trop sérieux. C’est véritablement étrange. La provision de cerveaux, dont le prolétariat a bénéficié des autres classes, semble depuis lors totalement tarie, et cela dans tous les pays. Il semble que les ouvriers doivent désormais faire de plus en plus les choses eux-mêmes».
Et lorsque la tournure prise par les évènements militaires dès les premiers jours de la guerre fait apparaître la révolution en France comme inévitable, Marx note toujours que la classe ouvrière française n’est pas préparée aux tâches qui lui incombent, ce dans une lettre à Engels du 8 août 1870: «Si une révolution éclate à Paris, la question est de savoir s’ils ont les chefs pour offrir une résistance sérieuse aux Prussiens. On ne peut dissimuler que 20 ans de farce bonapartiste ont terriblement démoralisé. On n’a guère le droit de compter sur l’héroïsme révolutionnaire. Qu’en penses-tu?».
Engels pensait de même lorsqu’il condamne, dans une lettre à Marx du 15 août, le chauvinisme dont est atteint une partie du prolétariat: «Badinguet 60 n’aurait pu mener cette guerre sans le chauvinisme de la masse de la population française, des bourgeois, petits-bourgeois, paysans et des prolétaires du bâtiment que Bonaparte a créé dans les grandes villes, un prolétariat issu de la paysannerie, impérialiste et haussmannien. Tant qu’on n’aura pas réussi à tordre le cou à ce chauvinisme,il n’y a pas de paix possible entre l’Allemagne et la France. On pouvait attendre d’une révolution prolétarienne qu’elle effectue ce travail; mais depuis qu’il y a la guerre, il ne reste plus aux allemands qu’à le faire eux-mêmes et tout de suite» (“La Commune”, 10/18, p.59-60).
Et dans leur correspondance avec les révolutionnaires français et leur analyse des situations, Marx et Engels craindront toujours les susceptibilités chauvinistes des Français.
Marx et Engels sont donc bien pessimistes au sujet du prolétariat
français,
et s’en remettent au prolétariat allemand. La classe ouvrière allemande
a, en effet, au cours des dernières années, marqué plus de capacité
d’organisation, plus de réceptivité au socialisme scientifique. Les
ouvriers
français sont forts de leur passé révolutionnaire, mais l’absence de
théorie scientifique va faire sentir ses effets déplorables: ils sont
trop imbus de préjugés démocratiques et leurs représentants
(proudhoniens
et blanquistes) n’ont pas dépassé le niveau du socialisme utopique.
b. Face à la guerre
franco-prussienne
La victoire prussienne
renforcerait
Il s’agit pour l’Allemagne de régler enfin le problème de son unité nationale, permettant ainsi au prolétariat allemand de s’organiser sur le plan national et donc d’avoir une force beaucoup plus considérable. Engels, dans sa lettre à Marx du 15 août 1870, l’explique, mettant par ailleurs clairement en évidence que ce qui préoccupe les marxistes, ce n’est pas l’intérêt des bourgeoisies mais des prolétariats nationaux dans cette guerre: «Si l’Allemagne triomphait, le bonapartisme français serait fichu en toute occurrence; les sempiternelles chamailleries autour de la réalisation de l’unité allemande étant enfin écartées, les ouvriers allemands pourraient s’organiser à l’échelle nationale, ce qu’ils ne pouvaient faire jusqu’ici, et les ouvriers français – quelque soit le gouvernement issu de ce bouleversement – auraient certainement les coudées plus franches que sous le bonapartisme. Toute la masse du peuple allemand et toutes les classes ont reconnu qu’il y allait avant tout de l’existence nationale et elles ont aussitôt réagi».
La victoire prussienne renforcerait donc non seulement le
prolétariat
allemand, mais aussi celui français; s’engager dans une guerre de
défense
de l’Allemagne en formation contre l’impérialisme français, concourir
à battre Napoléon de l’extérieur était donc pour les ouvriers allemands
la façon pratique de prouver leur internationalisme en aidant le
prolétariat
français à se débarrasser du parasite bonapartiste.
Une guerre défensive allemande
Ils l’appuyèrent déjà dans la 1ère Adresse du Conseil Général sur la guerre franco-allemande du 23 juillet 1870; et en septembre 1870, Marx écrivait au Comité social-démocrate de Brunswick: «Tant que les armées de Napoléon menaçaient l’Allemagne, notre devoir d’Allemand était la guerre défensive, la guerre pour l’indépendance de l’Allemagne».
Aussi, Marx et Engels condamnèrent-ils les députés socialistes W.Liebknecht et A.Bebel qui préconisaient l’abstention; Engels, toujours le 15 août 70, écrivait à Marx: «Il me semble impossible que, dans ces conditions, un parti allemand aille prêcher comme le fait Wilhem l’abstention pure et simple et fasse passer des considérations secondaires avant la considération principale».
Marx explique ainsi l’affaire au Conseil Général du 26 juillet 1870: «Au parlement de l’Allemagne du nord, deux membres de notre Association, Liebknecht et Bebel, se sont abstenus de voter les 120 000 000 de crédits de guerre en donnant pour raison, dans une déclaration écrite, qu’ils ne pouvaient les voter parce qu’il s’agissait d’une guerre dynastique et qu’un vote favorable eut impliqué qu’ils fassent confiance au premier ministre, tandis qu’un vote hostile eut été interprété comme favorable aux plans criminels de Napoléon III» (in “La Commune”, 10/18, p.287).
Les députés lassalliens avaient voté pour, et l’attitude des deux députés socialistes se heurta à une vive hostilité à l’intérieur de leur propre fraction, notamment de la part du comité exécutif du parti ouvrier démocrate socialiste, le comité de Brunswick. Après que la guerre eut pris un tour impérialiste, en novembre 1870, ils votèrent contre les crédits et furent d’ailleurs arrêtés.
Toujours dans sa lettre à Marx du 15 août 70, Engels avait bien précisé les limites de leur soutien à la guerre défensive: se joindre au mouvement national dans la mesure où il se limite à la défense de l’Allemagne; souligner la différence entre les intérêts nationaux de l’Allemagne et les intérêts dynastiques et prussiens; s’opposer à toute annexion de l’Alsace-Lorraine 61 (une campagne en faveur de cette annexion se développait en Allemagne); agir en faveur d’une paix honorable dès l’instauration à Paris d’un gouvernement républicain non chauvin.
Le Conseil Général de Londres trouva donc juste de donner aux ouvriers allemands, lorsque la guerre éclata, le mot d’ordre de “défense de la patrie”, mais à condition que cette guerre ne perdit pas son caractère défensif, qu’une paix honorable soit conclue avec la France. Marx, dans sa seconde Adresse du 9 septembre 1870, affirmait clairement: «La classe ouvrière allemande a appuyé résolument la guerre – qu’elle n’avait pas la possibilité d’empêcher – comme guerre pour l’indépendance de l’Allemagne et la libération de la France et de l’Europe du cauchemar pestilentiel du Second Empire».
Et au Comité de Brunswick le 22 août 70: «Si les vainqueurs
allemands
concluent une paix honorable avec la France, la guerre russo-allemande
qui en suivra fera absorber la Prusse dans l’Allemagne 62,
permettra au continent européen de se développer en paix et aidera
enfin
la révolution sociale russe qui n’a besoin que d’un coup de l’extérieur
pour se déchaîner au bénéfice du peuple russe tout entier!»
Progresser le mouvement ouvrier international
Le 20 juillet 1870, Marx écrivait à Engels: «Si les Prussiens sont victorieux, la centralisation du pouvoir d’État sera utile à la centralisation de la classe ouvrière allemande. La prépondérance allemande transférerait en outre de France en Allemagne le centre de gravité du mouvement ouvrier européen, et il suffit de comparer le mouvement de 1866 à aujourd’hui dans les deux pays pour voir que la classe ouvrière allemande est supérieure à la classe ouvrière française sur le plan de la théorie et de l’organisation. La prépondérance sur le théâtre du monde de la classe ouvrière allemande sur la française signifierait du même coup la prépondérance de notre théorie sur celle de Proudhon, etc».
Cette prédiction s’est encore une fois avérée exacte.
Par conséquent, c’est dans l’intérêt du mouvement ouvrier
international
que Marx souhaite voir le prolétariat allemand prendre la tête du
mouvement
ouvrier en Europe.
Cette guerre ne doit pas
dégénérer
en guerre offensive, c’est-à-dire
Dans la 1ère Adresse du Conseil Général aux membre de l’AIT en Europe et aux USA du 22 juillet 1870, Marx lance déjà un avertissement aux ouvriers allemands: «Si la classe ouvrière allemande permet à la guerre actuelle de perdre son caractère strictement défensif et de dégénérer en une guerre contre le peuple français, victoire ou défaite, ce sera toujours un désastre. Toutes les misères qui se sont abattues sur l’Allemagne après les guerres dites de libération renaîtront avec une intensité nouvelle».
Cette prédiction, comme le souligne Engels, dans son introduction de 1891 à “La guerre civile...”, s’est avérée exacte avec les 20 années de domination bismarckienne, la chasse aux socialistes, etc...
L’Adresse rappelait ensuite qu’à l’arrière plan de cette lutte suicidaire planait l’ombre de la Russie à laquelle la Prusse pouvait faire appel, prosternant encore une fois l’Allemagne aux pieds du tsar.
La tâche du prolétariat allemand est donc d’aider le prolétariat
français à se libérer et non de contribuer à son oppression.
c. Marx et Engels et la
situation
parisienne durant la guerre
Le “général” Engels, qui écrira une soixantaine d’articles sur la guerre franco-prussienne, affirme le 10 août 70, après les premières défaites des armées françaises, dans une lettre à Marx: «Le bas empire semble partir comme en un pet. Badinguet abdique la direction de l’armée et doit la confier à Bazaine qui n’ayant pas encore été battu, est son meilleur homme. Mai cela signifie pratiquement qu’il abdique tout. La révolution en sera rendue facile à ceux qui la feront: tout se désagrège tout seul, comme on pouvait s’y attendre. Les quelques jours qui viennent en décideront sûrement. Je crois que les Orléanistes – sans l’armée – ne sont pas assez forts pour tenter tout de suite une restauration».
Marx et Engels s’attendent donc à un sursaut révolutionnaire, le souhaitent même car la situation est favorable puisque la bourgeoisie n’est pas prête à y réagir. Ils s’exclament sur la décomposition rapide de la société bonapartiste qui ouvre la voie à une prise rapide de Paris par les troupes prussiennes. Ils envisagent donc la tactique suivante dans la lettre de Engels à Marx du 15 août 70: «La débâcle en France semble terrible. Tout se décompose, s’achète et se vend. De mauvaise fabrication, les chassepots lâchent dans la bataille (...) Malgré tout, un gouvernement révolutionnaire – s’il vient rapidement – n’a pas à désespérer. Mais il devra abandonner Paris à son sort et continuer la guerre dans le sud. Il sera toujours possible alors de tenir assez longtemps pour acheter des armes et organiser des armées nouvelles, grâce à quoi l’ennemi sera progressivement repoussé jusqu’aux frontières. Ce serait en réalité la meilleur issue de la guerre. Les deux pays se prouvant mutuellement leur invincibilité».
Et le 17 août 70, Marx peut enfin sonner le glas dans une lettre à Engels: «Le Second Empire est donc mort comme il est né, dans la parodie. C’est bien ce que j’avais prévu avec mon Bonaparte»63.
Malheureusement, les forces révolutionnaires ne sont pas intervenues et ont laissé passer l’occasion favorable. Le 20 août 70, Engels écrit à Marx: «Je crois que l’annexion des Franco-germaniques 64est maintenant décidée. On aurait pu faire quelque chose si un gouvernement révolutionnaire s’était formé la semaine dernière. Il arrive trop tard maintenant et ne peut que se rendre ridicule en parodiant la Convention65. Je suis convaincu que Bismarck aurait conclu une paix sans cession de territoire avec un gouvernement révolutionnaire, s’il s’était formé en temps voulu».
Les évènements se précipitent.
«Il faut tout de même s’attendre à ce qu’il se passe quelque chose lorsque les nouvelles arriveront à Paris. Je ne peux m’imaginer que la douche glacée de nouvelles, qui doivent être connues aujourd’hui ou demain, ne provoquera pas une quelconque réaction». Engels écrit ceci à Marx le 4 septembre 1870, jour de la proclamation de la République à Paris! Et il continue: «La guerre est finie. Il n’y a plus d’armée en France. Sitôt que Bazaine aura capitulé, ce qui arrivera cette semaine probablement, une moitié de l’armée allemande avancera jusqu’aux portes de Paris et l’autre passera la Loire et nettoiera le pays de tous les centres armés».
Aussitôt dit, aussitôt fait!
Marx et Engels ne se font pas d’illusions dès qu’ils connaissent les membres du nouveau gouvernement. Marx n’a pas assez de mots pour dénoncer les traîtrises de Jules Favre depuis 1848, et Engels lui écrit le 7 septembre 1870: «Toute cette république dont l’origine est exempte de luttes est jusqu’à présent une farce pure et simple».
Dans la Seconde Adresse du Conseil Général sur la guerre franco-allemande, Marx sera on ne peut plus clair: «Nous saluons l’avènement de la République en France; mais ce n’est pas sans éprouver des appréhensions qui, nous l’espérons, se révéleront sans fondement. Cette République n’a pas renversé le trône, mais simplement pris la place laissée vacante. Elle a été proclamée non comme une conquête sociale, mais comme une mesure de défense nationale. Elle est dans les mains d’un gouvernement provisoire composé en partie d’orléanistes notoires, en partie de républicains bourgeois, sur quelques uns desquels l’insurrection de juin 1848 a laissé son stigmate indélébile. La division du travail entre membres de ce gouvernement ne présage rien de bon. Les orléanistes se sont saisis des positions fortes de l’armée et de la police tandis qu’aux républicains déclarés sont échus les ministères où l’on parle. Quelques uns de leurs premiers actes montrent assez clairement qu’ils ont hérité de l’Empire non seulement des ruines mais aussi la peur de la classe ouvrière (...) Aux yeux de certains bourgeois qui en ont assumé la charge, la République ne devrait-elle pas servir de transition à une restauration orléaniste?».
Ainsi, pour Marx et Engels, cette République n’a pas été proclamée comme une conquête sociale, et ils craignent qu’elle ne cache une prochaine restauration orléaniste. Ils ne seront pas étonnés de la défection nationale de ce gouvernement dont ils ne cesseront par la suite de dénoncer les mensonges.
De plus Marx et Engels fustigeront le chauvinisme français qui explose de plus belle après la proclamation de la République. Le bureau parisien de l’AIT, qui pourtant le 15 juillet 70 avait organisé une manifestation au cri de “Vive la paix!”, et publié le 12 juillet un manifeste “Aux travailleurs de tous les pays” de protestation contre la guerre qui s’annonçait, lance un appel “Au peuple allemand, à la démocratie socialiste de la nation allemande” dont le ton chauvin soulèvera les sarcasmes de Marx et Engels. Ainsi Engels écrit-il à Marx le 7 septembre: «Si l’appel international des Parisiens a été télégraphié fidèlement ici, cela démontre qu’ils se trouvent encore complètement sous la domination de la phraséologie. Après avoir toléré Badinguet pendant 20 ans, après avoir été incapables il y a six mois encore d’empêcher qu’il obtienne six millions de voix contre un million et demi et les lance contre l’Allemagne sans aucune raison et sans aucun prétexte, ces gens prétendent aujourd’hui, parce que les victoires allemandes leur ont fait cadeau d’une république – mais laquelle! – que les Allemands doivent quitter le sol sacré de la France, sinon: guerre à outrance!».
Serraillier, ouvrier français vivant à Londres, qui avait gagné Paris le 6 septembre, décrit ainsi la situation des internationalistes parisiens au Conseil Général (Marx cite un passage d’une de ses lettres à César de Paepe le 14 septembre 1870): «C’est incroyable de penser que des gens peuvent pendant six ans être internationaux, abolir les frontières, ne plus connaître d’étrangers et en arriver au point où ils en sont venus pour conserver une popularité factice et dont, tôt ou tard, ils seront les victimes. Quand je m’indigne de leur conduite, ils répondent que s’ils parlaient autrement, ils seraient boulés! (...) Il y a plus: par leurs discours ultra-chauvins, quelle situation font-ils à l’Internationale? (...) il s’ensuit qu’ils ne peuvent rien trouver d’autre que parodier la révolution de 1793!» (in “La Commune”, 10/18, p.82).
En fait, les sections françaises de l’AIT se trouvent désorganisées à ce moment-là. Les procès, les persécutions des dernières années, la mobilisation de la guerre avait rompu les organisations ouvrières. Quelques militants comme Varlin, Theisz, Frankel, Avrial, Combault s’efforcent de reconstituer les sections désorganisées ou ruinées. Ils demandent des conseils au Conseil Général de Londres. Marx dans une lettre à Engels du 6 septembre 1870, précise qu’il a «longuement répondu au Conseil Fédéral en assumant du même coup la tâche très désagréable de leur ouvrir les yeux sur le véritable état des choses».
Après Sedan, la guerre avait cessé d’être une guerre pour la défense du territoire national allemand. Le 5 septembre, le Comité social-démocrate allemand avait lancé un appel invitant la classe ouvrière allemande à manifester publiquement en faveur d’une paix honorable avec la République française et contre l’annexion de l’Alsace-Lorraine. Mais le 9 septembre, les signataires de l’appel étaient appréhendés par les autorités militaires et conduits à la forteresse de Lötzen en Prusse orientale.
Le jour même de ces arrestations, le Conseil Général de l’AIT à Londres s’exprimait dans une Seconde Adresse le 9 septembre 1870, rédigée par Marx et en partie par Engels pour expliquer la situation nouvelle aux classes ouvrières d’Europe et des USA. L’Adresse dénonce le caractère impérialiste de la guerre que Bismarck et derrière lui la bourgeoisie allemande entreprennent contre la France. Elle examine les “allégations” que les “intrépides patriotes” allemands avancent pour justifier l’annexion de l’Alsace-Lorraine et explique que cette annexion poussera la République française dans les bras du tsarisme: «Si la fortune des armes, l’arrogance du succès et les intrigues dynastiques la conduisent à spolier la France d’une partie de son territoire, l’Allemagne se trouvera en face d’un dilemme: ou bien, courant ainsi un danger considérable, elle devra devenir ouvertement l’instrument de l’expansion russe, ou bien, après un bref répit, elle devra se préparer à une nouvelle guerre “défensive” qui ne sera plus une de ces guerres “localisées” à la mode aujourd’hui, mais une guerre de races contre l’alliance des Slaves et des Latins» 66.
En effet, l’Alsace conquise par Richelieu et la Lorraine achetée à l’Autriche en 1735, libérée des entraves féodales depuis 1789 (la Marseillaise fut composée à Strasbourg en 1792!) étaient francophiles, bien qu’on y parlât usuellement un dialecte allemand. L’importance de l’avantage stratégique est la seule excuse que l’on puisse trouver à l’annexion, mais les conséquences politiques sont graves. L’annexion de l’Alsace-Lorraine fait de la Russie l’arbitre de l’Europe. En arrachant à la France ses deux provinces fanatiquement patriotes, on la poussait dans les bras de quiconque lui ouvrirait la perspective de leur récupération et on se faisait de la France une ennemie éternelle. Et contre l’Allemagne, l’allié naturel de la France est la Russie. Si les deux nations les plus grandes du continent occidental se neutralisent par une éternelle pomme de discorde qui les pousse à se combattre, la Russie aura les mains plus libres pour manoeuvrer.
Les ouvriers allemands doivent donc réclamer une paix honorable pour la France et la reconnaissance de la République française.
Quant aux ouvriers français, ils se trouvent placés dans une situation très difficile avec cette République proclamée non comme une conquête sociale mais comme une mesure de défense nationale qui peut d’ailleurs cacher une manoeuvre orléaniste en vue de la restauration monarchique. Et l’Adresse déconseille vivement à la classe ouvrière française de renverser le nouveau gouvernement: «Toute tentative de renverser le nouveau gouvernement, quand l’ennemi frappe presque aux portes de Paris, serait une folie désespérée. Les ouvriers français doivent remplir leur devoir de citoyens; mais en même temps, ils ne doivent pas se laisser entraîner par les souvenirs nationaux de 1792 comme les paysans français se sont laissés duper par les souvenirs nationaux du Premier Empire (...) Que calmement et résolument, ils profitent de la liberté républicaine pour procéder méthodiquement à leur propre organisation de classe. Cela les dotera d’une vigueur nouvelle, de forces herculéennes pour la régénération de la France et pour notre tâche commune, l’émancipation du travail. De leur énergie et de leur sagesse dépend le sort de la République».
L’insurrection serait donc une folie!!
Et Marx et Engels de dénoncer les illusions nationalistes. «Se
battre contre les Prussiens au profit de la bourgeoisie serait folie!»
écrit Engels à Marx le 12 septembre 1870. Dans cette même lettre, il
dit qu’il faudrait empêcher que les ouvriers déclenchent un mouvement
pour la paix, car s’ils vainquaient à présent au service de la défense
nationale, ils devront assumer l’héritage de Bonaparte et de l’actuelle
misérable république, et, comme ils seraient inévitablement battus par
les armées allemandes, ils seraient rejetés vingt ans en arrière. Avec
la paix, le gouvernemnt perd toute chance de durer longtemps: toutes
les
chances pour les ouvriers seraient plus favorables qu’elles ne l’ont
été
avant. Et Engels de déplorer qu’à Paris, il y ait si peu de gens qui
aient le courage de considérer la situation telle qu’elle est
réellement.
Durant toute la période qui va de la proclamation de la République à celle de la Commune, Marx et Engels avec le Conseil Général vont faire tout leur possible pour aider la classe ouvrière française. Par le canal de Lafargue 67, de Serraillier et d’autres, ils multiplient les conseils d’organisation aux ouvriers et dénonceront le sabotage de la défense nationale par la bourgeoisie.
Marx déclenchera aussi en Angleterre une campagne pour la
reconnaissance
de la République en France par le gouvernement britannique pour contrer
la menace d’une restauration des Orléans 68.
Comme nous l’avons déjà souligné plus haut, la situation des sections françaises était mauvaise, et de plus le Conseil Général de Londres était hostile à une insurrection. Les internationaux parisiens montrèrent d’abord quelques réserves à l’égard du CC de la Garde nationale et hésitèrent à se mêler à son action. Le 1er mars, à la séance du Conseil fédéral de l’AIT, Varlin, qui prévoit les évènements qui vont se dérouler, ne voulant pas que la section y soit étrangère, demande que les internationaux fassent leur possible pour se faire nommer délégués dans les compagnies de la Garde nationale et siéger au CC. Varlin s’écrie ainsi: «Allons là non pas comme internationaux mais gardes nationaux et travaillons à nous emparer de l’esprit de cette assemblée!». Mais le Conseil fédéral reste hésitant; Frankel répond: «Ceci ressemble à un compromis avec la bourgeoisie, je n’en veux pas!». Le Conseil décide tout de même de déléguer auprès du CC de la Garde nationale une commission de quatre membres dont l’action devait être purement individuelle et ne pas compromettre l’Internationale. Quatre internationaux (Babick, Varlin, Assi, Alavoine) feront ainsi partie du CC.
De ce fait, l’Internationale, bien qu’elle sera accusée d’en être l’instigatrice (Assi, membre du bureau parisien avait son nom du fait de l’ordre alphabétique placé en tête des proclamations!) a bien peu participé et contribué à produire la journée du 18 mars. Le 22 mars, les membres du Conseil fédéral tiennent à souligner que l’Internationale est “dégagée de toute responsabilité” vis-à-vis du CC. Ce n’est qu’à la séance du 23-24 mars que la Chambre fédérale des sociétés ouvrières et le Conseil fédéral de l’AIT renforceront le CC de toute leur force morale et publieront un manifeste où ils affirmeront entre autre que «la délégation communale est la garantie de l’émancipation des travailleurs».
Tout d’abord, ils ne voient pas dans le 18 mars un mouvement révolutionnaire; ainsi, Varlin répondit-il à la lettre de Bakounine et de Guillaume qui voyaient dans le 18 mars la Révolution sociale universelle «qu’il ne s’agissait pas de révolution internationale, que le mouvement du 18 mars n’avaiteu d’autre but que la revendication des franchises municipales de Paris et que ce but était atteint; que les élections étaient fixées au lendemain 26 et qu’une fois le Conseil municipal élu, le CC résilierait ses pouvoirs et tout serait fini» (Talès, p.55). Un tel programme n’avait donc rien de subversif!
Par la suite, les internationaux chercheront à donner au mouvement communaliste un programme, des lignes directrices; ils se chargeront, entre autre, dans la Commune, du programme économique et social par l’intermédiaire de la Commission du Travail.
Voici le contenu de quelques séances du conseil fédéral
de l’AIT: le 29 mars, nomination d’une commission intermédiaire entre
le Conseil et la Commune; le 12 avril, exclusion à l’unanimité de
Tolain
qui s’est rangé du côté des Versaillais, et proposition au Conseil
général
de Londres de consacrer cette expulsion (ce qu’il fit le 29 avril); le
8 mai: à la section des Carrières et Montmartre de l’Internationale,
motion pour l’instruction laïque primaire et professionnelle
obligatoire
et gratuite à tous les degrés; le 20 mai: à la séance extraordinaire
du Conseil fédéral des sections parisiennes de l’AIT, les adhérents
de l’Internationale membres de la Commune sont invités à faire “tous
les efforts pour maintenir l’unité de la Commune”.
Marx, Engels et le Conseil général de Londres
Dans la préface de l’ouvrage rassemblant les lettres à Kugelman, Lénine écrivait: «Marx, qui qualifiait en septembre 1870 l’insurrection de folie, voyant en avril 1871 le gouvernement des masses populaires, le considère avec l’attention extrême d’un homme qui participe à de grands mouvements marquant un progrès du mouvement révolutionnaire mondial».
Et Marx écrivait ainsi à Kugelmann le 17 avril 1871: «C’est justement pourquoi elles (les canailles bourgeoises de Versailles) placèrent les Parisiens devant l’alternative ou de relever le défi ou de succomber sans combat. Dans le dernier cas, la démoralisation de la classe ouvrière aurait été un malheur bien plus grand que la perte d’un nombrequelconque de “chefs” (Kugelmann avait écrit à Marx que la défaite privera de nouveau les ouvriers de leurs chefs). Grâce au combat livré par Paris, la lutte de la classe ouvrière contre la classe capitaliste est entrée dans une phase nouvelle. Mais de quelque façon que les choses tournent dans l’immédiat, le résultat sera un nouveau point de départ d’une importance historique mondiale».
Et Lénine continue: «Mais quand les masses se soulèvent, Marx veut marcher avec elles, s’instruire en même temps qu’elles en cours de lutte, et non pas donner des leçons bureaucratiques. Il comprend que toute tentative d’escompter d’avance, avec une précision parfaite, les chances de la lutte serait du charlatanisme ou du pédantisme incurable. Il met au-dessus de tout le fait que la classe ouvrière, héroïquement, avec abnégation et initiative, créa l’histoire du monde; Marx considérait l’histoire du point de vue de ceux qui la créent sans avoir la possibilité d’escompter infailliblement, à l’avance, les chances de succès, et non du point de vue de l’intellectuel petit-bourgeois qui vient faire de la morale: “il aurait été facile de prévoir... on n’aurait pas dû se risquer...” (...) Marx savait voir aussi qu’il y a des moments de l’histoire où une lutte désespérée des masses, même pour une cause perdue d’avance, est indispensable pour l’éducation ultérieure de ces masses elles-mêmes et leur préparation à une lutte suivante».
Marx a donc suivi de très près avec le Conseil général les évènements parisiens. Le Conseil général était même intervenu en déléguant deux ouvriers français Dupont et Serraillier qui seront élus à la Commune lors des élections complémentaires du 16 avril. Serraillier fera même partie de la Commission du Travail. C’est donc grâce à eux, à Léo Frankel, à Lafargue arrivé de Bordeaux à Paris le 6 avril 1871, que le Conseil général de Londres fut tenu au courant. Marx eut aussi d’autres correspondants: le proudhonien Charles Longuet, le blanquiste E.Vaillant, E.Varlin, Vermorel, E.Dmitrieff (de Genève, elle partit au début mars 1871 pour Paris, chargée d’une mission d’information). Et Marx écrivit de nombreuses lettres à Varlin et Frankel qui lui demandaient conseil.
Le 28 avril, il écrivait ainsi à Frankel (“La Commune”, 10/18, p.124) au sujet des calomnies que F.Pyat répandait sur Serraillier et Dupont, et le 13 mai à Frankel et Varlin: «Ne serait-il pas utile de mettre en lieu sûr les papiers compromettants pour les canailles de Versailles? Une telle précaution ne peut jamais être nuisible (...) J’ai écrit plusieurs centaines de lettres pour exposer et défendre votre cause à tous les coins du monde où nous avons des branches (...) La Commune me semble perdre trop de temps à des bagatelles et à des querelles personnelles. On voit qu’il y a d’autres influences que celles des ouvriers. Tout cela ne serait rien si vous disposiez de temps pour rattraper le temps perdu (...) Les Prussiens permettront au gouvernement de cerner Paris avec ses gendarmes (...) La condition préalable de la réalisation de leur traité étant la conquête de Paris, ils ont prié Bismarck d’ajourner le paiement du premier terme jusquà l’occupation de Paris. Bismarck a accepté cette condition. La Prusse ayant elle-même un besoin très pressant de cet argent, donnera donc toutes les facilités aux Versaillais pour accélérer l’occupation de Paris. Ainsi, prenez garde!» (op.cit. p.126).
La plupart des lettres écrites par Marx n’ont pu être retrouvées. Marx y abordait des questions très importantes, d’ordre financier en vue d’assurer des moyens matériels à la Commune, d’ordre militaire en vue de la défense de la Commune, et d’ordre politique pour la mettre en garde contre des ennemis avoués ou camouflés et pour lui conseiller telle ou telle mesure sociale.
Dans une lettre du 12 juin 1871, Marx explique à Beesly
ses relations avec la Commune: «Un marchand allemand qui voyage
toute
l’année pour affaires entre Paris et Londres a assuré la liaison entre
le Commune et moi. Tout était réglé oralement, sauf pour deux affaires.
Par cet intermédiaire, j’ai envoyé premièrement aux membres de la
Communes
une lettre de réponse à la question qu’ils me posaient sur la
possibilité
de négocier certaines valeurs à la Bourse de Londres. Deuxièmement le
11 mai, dix jours avant la catastrophe, j’ai envoyé par le même canal
tous les détails de l’accord secret entre Bismarck et Favre à
Francfort.
L’information m’avait été transmise par un collaborateur direct de
Bismarck
qui appartint jadis à une société secrète (1848-52) que je
dirigeais 69.
Quant à la Commune, que n’a-t-elle écouté mes avertissements! J’ai
conseillé
à ses membres de fortifier le côté nord des hauteurs de Montmartre (le
côté prussien), alors qu’il en était encore temps. Je leur ai dit à
l’avance qu’ils risquaient autrement d’être pris dans une souricière.
En outre, je les ai mis en garde contre Pyat, Grousset et Vésinier70.
Enfin, je leur ai demandé d’envoyer aussitôt à Londres les papiers
compromettants
pour les membres de la Défense nationale pour pouvoir grâce à ce moyen
tenir quelque peu en échec la férocité des ennemis de la Commune. Bref,
tout cela eût pu faire échouer en partie le plan des Versaillais. Si
les Versaillais avaient trouvé ces documents, ils n’auraient pas publié
de faux».
La Commune est la fille de l’Internationale
Marx écrivait à Kugelman 71 le 12 mai 1871: «L’insurrection parisienne même si elle vient à être réduite par les loups, les cochons et les chiens de la vieille société, est le plus glorieux exploit de notre parti depuis l’insurrection parisiennede juin».
Et Engels à Sorge en septembre 1874: «La Commune intellectuellement était sans contredit fille de l’Internationale“, même si ”l’Internationale n’a pas remué un doigt pour le faire».
Ils étaient en droit de revendiquer la Commune comme un
exploit de notre parti, car la classe ouvrière était l’ossature du
mouvement
et les membres parisiens de l’Internationale comptaient parmi les plus
clairvoyants éléments de la Commune.
Après la Commune, la peur de la bourgeoisie internationale hantée par le spectre du communisme, se déchaîne avec son terrorisme à l’encontre des ouvriers, des communards, et des membres de l’AIT. Cette répression prit la forme de la délation, de la fabrication de faux, de la diffamation et de la falsification des principes et des buts de la Commune et du socialisme. L’AIT, sous la direction de Marx et d’Engels, rendit coup pour coup avec les moyens dont elle disposait pour faire respecter partout et la Commune et l’Association. Marx déclara ainsi le 21 septembre 1871: «Comme le propose Vaillant, il faut que nous jetions un défi à tous les gouvernements, partout, même en Suisse, en réponse à leurs persécutions contre l’Internationale. La réaction existe sur tous les continents; elle est générale et permanente, même aux États-Unis et en Angleterre sous une autre forme» (in “La Commune”, 10/18, p.213).
Et pour cela, Marx et Engels dépensèrent une énergie incroyable, comme l’atteste la femme de Marx dans une lettre du 26 mai 1872 à W.Liebknecht (id. p.151): «Vous ne pouvez avoir idée de ce que nous avons enduré ici à Londres depuis la chute de la Commune. Toute cette misère indescriptible et ce malheur infini. Et en plus le travail presque insoutenable pour l’Internationale! Toute la racaille s’est tue, tant que notre Maure a réussi à grand-peine par son travail, sa diplomatie et ses louvoiements, à tenir ensemble – aux yeux du monde et de la multitude de nos ennemis – les éléments récalcitrants, à sauver l’Association du ridicule et à inspirer crainte et terreur à la masse de ceux qui tremblent (...) il n’a ni trève ni repos jour et nuit!».
Et de même Marx et Engels se battirent comme des lions pour aider les communards réfugiés à, il fut Londres. Ainsi la fille de Marx, Jenny Longuet, dans une lettre à Kugelmann du 21 décembre 1871 (id.p 198) décrit ainsi la situation: «Pendant toutes ces trois dernières semaines, j’ai couru d’une banlieue de Londres à une autre et j’ai ensuite écrit des lettres souvent jusqu’à une heure du matin. Le but de ces déplacements et de ces lettres, c’est trouver de l’argent pour les réfugiés (...) Voilà plus de six mois que l’Internationale soutient la grande masse des bannis, autrement dit les tient tout juste en vie (...) vous pouvez vous imaginer combien ces difficultés torturent notre pauvre Maure».
Ce ne furent cependant pas les persécutions qui
contribuèrent
à détruire l’influence de l’AIT, mais le développement pacifique du
capitalisme en Europe occidentale de 1871 à 1914, tandis que le centre
de gravité du mouvement révolutionnaire se déplaçait vers la Russie
(cf Marx, préface russe du “Manifeste Communiste”).
6. RÉVOLUTION PROLÉTARIENNE,
«La Commune de Paris a été la première tentative historique
– faible encore – de domination de la classe ouvrière»
(Trotsky,
“Terrorisme et Communisme”).
Gouvernement de la classe ouvrière
Engels, dans son introduction à “La guerre civile...” de 1891, parle des mouvements insurrectionnels depuis 1789 qui ont toujours revêtu en France un caractère prolétarien: «Le développement économique de la France depuis 1789 a fait que depuis 50 ans aucune révolution n’a pu éclater sans revêtir un caractère prolétarien, de sorte qu’après la victoire, le prolétariat (...) entrait en scène avec ses revendications propres».
Mais ces revendications remettaient en cause l’ordre social nouvellement établi; aussi la bourgeoisie s’empressait-elle de désarmer les ouvriers: c’est ce qui se passa en 1848. Le trait nouveau de la révolution de 1871: «C’est que le peuple après le premier soulèvement ne s’est pas désarmé et n’a pas remis son pouvoir entre les mains des saltimbanques républicains des classes dirigeantes; c’est que, par la formation de la Commune, il a pris dans ses propres mains la direction effective de la révolution» (Marx, premier essai de “La guerre civile...”, p.224).
En effet, la guerre avec la Prusse, la trahison de sa bourgeoisie, le chômage du prolétariat et la ruine de la petite-bourgeoisie poussèrent la population de Paris à la révolution du 18 mars qui remit inopinément le pouvoir entre les mains de la Garde nationale, entre les mains de la classe ouvrière et de la petite-bourgeoisie qui s’était rangée à son côté et qui la reconnaissait la seule capable de sauver Paris du désastre et la France de l’anéantissement, la seule capable d’initiative sociale (Voir Lénine tome 17 p.135). La seule classe saine dynamique, révolutionnaire de par son essence était bien alors le prolétariat. Or cette classe ne peut se contenter de la République bourgeoise qu’elle réalise en en dépassant les limites, en visant déjà à briser ce monde bourgeois qui saisit tout juste le pouvoir.
«Mais dans la société actuelle, le prolétariat économiquement
asservi par le Capital, ne peut dominer politiquement s’il ne brise les
chaînes qui le rivent au capital». (Lénine tome 17 p.135: “A la
mémoire de la Commune”,1911). C’est-à-dire détruire les bases
économiques
sur lesquelles se fonde l’existence des classes. C’est de cette façon
que le travail sera émancipé de l’exploitation (Marx, dans “La guerre
civile...”, p.49, affirme que le gouvernement ouvrier de la Commune est
«le champion audacieux de l’émancipation du travail»!),
que le travail productif cessera d’être l’attribut d’une classe, le
prolétariat,
et que l’Homme, être générique, sera libéré de ses servitudes
d’exploité
et d’exploiteur. Tout homme sera enfin uniquement un travailleur.
La Commune n’est déjà plus un État
Marx évoquant la Commune (p.45) écrit: «C’était une forme politique tout à fait susceptible d’expansion, alors que toutes les formes du gouvernement avaient jusque là mis l’accent sur la répression. Son véritable secret, le voici: c’était essentiellement un gouvernement de la classe ouvrière, le résultat de la lutte de la classe des producteurs contre la classe des appropriateurs, la forme politique enfin trouvée qui permettait de réaliser l’émancipation économique du Travail. Sans cette dernière condition, la Constitution communale eût été une impossibilité et un leurre. La domination politique du producteur ne peut coexister avec l’éternisation de son esclavage social. La Commune devait donc servir de levier pour extirper les bases économiques sur lesquelles se fonde l’existence des classes, donc, la domination de classe. Une fois le travail émancipé, tout homme devient un travailleur et le travail productif cesse d’être l’attribut d’une classe».
Ainsi, ce gouvernement ouvrier n’est donc déjà plus un État, comme Lénine, s’aidant d’Engels, le souligne:«Depuis le XIX ème siècle, les époques révolutionnaires offrent un type supérieur d’État démocratique, un État qui selon l’expression d’Engels, cesse déjà, sous certains rapports, d’être un État, “n’est plus un État au sens propre du terme”. C’est l’État du type de la Commune de Paris» (tome 24 p.60).
Car ce qu’offre ce gouvernement prolétarien, c’est le communisme:
«Oui, Messieurs, la Commune entendait abolir cette propriété de
classe
qui fait du travail du grand nombre la richesse de quelques uns. Elle
visait
à l’expropriation des expropriateurs. Elle voulait faire de la
propriété
individuelle une réalité, en transformant les moyens de production, la
terre et le capital, aujourd’hui essentiellement moyens
d’asservissement
et d’exploitation du travail, en simples instruments d’un travail libre
et associé!» (Marx, “La guerre civile...”, p.45).
Les insurgés, une majorité d’ouvriers
A la Commune siégeaient de nombreux ouvriers ou des représentants de ces derniers. Engels, dans son introduction à “La guerre civile...” de 1891 (p.296) écrit: «Ainsi, à partir du 18 mars, apparut, incisif et pur, le caractère de classe du mouvement parisien qu’avait jusqu’alors relégué à l’arrière plan, la lutte contre l’invasion étrangère. Dans la Commune, ne siégeaient presque que des ouvriers ou des représentants reconnus des ouvriers; ses décisions portaient de même un caractère nettement prolétarien. Ou bien elle décrétait des réformes, que la bourgeoisie républicaine avait négligées par pure lâcheté, mais qui constituaient pour la libre action de la classe ouvrière une base indispensable, comme la réalisation de ce principe que, en face de l’État, la religion n’est qu’une affaire privée; ou bien elle promulguait des décisions prises directement dans l’intérêt de la classe ouvrière, et qui, pour une part, faisaient de profondes entailles dans le vieil ordre social».
En outre, comme nous l’avons déjà souligné plus haut, les insurgés étaient en majorité des ouvriers. D’autre part, le caractère prolétarien de la révolution parisienne ne s’exprimait pas seulement au niveau de la Commune, expression de la révolution prolétarienne, mais aussi au niveau d’organisations populaires tels les clubs “rouges” 72 où tous les révolutionnaires discutaient des problèmes généraux, ou d’organisation et de défense; tels les groupes de femmes organisés par Elisabeth Dmitrieff; et tels les comités de vigilance de chaque arrondissement qui s’occupaient d’organiser la défense et le ravitaillement des quartiers populaires: ainsi à Montmartre, Louise Michel, vibrante héroïne de la Commune, et qui sera déportée après mai, raconte que: «les comités de vigilance de Montmartre ne laissaient personne sans asile, sans pain (...) On n’épargnait pas pour ceux qui en avaient besoin les ressources de la mairie, ni les moyens révolutionnaires et les réquisitions. Le 18 ème arrondissement était la terreur des accapareurs. Quand on disait: Montmartre va descendre! Les réactionnaires se fourraient dans leurs trous, lâchant comme des bêtes poursuivies les caches où les vivres pourrissaient tandis que Paris crevait de faim» (“Le peuple français”, n.4 /1978, Louis Michel).
Quel bel exemple de dictature prolétarienne!
L’erreur que l’on ne peut imputer à la Commune est que le prolétariat ait accepté de gouverner avec la petite-bourgeoisie. Lénine l’explique ainsi: «L’entrée dans le gouvernement révolutionnaire de représentants du prolétariat socialiste aux côtés de la petite-bourgeoisie est, sur le plan des principes, parfaitement acceptable, et, dans des conditions déterminées, tout simplement obligatoire. Cette information nous montre ensuite que la tâche réelle dont la Commune a dû s’acquitter était avant tout la réalisation de la dictature non pas socialiste, mais démocratique, l’application de notre “programme minimum”» (“La Commune de Paris et les tâches de la dictature démocratique”, 1905, tome 9 p.140).
En effet, la Commune de Paris ne pouvait vaincre qu’en faisant le
lien
avec la paysannerie: «En désespérant de la restauration
napoléonienne,
le paysan français perd la foi en sa parcelle, renverse tout l’édifice
d’État construit sur cette parcelle et la révolution prolétarienne
réalise ainsi le choeur sans lequel, dans toutes les nations paysannes,
son sol devient un chant funèbre» (Marx, “Le 18 Brumaire”,
Ed Sociales, p.134).
c. La dictature du prolétariat
Lénine, parlant de l’État prolétarien, dont le type pour lui est celui de la Commune de Paris, écrit (7 ème Conférence du POSD (b)R, avril 1917, tome 24, p.238): «Un tel pouvoir est une dictature, c’est-à-dire qu’il s’appuie non sur la loi, non sur la volonté formelle de la majorité, mais directement sur la violence. La violence est l’instrument du pouvoir».
Mais en fut-il ainsi pour la Commune? Où y-a-t-il eu en 1871 dictature du prolétariat à Paris comme Engels l’apostrophe au philistin social-démocrate: «Regardez la Commune de Paris, c’était la dictature du prolétariat!» (Introduction à “La Guerre Civile...”)?
Trotsky, dans “Terrorisme et Communisme”, écrit en 1920, dans les
chapitres intitulés “La Commune de Paris et la Russie des Soviets”
et “Marx et Kautsky” qui répond au renégat Kautsky qui fait de la
Commune de Paris un modèle de gouvernement ouvrier, certes, mais...
démocratique
et pacifiste comme, selon lui il doit l’être, reniant ainsi le pouvoir
dictatorial des Soviets:
«il voit les qualités prédominantes de la
Commune là où nous voyons ses malheurs et ses torts»!
A Kautsky qui veut opposer la magnanimité des communards à l’intransigeance des bolchéviques, Trotsky, citant Lavrov qui a écrit un livre sur la Commune, rétorque: «Ce sont précisément ceux qui attachent tant de prix à la vie humaine, au sang humain, qui doivent mettre tout en oeuvre pour obtenir une victoire rapide et décisive, et qui, ensuite, doivent agir au plus vite et énergiquement pour soumettre l’ennemi; car ce n’est que par cette manière de procéder que l’on peut obtenir le minimum de pertes inévitables et le minimum de sang versé».
Et Trotsky cite ensuite les mesures dictatoriales que la Commune,
mue
par la nécessité, a dû prendre ou tout au moins ébaucher: «Poussée
par la logique de la lutte, celle-ci entra en matière de principe dans
la voie de l’intimidation. La création du Comité de salut public
était dictée pour beaucoup de ses partisans par l’idée de la terreur
rouge. Ce comité avait pour objet de “faire tomber les têtes des
traîtres”
et de “réprimer les trahisons” (séances du 30 avril et du 1 er mai).
Parmi les décrets d’ “intimidation”, il convient de signaler
l’ordonnance
(du 3 avril) sur la séquestration des biens de Thiers et de ses
ministres,
la démolition de sa maison, le renversement de la colonne Vendôme, et
en particulier le décret sur les otages. Pour chaque prisonnier ou
partisan
de la Commune fusillé par les Versaillais, on devait fusiller trois
otages.
Les mesures prises par la Préfecture de police, dirigée par Raoul
Rigault,
étaient d’un caractère purement terroriste, quoiqu’elles ne fussent pas
toujours adaptées au but poursuivi. L’efficacité de toutes ces mesures
d’intimidation fut paralysée par l’inconsistance et l’état d’esprit
conciliateur
des éléments dirigeants de la Commune, par leurs efforts pour faire
accepter
le fait accompli à la bourgeoisie au moyen de phrases pitoyables, par
leurs oscillations entre la fiction de la démocratie et la réalité de
la dictature» 73.
Le Comité central a peur de ses responsabilités
Le 19 mars, la marche sur Versailles et les élections à la Commune furent proposées au Comité Central. Or, pour entreprendre la marche sur Versailles, il fallait réorganiser la Garde nationale, repousser les élections, établir dans la capitale un régime plus militaire. Trotsky cite encore Lavrov: «Il fallait lutter contre une multitude d’ennemis intérieurs qui foisonnaient dans Paris, et qui, hier encore, se révoltaient aux abords de la Bourse et de la place Vendôme, qui avaient leurs représentants dans l’administration et dans la Garde nationale, qui avaient leur presse, leurs réunions, qui entretenaient des rapports presque au grand jour avec les Versaillais, et qui se faisaient toujours plus résolus et audacieux, à chaque imprudence, à chaque insuccès de la Commune».
Il fallait en même temps prendre des mesures révolutionnaires
d’ordre
financier et économique pour satisfaire aux besoins de l’armée
révolutionnaire.
La tâche du CC ne consistait pas à courir après la légalité, mais
à porter un coup mortel à l’ennemi. Les aspirations du CC à un
gouvernement
“légal” étaient en fait dictées par la peur des responsabilités,
selon Trotsky, car, après les élections de la Commune, le CC continuera
à s’immiscer dans toutes les affaires, notamment celles militaires,
défiant
ainsi cette légalité qu’il avait tant recherchée.
Négation vivante de la démocratie formelle
Qu’en était-il de cette Commune démocratique et de la dictature révolutionnaire?
Toujours selon Trotsky, la Commune, tant par les traditions que par les intentions de son parti dirigeant – les blanquistes – était l’expression de la dictature de la ville révolutionnaire sur le pays, sur la France paysanne. Il en fut ainsi dans la grande révolution française; il en eut été de même dans la révolution de 1871, si la Commune n’était pas tombée si vite.
D’abord à Paris, les élections s’effectuèrent après la fuite de la bourgeoisie soutenant Thiers, et celle qui resta à Paris n’en redouta pas moins les bataillons révolutionnaires. Dans les faits, le CC, malgré une dictature molle et inconsistante, attenta au principe du suffrage universel, même s’il ne le désirât point. Après les élections, les éléments bourgeois, conscients du rapport de force favorable aux ouvriers, se retirèrent rapidement de la Commune. Et Trotsky de rappeler qu’en novembre 1917, lors des élections pour une Commune sur la base du suffrage le plus “démocratique”, sans restriction pour la bourgeoisie, celle-ci boycotta les élections, et la Commune élue à majorité révolutionnaire se soumit tout de même au Soviet de Saint Pétersbourg, c’est-à-dire qu’elle mit le fait de la dictature du prolétariat au dessus du “principe” du suffrage universel.
Si une pression des faits s’exerça sur la bourgeoisie au cours des élections et malgré les révolutionnaires, ces élections reflétaient en fait l’espoir d’un accord pacifique avec Versailles. Les dirigeants révolutionnaires voulaient l’entente et non la lutte. Les masses n’avaient pas encore épuisé leurs illusions: «Nous devons dominer nos ennemis par la force morale...» prêchait Vermorel, et encore: «Il ne faut pas toucher à la liberté et à la vie de l’individu». Longuet, dans le Journal Officiel (JO) écrivait de même le 3 avril: «Toute dissidence aujourd’hui s’effacera parce que tous se sentent solidaires, parce que jamais il n’y a eu moins de haine, moins d’antagonisme social».
Cette fiction de l’égalité qui faisait croire que la question pouvait se résoudre sans lutte tourna même à la farce macabre avec les élections complémentaires du 16 avril. Arthur Arnould écrit: «On n’avait plus que faire du vote. La situation était devenue tragique (...) Tous les hommes fidèles à la Commune étaient sur les fortifications, dans les forts, dans les postes avancés. Le peuple n’attachait aucune importance à ces élections complémentaires (...) L ’heure n’était plus à compter les électeurs, mais à avoir des soldats; non à rechercher si nous avions grandi ou baisser dans l’opinion de Paris, mais à défendre Paris contre les Versaillais».
Seuls quelques éléments avaient conscience du rôle qu’aurait dû jouer la Commune. Ainsi Millière écrivit: «La Commune n’est pas une Assemblée constituante, elle est un conseil de guerre. Elle ne doit avoir qu’un seul but: la victoire; qu’une arme: la force; qu’une loi: celle du salut public». Lissagaray ajoute: «Les dirigeants de la Commune n’ont jamais pu comprendre qu’elle était une barricade et non une administration»!
Malgré tous ces errements, la Commune a été la négation vivante de la démocratie formelle, car, dans son développement, elle a signifié la dictature du Paris ouvrier sur la nation paysanne. Chaque action de la Commune était suffisante pour convaincre de sa nature illégale.
La Commune, municipalité parisienne, abrogea la Conscription
nationale,
intitula son organe le Journal Officiel de la République française,
toucha
– bien que trop timidement – à la Banque de France, proclama la
séparation
de l’Église et de l’État, entra en relation avec des ambassades
étrangères,
etc... Tout cela, elle le fit au nom de la dictature révolutionnaire de
Paris, sans l’autorisation de la démocratie nationale qui avait trouvé
une expression plus “légale” dans l’Assemblée des Ruraux.
7. LES ENSEIGNEMENTS
a. La révolution
prolétarienne
doit briser
La Commune a montré par quoi
Cette thèse a été merveilleusement et limpidement traitée par Lénine
dans “L’État et la Révolution” à partir de “Le 18 Brumaire”
de Marx.
Bilan des luttes de classe de 1848 à 1851
Marx nous montre, dans le dernier chapitre de “Le 18 Brumaire”, que le but immédiat de la révolution de Février fut le renversement de la dynastie d’Orléans et de la fraction de la bourgeoisie qui dominait sous elle, mais c’est le 2 décembre 1851 seulement que ce but fut atteint. En effet, dans la république parlementaire, la domination de la bourgeoisie, après avoir uni tous ses éléments et fait de son domaine le domaine de sa classe, apparut dans toute sa nudité: «Il fallut que la révolution elle-même créât d’abord la forme dans laquelle la domination de la classe bourgeoise conquiert son expression la plus large, la plus générale et la plus complète, et pût par conséquent être renversée sans espoir de retour» (ES p.122).
Et c’est alors, avec le 2 décembre, que fut exécutée la condamnation prononcée en février contre la bourgeoisie orléaniste, c’est-à-dire la fraction la plus vivante de la bourgeoisie française. Avec Louis Bonaparte, elle fut battue dans son parlement, dans son université, sa presse, sa littérature, ses revenus administratifs, “dans son esprit et dans sa chair”.
Le 2 décembre, c’était donc la victoire du pouvoir exécutif sur le pouvoir législatif, et, comme Napoléon était l’exécuteur testamentaire de la révolution de février, Guizot (qui incarne la politique de la haute bourgeoisie conservatrice), que cite Marx, put s’écrier, parlant du coup d’État: «C’est le triomphe complet et définitif du socialisme!». Mais la révolution n’avait joué que son premier acte, comme nous l’explique magnifiquement Marx: «La révolution va jusqu’au fond des choses. Elle ne traverse encore que le purgatoire. Elle mène son affaire avec méthode. Jusqu’au 2 décembre, elle n’avait accompli que la moitié de ses préparatifs, et maintenant elle accomplit l’autre moitié. Elle perfectionne d’abord le pouvoir parlementaire, pour pouvoir le renverser ensuite. “Voici son premier acte!”. Ce but une fois atteint, elle perfectionne le pouvoir exécutif, le réduit à sa plus simple expression, l’isole 74, dirige contre lui tous les reproches pour pouvoir concentrer sur lui toutes ses forces de destruction, et, quand elle aura accompli la seconde moitié de son travail de préparation, l’Europe sautera de sa place et jubilera: “Bien creusé, vieille taupe!”» (p.124).
Marx parle donc des forces de destruction à concentrer sur le pouvoir exécutif, ce pouvoir exécutif dont l’historique qu’il nous donne amène à la conclusion de sa destruction: «Ce pouvoir exécutif, avec son immense organisation bureaucratique et militaire, avec son mécanisme étatique complexe et artificiel, son armée de fonctionnaires d’un demi million d’hommes et son autre armée de cinq cent mille soldats, effroyable corps parasite, qui recouvre comme d’une membrane le corps de la société française et en bouche tous les pores, se constitua à l’époque de la monarchie absolue, au déclin de la féodalité, qu’il aida à renverser».
Marx dit ainsi qu’on arrive à un pouvoir d’État «dont le travail est divisé et centralisé comme dans une usine».
Et enfin, on en arrive au passage de “Le 18 Brumaire” commenté par Lénine, où Marx parle de briser la machine étatique: «La République parlementaire, enfin, se vit contrainte, dans sa lutte contre la Révolution, de renforcer par ses mesures de répression les moyens d’action et la centralisation du pouvoir gouvernemental. Toutes les révolutions politiques n’ont fait que perfectionner cette machine au lieu de la briser» (p.125).
Lénine de commenter lumineusement ce passage, dans “L’État et la
Révolution”:
«Dans ce remarquable aperçu, le marxisme accomplit
un très grand pas en avant par rapport au Manifeste Communiste 75où
la question de l’État était encore posée d’une manière très abstraite,
dans les notions et termes les plus généraux. Ici, la question est
posée
de façon concrète et la déduction est éminemment précise, définie,
pratiquement tangible: toutes les révolutions antérieures ont
perfectionné
la machine d’État; or, il faut la briser, la démolir. Cette déduction
est le principal, l’essentiel, dans la doctrine marxiste de l’État
(...)
La question de savoir en quoi doit consister, du point de vue du
développement
historique, cette substitution de l’État prolétarien à l’État
bourgeois,
n’est pas posée ici (dans le “Manifeste Communiste”).
«Cette question, Marx la pose et la résout en 1852. Fidèle à
sa philosophie du matérialisme historique, il prend comme base
d’expérience
historique les grandes années de la révolution de 1848-51. Là, comme
toujours, la doctrine de Marx dresse un bilan de l’expérience vécue,
éclairé par une conception philosophique profonde et par une
connaissance
étendue de l’histoire.
«La question de l’État est posée de façon concrète: comment
est né historiquement l’État bourgeois, la machine d’État nécessaire
à la domination de la bourgeoisie? (...) Le pouvoir d’État centralisé
propre à la société bourgeoise, est apparu à l’époque de la chute
de l’absolutisme. Les deux institutions les plus caractéristiques de
cette
machine d’État sont: la bureaucratie et l’armée permanente (...) Ce
cours
des évènements oblige la révolution à “concentrer toutes les forces
de destruction” contre le pouvoir d’État; il lui impose pour tâche
non d’améliorer la machine d’État, mais de la démolir, de la détruire.
«Ce ne sont pas des déductions logiques, mais le développement
réel des évènements, l’expérience vécue des années 1848-51, qui ont
conduit à poser ainsi le problème. A quel point Marx s’en tient
strictement
aux données de l’expérience historique, on le voit par le fait qu’en
1852, il ne pose pas encore la question concrète de savoir par quoi
remplacer
cette machine d’État qui doit être détruite. L’expérience n’avait pas
encore fourni, à l’époque, les matériaux nécessaires pour s’attaquer
à cette question, que l’histoire mettra à l’ordre du jour plus tard,
en 1871. En 1852, on pouvait seulement constater, avec la précision
propre
aux sciences naturelles, que la révolution prolétarienne abordait cette
tâche: “concentrer toutes les forces de destruction” contre le pouvoir
d’État, “briser” la machine d’État».
Destruction de la machine d’État
Ainsi, avec Napoléon III, la machine d’État a jeté bas le masque parlementaire et est parvenue au maximum de sa concentration, facilitant ainsi le travail de la révolution prolétarienne. La période 1848-51 avait montré que la révolution prolétarienne devait exercer une dictature, c’est-à-dire un pouvoir basé sur la répression de l’ancienne classe dominante et d’autre part qu’elle ne pourrait pas utiliser la machine d’État bourgeoise. La Commune vérifia cette analyse; dès le 12 avril 1871, Marx écrivait à Kugelmann: «Dans le dernier chapitre de mon 18 Brumaire, je remarque que la prochaine tentative de la Révolution en France devra consister non plus à faire passer la machine bureaucratique et militaire en d’autres mains, comme ce fut le cas jusqu’ici, mais de la briser. C’est la condition première de toute révolution populaire sur le continent. C’est aussi ce qu’ont tenté nos héroïques camarades de Paris».
Et il le répète dans “La guerre civile...”: «La classe ouvrière
ne peut se contenter de prendre telle quelle la machine d’État et de la
faire fonctionner pour son propre compte» (p.38).
La forme politique trouvée pour remplacer la machine d’État bourgeoise
Et nous pouvons nous exclamer, avec Marx et Lénine, que la substitution d’organes nouveaux, prolétariens, aux anciens, est «le plus grand pas en avant du mouvement prolétarien mondial» (Lénine, 1917, tome 24,P60).
Lénine, reprenant le mot d’ordre de Marx dans son “Le 18 Brumaire”,
«briser
la machine bureaucratique et militaire», commente: «en ces
quelques
mots se trouve brièvement exprimée la principale leçon du marxisme sur
les tâches du prolétariat à l’égard de l’État au cours de la Révolution»
(“L’État et la Révolution”, tome 25, p.449). La Commune de Paris
a tenté d’accomplir cette tâche, et elle l’aurait réalisée – si elle
en avait eu le temps – en alliance avec la paysannerie (d’où
l’expression
“révolution populaire” qu’emploie Marx dans sa lettre à Kugelman
du 12 avril 1871), alliance vers laquelle elle se fraya le chemin.
Caractères de l’État prolétarien
«Mais depuis le XIXème siècle, les époques révolutionnaires offrent un type supérieur d’État démocratique, un État qui, selon l’expression d’Engels, cesse déjà, sous certains rapports, d’être un État, “n’est plus un État au sens propre du terme”» (Lettre d’Engels à Bebel sur le programme de Gotha du 18-28 mars 1875). «C’est l’État du type de la Commune de Paris» (Lénine, tome24, p.60).
Et encore: «Un tel pouvoir est une dictature, c’est-à-dire qu’il s’appuie non sur la loi, non sur la volonté formelle de la majorité, mais directement sur la violence» (Lénine, tome24, p.238).
Hormis ces deux caractéristiques fondamentales de l’État
prolétarien,
voyons les mesures générales:
1. Suppression du fonctionnarisme.
2. Suppression de l’armée permanente.
3. Suppression du pouvoir de l’Église.
4. Organisation nationale.
La suppression du fonctionnarisme et de l’armée permanente.
Engels, dans son introduction à “La guerre civile...”, (p.300) écrit: «La Commune dut reconnaître d’emblée que la classe ouvrière, une fois au pouvoir, ne pouvait continuer à administrer avec la vieille machine d’État; pour ne pas perdre à nouveau sa propre domination qu’elle venait à peine de conquérir, cette classe ouvrière devait, d’une part, prendre des assurances contre ses propres mandataires et fonctionnaires en les proclamant, en tout temps et sans exception, révocables (...) Pour éviter cette transformation, inévitable dans tous les régimes antérieurs de l’État et des organes de l’État, à l’origine serviteurs de la société, en maîtres de celle-ci, la Commune employa deux moyens infaillibles. Premièrement, elle soumit toutes les places de l’administration, de la justice et de l’enseignement au choix des intéressés par élection au suffrage universel, et, bien entendu, à la révocation à tout moment par ces mêmes intéressés. Et, deuxièmement elle ne rétribua tous les services, des plus bas aux plus élevés, que par le salaire que recevaient les autres ouvriers. Le plus haut traitement qu’elle payât dans l’ensemble était de 6000 francs. Ainsi, on mettait le holà à la chasse aux places et à l’arrivisme, sans en appeler aux mandats impératifs des délégués aux corps représentatifs qui leur étaient encore adjoints par surcroît».
Lénine remarque, toujours dans “L’État et la Révolution” (p.455): «Il est impossible de passer du capitalisme au socialisme sans un certain “retour” au démocratisme “primitif” (..) basé sur le capitalisme».
En ce qui concerne l’armée, Paris «s’était débarrassée de l’armée et l’avait remplacé par une Garde nationale, dont la masse était constituée par des ouvriers. C’est cet état de fait qu’il s’agissait maintenant de transformer en une institution durable. Le premier décret de la Commune fut donc la suppression de l’armée permanente et son remplacement par le peuple en armes (...) La Commune devait être non pas un organisme parlementaire, mais un corps agissant, exécutif et législatif à la fois. Au lieu de continuer d’être l’instrument du gouvernement central, la police fut immédiatement dépouillée de ses attributs politiques et transformée en un instrument de la Commune, responsable et à tout instant révocable» (Marx, “La guerre civile...”, p.41). Et c’est ainsi que «La Commune a réalisé ce mot d’ordre de toutes les révolutions bourgeoises, le gouvernement à bon marché, en abolissant les deux grandes sources de dépenses: l’armée permanente et le fonctionnarisme».
En ce qui concerne la suppression du pouvoir de l’Église, Lénine note, dans “L’État et la Révolution”: «La religion n’est qu’une affaire privée par rapport à l’État et non par rapport au parti» (p.487). Et Marx commente ainsi cette mesure générale de la Commune (p.41-42): «Une fois abolies l’armée permanente et la police, instruments matériels du pouvoir de l’ancien gouvernement, la Commune se donna pour tâche de briser l’outil spirituel de l’oppression, le pouvoir des prêtres; elle décréta la séparation de l’Eglise et de l’État, et l’expropriation de toutes les églises dans la mesure où elles constituaient des corps possédants. Les prêtres furent renvoyés à la calme retraite de la vie privée, pour y vivre des aumônes des fidèles, à l’instar de leurs prédécesseurs, les apôtres. La totalité des établissements d’instruction furent ouverts au peuple gratuitement et, en même temps, débarrassés de toute ingérence de l’Eglise et de l’État». Il ne s’agissait pas de s’attaquer directement à l’oppression spirituelle – ce qui n’aurait fait que la renforcer – mais d’en supprimer les bases matérielles.
Sur la question de l’organisation nationale et de la suppression du parlementarisme, c’est encore à Marx de parler (p.42): «La Commune de Paris devait, bien entendu, servir de modèle à tous les grands centres industriels de France. Le régime de la Commune une fois établi à Paris et dans les centres secondaires, l’ancien gouvernement centralisé aurait, dans les provinces aussi, dû faire place au gouvernement des producteurs par eux-mêmes. Dans une brève esquisse d’organisation nationale que la Commune n’eut pas le temps de développer, il est dit expressément que la Commune devait être la forme politique même des plus petits hameaux de campagne et que dans les régions rurales, l’armée permanente devait être remplacée par une milice populaire à temps de service extrêmement court. Les communes rurales de chaque département devaient administrer leurs affaires communes par une assemblée de délégués au chef-lieu du département, et ces assemblées de département devaient à leur tour envoyer des députés à la délégation nationale à Paris; les délégués devaient être à tout moment révocables et liés par le mandat impératif de leurs électeurs. Les fonctions, peu nombreuses, mais importantes, qui restaient encore à un gouvernement central, ne devaient pas être supprimées, comme on l’a dit faussement, de propos délibéré, mais devaient être acquittées par des fonctionnaires communaux, autrement dit strictement responsables. L’unité de la nation ne devait pas être brisée, mais au contraire organisée par la Constitution communale; elle devait devenir une réalité par la destruction du pouvoir d’État qui prétendait être l’incarnation de cette unité (...) alors qu’il n’en était qu’une excroissance parasitaire».
Quant au parlementarisme, Marx lui règle son compte ainsi: «Au lieu de décider une fois tous les trois ou six ans quel membre de la classe dirigeante devait “représenter” et fouler aux pieds le peuple au Parlement, le suffrage universel devait servir au peuple constitué en communes, comme le suffrage individuel sert à tout employeur en quête d’ouvriers et de personnel de direction pour son affaire. Et c’est un fait bien connu que les sociétés, comme les individus, en matière d’affaires véritables, savent généralement mettre chacun à sa place et, s’ils font une fois une erreur,ils savent la redresser promptement. D’autre part, rien ne pouvait être plus étranger à l’esprit de la Commune que de remplacer le suffrage universel par une investiture hiérarchique».
Il n’y a là aucune trace de fédéralisme à la Proudhon ou à la
Bakounine!
Lénine (t24,p.29) résume les caractères de l’État prolétarien.
Parlant du pouvoir prolétarien de 1917, il écrit: «Ce pouvoir est
du même type que la Commune de Paris, type dont voici les principales
caractéristiques:
1- La source du pouvoir n’est pas la loi préalablement discutée
et votée par un Parlement, mais l’initiative des masses populaires,
initiative
directe, locale, venant d’en bas, un “coup de force” direct, pour
employer
une expression courante.
2- La police et l’armée, institutions séparées du peuple et opposées
au peuple, sont remplacées par l’armement direct du peuple tout entier;
sous ce pouvoir, ce sont les ouvriers et les paysans armés, c’est le
peuple
en armes qui veillent eux-mêmes au maintien de l’ordre public.
3- Le corps des fonctionnaires, la bureaucratie sont, eux aussi,
remplacés par le pouvoir direct du peuple, ou du moins placés sous un
contrôle spécial; non seulement les postes deviennent électifs, mais
leurs titulaires ramenés à l’état de simples mandataires, sont
révocables
à la première demande du peuple; du corps privilégié jouissant de
“sinécures”
à traitements élevés, bourgeois, ils deviennent les ouvriers d’une “arme
spéciale” dont les traitements n’excèdent pas le salaire
habituel
d’un bon ouvrier. Là et là seulement est l’essence de la Commune de
Paris
en tant que type d’État particulier».
Lénine insiste beaucoup sur la participation de la population laborieuse à l’administration de l’État (tome 29, p.105): «Le travail dans ce sens (la lutte contre la bureaucratie) qui est indissolublement lié à la réalisation de la principale tâche historique du pouvoir soviétique, c’est-à-dire la suppression complète de l’État, doit consister premièrement en ce que chaque membre d’un Soviet ait à remplir absolument une tâche déterminée dans l’administration de l’État, deuxièmement en ce que ces tâches soient échangées à tour de rôle de manière à embrasser tout le cycle des affaires concernant l’administration de l’État, troisièmement, parallèlement aux mesures prises progressivement et avec discernement, mais de façon constante, en ce que toute la population laborieuse soit appelée à prendre une part personnelle à l’administration de l’État».
Et nous répétons avec Marx, Engels (Préface de 1872 au “Manifeste
Communiste”), Lénine (“L’État et la Révolution”, p.487) que la
Commune est la première tentative faite par la révolution prolétarienne
pour briser la machine d’État bourgeoise et la forme politique “enfin
trouvée” par quoi l’on peut et l’on doit remplacer ce qui a été brisé.
b. 1871, jalon marquant la
séparation
entre les guerres bourgeoises progressives
Dans un “Filo de Tempo” intitulé “Guerre impérialiste et guerre révolutionnaire” (“Battaglia Comunista” n.11, 1950) – texte traduit dans notre revue française “La Gauche communiste” n. 5-6, 1983, sous le titre “Ni paix, ni guerre, révolution communiste”, p.43 à 47, notre parti écrivait dans la ligne de Lénine: «Il y a deux types de guerres. Les guerres bourgeoises progressives, de développement antiféodal, de libération nationale; les guerres impérialistes. Date séparant les deux époques: 1871, la Commune de Paris. Le mouvement du prolétariat mondial se porte sur le plan de la Révolution, il rompt avec la Nation».
Ou encore, le texte de parti “Russie et Révolution dans la théorie
marxiste”, exposé lors de la réunion générale des 31 octobre-1er
novembre 1954 à Bologne, publié dans les numéros 21-23 de 1954 et 1-8
de 1955 de notre organe de presse en italien d’alors, “Il Programma
Comunista”,
expose ainsi la question: «L’aire continentale européenne où se
pose
le problème des révolutions nationales libérales auxquelles le
prolétariat
donnera son appui au cours d’une période qui se clôt en 1871. La France
figure dans cette aire bien qu’au cours des périodes 1789-1815 et
1848-1852,
elle ait été gouvernée par la bourgeoisie et que la République s’y
soit instaurée».
Depuis 1871, il n’y a plus de trêve entre le prolétariat et la bourgeoisie
1871 marque la fin de toute union entre le prolétariat et la bourgeoisie qui, en France lors de la Commune de Paris, a préféré s’allier avec l’ennemi et donc contre l’intérêt de la nation qu’elle représentait pour combattre son prolétariat, consciente qu’elle était que ce dernier visait à sa destruction en tant que classe accapareuse.
Marx, dans un exposé sur la Commune de Paris du 23 mai 1871 au Conseil Général (in “La Commune”, 10/18, p.140) parle de cette connivence entre les bourgeoisies nationales contre le prolétariat parisien: «La Commune de Paris a été écrasée avec l’aide des Prussiens, qui ont assumé le rôle de gendarmes de Thiers. Bismarck, Thiers, Favre ont conspiré pour liquider la Commune. A Francfort, Bismarck a reconnu que Thiers et Favre lui ont demandé d’intervenir. Le résultat démontre qu’il est disposé à faire tout ce qui est en son pouvoir pour les aider – sans risquer la vie de soldats allemands, non parce qu’il ménage les vies humaines lorsque s’ouvre à lui la perspective d’un butin,mais parce qu’il veut humilier encore davantage les Français qui se battent entre eux pour pouvoir leur extorquer encore plus de choses. Bismarck a autorisé Thiers à utiliser plus de soldats que n’en prévoyait la convention; en revanche, il n’a permis qu’un approvisionnement limité de Paris en vivres».
Et Marx continue en rappelant qu’il s’agit là d’une pratique ancienne: «Tout cela n’est que la répétition de pratiques anciennes. Les classes supérieures se sont toujours mises d’accord, lorsqu’il s’agissait de mater la classe travailleuse. Au XI ème siècle, lors d’une guerre entre les chevaliers français et les Normands, les paysans se soulevèrent et organisèrent une insurrection. Aussitôt, les chevaliers oublièrent leurs différends et s’allièrent pour écraser le mouvement paysan. Pour montrer comment les Prussiens firent office de policiers, il suffit de rappeler que, dans la ville de Rouen, ils firent arrêter 500 hommes sous prétexte qu’ils appartenaient à l’Internationale».
La bourgeoisie démontre donc avec la Commune qu’elle n’est plus capable de faire une guerre nationale et que son rôle révolutionnaire commencé en 1789 se termine clairement en 1871. Comme nous le dit Lénine (tome 16, p.211), la révolution bourgeoise démocratique en France, commencée en 1789, s’est achevée en 1871; en affirmant ceci, on se situe au niveau de la tâche historique objective de la révolution bourgeoise, et par “achèvement de la révolution bourgeoise démocratique”, on parle de la disparition du substrat même capable de donner naissance à une révolution bourgeoise, de l’achèvement du cycle complet des révolutions bourgeoises.
Dans “La guerre civile...”, Marx s’exclame (p.62-63): «Qu’après la plus terrible guerre des temps modernes, le vaincu et le vainqueur fraternisent pour massacrer en commun le prolétariat, cet événement inouï prouve, non pas comme Bismarck le pense, l’écrasement définitif d’une nouvelle société montante, mais la désagrégation complète de la vieille société bourgeoise. Le plus haut effort d’héroïsme dont la vieille société soit encore capable est une guerre nationale; il est maintenant prouvé qu’elle est une pure mystification des gouvernements, destinée à retarder la lutte des classes, et qui est jetée de côté aussitôt que cette lutte de classe éclate en guerre civile. La domination de classe ne peut plus se cacher sous un uniforme national, les gouvernements nationaux ne font qu’un contre le prolétariat!»
«Après la Pentecôte de 1871, il ne peut plus y avoir ni paix ni
trêve acceptable entre les ouvriers de France et ceux qui s’approprient
le produit de leur travail (...) Mais la lutte reprendra sans cesse,
avec
une ampleur croissante, et il ne peut y avoir de doute quant au
vainqueur
final (...) Et la classe ouvrière française n’est que l’avant garde du
prolétariat moderne».
Le prolétariat seule classe révolutionnaire
Marx, dans “La guerre civile...”, (p.47) nous explique: «C’était la première révolution dans laquelle la classe ouvrière était ouvertement reconnue comme la seule qui fût encore capable d’initiative sociale, même par la grande masse de la classe moyenne de Paris – boutiquiers, commerçants, négociants – les riches capitalistes exceptés. La Commune l’avait sauvée, en réglant sagement cette cause perpétuelle de différends à l’intérieur même de la classe moyenne: la question des créanciers et des débiteurs. Cette même partie de la classe moyenne avait participé à l’écrasement de l’insurrection ouvrière en juin 1848 (...) En fait, après l’exode hors de Paris de toute la haute bohème bonapartiste et capitaliste, le vrai parti de l’ordre de la classe moyenne se montra sous la forme de l’ “Union républicaine” qui s’enrôla sous les couleurs de la Commune et la défendit contre les falsifications préméditées de Thiers».
Ou encore dans le premier essai de “La guerre civile...”, (p.220): «Pour la première fois dans l’histoire, la bourgeoisie petite et moyenne a ouvertement rallié la révolution ouvrière et proclamé qu’elle était le seul instrument de son propre salut et de celui de la France! Elle constitue aux côtés des ouvriers la masse de la Garde nationale, elle siège à leurs côtés à la Commune et son Union républicaine joue en leur faveur un rôle de médiation (...) Elles sentent que seule la classe ouvrière peut les émanciper».
En effet, avec les lois Dufaure, «ce que les périls du siège
n’avaient
pas pu, l’Assemblée le fit: l’union de la petite-bourgeoisie avec le
prolétariat»
(Lissagaray, p.102), mais n’oublions pas que la seule classe vraiment
déterminée
à se battre, révolutionnaire de par son essence, est la classe ouvrière
qui, au moment du carnage, se retrouva abandonnée par ses alliés
d’hier:
«Les ouvriers restèrent fidèles jusqu’au bout à la Commune. Les
républicains bourgeois et les petits-bourgeois s’en détachèrent
bientôt:
les uns effrayés par le caractère prolétarien, socialiste et
révolutionnaire
du mouvement; les autres lorsqu’ils le virent condamné à une défaite
certaine (...) Abandonnée par ses alliés de la veille et dépourvue de
tout appui, la Commune devait inéluctablement essuyer une défaite»
(Lénine, “A la mémoire de la Commune”, tome 17, p.135).
Le prolétariat doit
s’organiser
indépendamment
«De profonds changements se sont produits depuis la grande
Révolution,
les antagonismes de classe se sont aggravés (...) aujourd’hui par
contre
le prolétariat ne peut plus confondre ses intérêts avec ceux des autres
classes, de classes qui lui sont hostiles. Que la bourgeoisie porte la
responsabilité de l’humiliation nationale! L’affaire du prolétariat est
de lutter pour affranchir le travail du joug de la bourgeoisie par le
socialisme»
(Lénine, tome 13, p.499).
POURQUOI LA COMMUNE FUT UN
ÉCHEC
«Plus la Commune de Paris nous est chère, moins il nous est
permis
d’y faire référence en nous dispensant d’examiner ses fautes et
conditions
particulières dans lesquelles elle se trouva placée. Agir de la sorte
serait suivre l’exemple absurde des Blanquistes, raillés par En gels et
qui canonisaient (dans leur manifeste de 1874) la moindre action de la
Commune» (Lénine, “Deux tactiques de la social-démocratie”,
1905, tome 9, p.77) 76.
«Nous devons imiter non ses erreurs (...) mais ses actions pratique
démocratiques couronnées de succès qui nous montrent la voie à suivre»
(Lénine, “La Commune de Paris et les tâches de la dictature
démocratique”,
tome 9, p.140).
Et nous pouvons conclure avec Lénine que par ces erreurs, la Commune «fut un gouvernement comme ne doit pas être le notre»!
Ainsi Lénine et Trotsky connaissaient parfaitement l’histoire de la
Commune de Paris sur les épaules de laquelle devait se hisser la
révolution
russe de 1905. Mais pour réaliser ce nouveau saut révolutionnaire, ils
durent développer une critique sérieuse des erreurs de la Commune;
c’est
donc avec leur aide et celle de Marx et Engels que nous allons essayer
de définir quels furent les points faibles de la Commune.
a. Les faiblesses et les
erreurs
Absence d’une théorie prolétarienne unique
Aidons-nous de l’introduction d’Engels à “La guerre civile...”, de 1891 (p.298) pour revoir quelles furent les tendances politiques au sein de la Commune: «Les membres de la Commune se divisaient en une majorité de blanquistes qui avaient déjà dominé dans le CC de la Garde nationale, et une minorité: les membres de l’AIT, se composant pour la plupart de socialistes proudhoniens. Dans l’ensemble, les blanquistes n’étaient alors socialistes que par instinct révolutionnaire, prolétarien; seul un petit nombre d’entre eux était parvenu, grâce à Vaillant, qui connaissait le socialisme scientifique allemand, à une plus grande clarté de principes (...) Il va sans dire que la responsabilité des décrets économiques de la Commune, de leurs côtés glorieux ou peu glorieux, incombe en première ligne aux proudhoniens, comme incombe aux blanquistes celle de ses actes et de ses carences politiques. Et dans les deux cas, l’ironie de l’histoire a voulu – comme toujours lorsque des doctrinaires arrivent au pouvoir – que les uns comme les autres fissent le contraire de ce que leur prescrivait leur doctrine d’école».
Ainsi les décisions des communards n’ont pas été empruntées à des doctrines préconçues, mais, comme le souligne Lénine (tome 29, p.105), dictées par la nécessité des faits: les proudhoniens, malgré l’anti-collectivisme et l’opposition à l’action politique indépendante du prolétariat de Proudhon, se battirent dans la Commission du Travail pour l’association et la fédération des travailleurs; et les blanquistes, malgré la théorie de centralisation dictatoriale de Blanqui, convièrent les Français à une libre fédération de toutes les communes, à une organisation nationale créée par la nation elle-même, et qui renversait la force répressive, centralisée du gouvernement.
Comme l’écrit Lénine, dans “Les deux tactiques de la social-démocratie” de 1905 (tome 9 p.77), la Commune eut donc «un gouvernement ouvrier qui, à l’époque, ne savait, ni ne pouvait distinguer entre les éléments des révolutions démocratique et socialiste, qui confondait les tâches de la lutte pour la République avec les tâches pour le socialisme».
Cette absence de théorie prolétarienne, de programme politique
précis
a donc eu pour conséquence un défaut d’organisation, un abus de phrases
nationalistes et des erreurs économiques et militaires.
Absence d’organisation centralisée
Le gouvernement de la Commune manqua de cohérence et de cohésion; c’est un fait qui s’explique par les tendances politiques diverses qui s’y côtoyaient et par l’immaturité du mouvement ouvrier français du point de vue politique, économique et théorique face à une situation révolutionnaire moderne.
La Commune gouverna dans le désordre, oscillant sans cesse entre la dictature et la démocratie. Les responsables des diverses commissions chargées des services ministériels changèrent à plusieurs reprises, surtout en ce qui concerne les affaires militaires. Elle dut se démettre de l’aventurier Cluseret qui avait déjà mis en doute Bergeret pour la sortie du 3 avril, et elle découragea par son indécision le généreux Rossel qui préféra démissionner.
Les dissensions au sein de la Commune concernèrent aussi le Comité de Salut Public. Comme la situation militaire s’aggravait, les “Jacobins” de la Commune liés à la révolution de 1789 firent voter difficilement par 45 voix contre 23, la formation de ce comité. L’intervention de ce dernier dans les affaires de la guerre fut particulièrement malheureuse. Renouvelé avec l’appui de la minorité cette fois, après la démission du délégué à la guerre Rossel, le nouveau Comité de Salut Public prit quelques mesures salutaires mais trop tardives.
Tandis que la lutte entre les différentes tendances,
petite-bourgeoise
et prolétarienne, et les rivalités de personne minaient la Commune de
l’intérieur, l’ingérence continuelle du Comité Centrale de la Garde
nationale dans les affaires militaires gênait et parfois même
paralysait
son action. Le CC avait remis les pouvoirs à la Commune le 26 mars et
s’était retiré au château d’eau; mais il continuait à tenir des séances
et à intervenir dans les affaires militaires. C’est lui qui proposa
l’aventurier
Cluseret, début avril, pour le département de la guerre! Des heurts
fréquents
survinrent entre les membres de la Commune, dont beaucoup étaient issus
de ce comité, et le CC de la Garde nationale.
Abus de phrases
nationalistes
révolutionnaires
En effet, le prolétariat français n’était pas encore affranchi des illusions “nationales” qui le faisait combattre aux côtés de sa bourgeoisie, et l’empêchait de concentrer ses forces pour ses organisations de classe.
Lénine, dans “Les enseignements de la Commune” (1908, tome 13, p 499), écrit: «L’idée de patriotisme remonte à la grande Révolution du 18 ème siècle; elle s’empara de l’esprit des socialistes de la Commune, et Blanqui, par exemple, révolutionnaire incontestable et adepte fervent du socialisme, ne trouva pour son journal de titre mieux approprié que ce cri bourgeois, “La Patrie en danger”! La réunion de ces deux objectifs contradictoires – patriotisme et socialisme – constitue l’erreur fatale des socialistes français».
Lénine explique encore dans “Le socialisme et la guerre” (1915, tome 21 p.324): «Il y a un demi-siècle, le prolétariat était trop faible, les conditions objectives du socialisme n’étaient encore pas venues à maturité, il ne pouvait y avoir ni corrélation, ni coopération des mouvements révolutionnaires dans tous les pays belligérants; l ’engouement d’une partie des ouvriers parisiens pour “l’idéologie nationale” (la tradition de 1792) attestait de leur part une défaillance petite-bourgeoise que Marx avait signalée en son temps et qui fut une des causes de l’échec de la Commune».
Marx, dans la 2 ème adresse du Conseil Général de Londres, le 9
septembre
1870, mettait déjà en garde le prolétariat français contre un
engouement
pour l’idée nationale mensongère, contre la tradition de 1792: le
prolétariat ne pouvait plus confondre ses intérêts avec ceux d’autres
classes. Que la bourgeoisie porte la responsabilité de
l’humiliation
nationale! L’affaire du prolétariat est désormais de lutter pour
affranchir
le travail du joug de la bourgeoisie par le socialisme. Mais c’est
l’échec de la Commune de Paris qui devait enseigner ceci au prolétariat
français et au mouvement ouvrier international.
Lénine, dans “Les enseignements de la Commune”, écrit: «Deux fautes anéantirent les fruits d’une brillante victoire. Le prolétariat s’arrêta à mi-chemin: au lieu de procéder à “l’expropriation des expropriateurs”, il se laissa entraîner par des rêves sur l’établissement d’une justice suprême dans le pays uni par une tâche nationale commune; des institutions comme les banques, par exemple, ne furent point saisies, la théorie proudhonienne du “juste échange” régnait encore parmi les socialistes. La deuxième faute fut la trop grande magnanimité du prolétariat; au lieu d’exterminer ses ennemis, il chercha à exercer une influence morale sur eux, il négligea l’importance des actions purement militaires dans la guerre civile, et, au lieu de couronner sa victoire à Paris par une offensive résolue sur Versailles, il temporisa et donna au gouvernement de Versailles le temps de rassembler les forces ténébreuses et de se préparer à la semaine sanglante de mai».
En ce qui concerne les erreurs strictement économiques, ce furent
donc
les proudhoniens de l’Internationale qui s’occupèrent de la partie
économique,
ce qui explique que «bien des choses aient été négligées»
(Engels, 1891).
Ils n’ont pas pris la Banque de France!
«Le plus difficile à saisir est certainement le saint respect avec lequel on s’arrêta devant les portes de la Banque de France. Ce fut d’ailleurs une lourde faute politique. La Banque aux mains de la Commune, cela valait mieux que dix mille otages. Cela signifiait toute la bourgeoisie française faisant pression sur le gouvernement de Versailles pour conclure la paix avec la Commune» (Engels, 1891).
Lissagaray (p.201) commente: «La Commune, dans son indignation
aveugle,
ne voyait pas les vrais otages qui crevaient les yeux: la Banque,
l’Enregistrement
et les Domaines, la Caisse des Dépôts et Consignations, etc... Par là,
on tenait les glandes génitales de Versailles; on pouvait rire de son
expérience, de ses canons. Sans exposer un homme, la Commune n’avait
qu’à
lui dire: “Transige ou meurs”. Les élus du 26 mars n’étaient pas
pour l’oser (...)
«Depuis le 19 mars, les régents de la Banque attendaient chaque
matin l’exécution de leur caisse (...) Dès la première entrevue avec
les délégués de l’Hôtel de Ville, le gouverneur perçut leur timidité,
batailla, parut réfléchir, fila son argent écu par écu (...) La Commune
avait près de 3 milliards sous la main, dont presque un milliard
liquide,
de quoi acheter mille fois tous les Gallifet 77et
hauts fonctionnaires de Versailles; pour otages, les 90 000 dépôts de
titres et les deux milliards en circulation dont le gage se trouvait
rue
de la Vrillière78
».
Ce fut l’ingénieur breton, Charles Victor Beslay, industriel et banquier qui participa à la création de l’Internationale à Paris et qui la quitta avant 1871, qui fut choisi pour être l’intermédiaire avec la Banque de France. Ses niaiseries du genre «La Banque de France est la fortune du pays; hors d’elle, plus d’industrie, plus de commerce; si vous la violez, tous les billets font faillite» furent bien accueillis par les proudhoniens de la Commune. Lissagaray commente à son sujet: «La forteresse capitaliste n’avait pas à Versailles de défenseurs plus acharnés»!
Et de conclure: «Dès la première semaine, la Commune apparaissait
faible envers les auteurs de la sortie, le CC, la Banque; légère dans
ses décrets, dans le choix de son délégué à la Guerre, sans plan
militaire,
discutant à bâtons rompus, les irréconciliables restés après la fuite
des libéraux comprirent où l’on allait. Ne tenant pas au martyre, ils
donnèrent leur démission».
Illusions démocratiques et faiblesse militaire
«Mater la bourgeoisie et briser sa résistance n’en reste pas moins une nécessité. Cette nécessité s’imposait particulièrement à la Commune, et l’une des causes de sa défaite est qu’elle ne l’a pas fait avec assez de résolution» (Lénine, “L’État et la Révolution”, tome25, p.453).
De fait, ni le CC et encore moins la Commune, où le suffrage universel avaient amené des éléments plus bourgeois, ne souhaitaient la guerre civile; ils ne dédièrent donc pas une grande attention à la stratégie (la sortie du 3 avril fut un échec catastrophique), ni à l’organisation de l’armée communale, la Garde nationale.
La trop grande magnanimité des communards fit que la Commune exerça une dictature prolétarienne tout aussi “magnanime”. Elle était bien consciente de sa faiblesse et essaya par la création du Comité de Salut Public de se renforcer; peine perdue; trop peu de communards étaient convaincus de la nécessité d’utiliser la violence contre la bourgeoisie qui elle, pourtant, n’épargnait aucun moyen féroce contre les insurgés.
Trotsky, en 1921, dans “Les leçons de la Commune” 79, précise qu’on aurait dû faire prisonnier tous les ministres avec Thiers en tête; qu’on aurait dû incorporer dans les armées en retraite quelques dizaines ou quelques centaines d’ouvriers dévoués dans le but d’exciter le mécontentement des soldats contre les officiers pour les ramener ensuite à Paris. Personne n’y pensa.
Les fautes militaires furent nombreuses. Marx écrit à Kugelman le 12 avril 1871 (“La Commune”, 10/18, p.129): «S’ils succombent, la faute en sera uniquement à leur “magnanimité”. Il eût fallu marcher aussitôt sur Versailles, après que Vinoy d’abord, les éléments réactionnaires de la Garde nationale ensuite, eurent eux-mêmes laissé le champ libre. On laissa passer le moment propice par scrupule de conscience: on ne voulait pas déclencher la guerre civile (...) Deuxième faute: le CC abandonna trop tôt le pouvoir en cédant la place à la Commune. Encore par un excessif scrupule d’ “honneur”!».
En effet, le CC avait fait preuve d’irrésolution en ne marchant pas dès le 19 mars sur Versailles alors sans défense et en n’occupant pas les forts stratégiques comme le Mont Valérien. De plus, il abandonna trop tôt le pouvoir à la Commune, car le problème militaire se posait de façon beaucoup plus urgente que celui légal, et penser à faire des élections de la Commune le 26 mars (comme le 16 avril) et des pourparlers fastidieux avec les maires de Paris, signifia perdre un temps précieux.
Les illusions démocratiques et autonomistes furent tout aussi négatives. Avec les élections et les pourparlers, le CC cherchait à dégager sa responsabilité. Toujours dans le même texte, Trotsky écrit que le CC ne chercha qu’à remplacer la révolution prolétarienne qui se développait par une réforme petite-bourgeoise: l’autonomie communale, alors que la vraie tâche révolutionnaire consistait à assurer au prolétariat le pouvoir dans tout le pays; pour atteindre ce but, il fallait sans perdre de temps vaincre Versailles, envoyer par toute la France des agitateurs, des organisateurs de la force armée. Au lieu de cette politique offensive, d’agression, qui pouvait seule sauver la situation, les dirigeants de Paris s’enfermèrent dans un bavardage idéaliste sur une autonomie communale (chaque ville a le droit sacré de self-gouvernement!) pour masquer leur lâcheté devant l’action révolutionnaire. Et Trotsky conclue ainsi la question – songeant au PCF – en 1921: «L’hostilité à l’organisation centraliste – héritage du localisme et de l’autonomie petit-bourgeoise – est sans doute le côté le plus faible d’une certaine fraction du prolétariat français (...) La tendance vers le particularisme, quelque forme qu’elle revête, est un héritage du passé mort» (p.27).
La peur de la guerre civile régnait aussi. La Commune négligea la stratégie militaire, non pas par manque d’hommes à la hauteur – les généraux Dombrowsky et Wroblevsky, les hommes pleins d’ardeur comme Duval et Flourens, etc – mais par manque de conviction, de conscience politique, par peur de l’illégalité et surtout de la guerre civile.
Marx écrit ainsi à Wilhem Liebknecht le 6 avril 1871 (in “La Commune” p.131): «Il semble que les parisiens aient le dessous. C’est de leur faute, mais une faute qui provient en fait de leur trop grande honnêteté. Le CC et plus tard la Commune laissèrent le temps au méchant avorton Thiers de concentrer les forces ennemies: premièrement parce qu’ils avaient la folle volonté de ne pas déclencher la guerre civile, comme si Thiers ne l’avait pas déjà engagée en essayant de désarmer par la force Paris, comme si l’Assemblée nationale, convoquée seulement pour décider de la guerre ou de la paix avec la Prusse, n’avait pas aussitôt déclaré la guerre à la République? Deuxièmement, parce qu’ils ne voulaient pas laisser planer sur eux le doute d’avoir usurpé le pouvoir, ils perdirent un temps précieux du fait de l’élection de la Commune, dont l’organisation coûta beaucoup de temps, alors qu’il eût fallu foncer directement sur Versailles après la défaite des réactionnaires à Paris (le 18 mars)».
La Garde nationale ne fut pas une armée rouge. Trotsky, le stratège militaire de la révolution russe, a bien montré les défauts de cette “armée rouge” dans le texte “Les enseignements de la Commune”, le CC de la Garde nationale n’était qu’un «conseil des députés ouvriers armés et de la petite-bourgeoisie (...) Cet organe élu directement par les masses révolutionnaires peut être un splendide appareil d’action,mais en même temps, et justement à cause de son lien direct et originaire avec les masses qui se trouvent dans l’état dans lequel la révolution les a surprises, il reflète non seulement les points forts mais aussi tous les points faibles des masses, même les points faibles encore plus que les points forts; en lui, se reconnaît l’esprit d’indécision, d’attente, de tendance à la passivité après le premier succès (...) Le CC avait besoin d’un guide».
L’armée de la Commune, la Garde nationale, souffrait ainsi d’un manque de cohésion. Les gardes nationaux étaient des combattants révolutionnaires qui répugnaient à une discipline indispensable. Trotsky explique que l’éligibilité des chefs et la facilité avec laquelle on pouvait les révoquer furent plutôt source de faiblesse que de force.
«Varlin formula la revendication d’après laquelle tout le
commandement
de la Garde nationale d’en haut jusqu’en bas devrait être élu par les
gardes nationaux eux-mêmes.
«L’éligibilité, les méthodes démocratiques ne sont qu’une
des armes entre les mains du prolétariat et de son parti. L’éligibilité
ne peut aucunement être fétiche, remède contre tous les maux. Il faut
combiner les méthodes d’éligibilité avec celles de désignation. Le
pouvoir de la Commune vint de la Garde nationale élue. Mais une fois
créée,
la Commune aurait dû réorganiser d’une main bien forte la Garde
nationale
de haut en bas, lui donner des chefs sûrs et établir un régime de
discipline
bien sévère. La Commune ne l’a pas fait, étant elle-même privée d’un
puissant centre directeur révolutionnaire. Aussi fut-elle écrasée».
Or il faut envisager la question du point de vue politique et militaire. Du côté politique, cette mesure permit d’épurer la Garde nationale du commandement contre-révolutionnaire et permit de scinder l’armée en deux parties suivant la ligne de classe. Mais du côté militaire, la libération de l’armée du vieil appareil de commandement amène inévitablement l’affaiblissement de la cohésion d’organisation et l’abaissement de la force combative. Le commandement élu est le plus souvent assez faible sous le rapport technico-militaire et en ce qui touche le maintien de l’ordre et de la discipline. Il faut donc donner un commandement révolutionnaire et ceci ne peut être assuré par de simples élections, car on ne peut attendre que les soldats acquièrent l’expérience de bien choisir leur commandement. Il faut donc utiliser des mesures de sélection d’en haut, et ceci est le rôle du parti. Trotsky conclut: «Si le particularisme et l’autonomisme démocratique sont extrêmement dangereux pour la révolution prolétarienne en général, ils sont dix fois plus dangereux encore pour l’armée. Nous l’avons vu par l’exemple tragique de la Commune» (p.31).
C’est aussi dans son ouvrage “Terrorisme et Communisme” (1919) que Trotsky évoque l’armée de la Commune. Ainsi, en dépit des magnifiques qualités guerrières des ouvriers parisiens, l’indécision et l’esprit de conciliation au sommet avaient engendré la désagrégation à la base. Alors que 162 000 simples soldats et 6500 officiers recevaient une solde, le nombre qui allait réellement au combat variait entre 20 et 30 000. Les fédérés manquèrent donc d’un appareil de direction précis et centralisé.
L’incurie de l’appareil militaire (mauvaise organisation matérielle, incohérence des ordres) tua vite la discipline. «Les hommes braves ne voulurent relever que d’eux seuls, les autres esquivèrent le service; les officiers firent de même», commente Lissagaray.
La concurrence entre le CC et la Commune fut une autre
faiblesse.
Le CC se hâta de transmettre ses pouvoirs aux représentants de la
Commune
qui avait besoin d’une base démocratique plus large, comme nous
l’indique
toujours Trotsky. Ce fut déjà une grande erreur de jouer aux élections
à ce moment là, mais une fois les élections faites et la Commune
réunie,
il fallait tout concentrer dans la Commune. Or le CC resta une force
politique
concurrente de la Commune, qui la priva ainsi d’énergie et de la
fermeté
nécessaire dans les questions militaires. Trotsky note ainsi (p.32): «L’éligibilité,
les méthodes démocratiques ne sont qu’une des armes entre les mains du
prolétariat et de son parti. L’éligibilité ne peut aucunement être
fétiche, remède contre tous les maux. Il faut combiner les méthodes
d’éligibilité avec celles de désignation. Le pouvoir de la Commune vint
de la Garde nationale élue. Mais une fois créée, la Commune aurait dû
réorganiser d’une main bien forte la Garde nationale de haut en bas,
lui
donner des chefs sûrs et établir un régime de discipline bien sévère.
La Commune ne l’a pas fait, étant elle-même privée d’un puissant centre
directeur révolutionnaire. Aussi fut-elle écrasée».
«La conduite de la guerre n’était pas le côté fort de la Commune.
C’est la raison pour laquelle elle a été écrasée – et avec quelle
sauvagerie! (...) Les ouvriers russes ont montré qu’ils sont capables
de se rendre maîtres aussi de la “machine de guerre”. Nous voyons
ici un gigantesque pas en avant par rapport à la Commune. Nous portons
coup sur coup à nos bourreaux. La Commune, nous la vengeons, et
nous
prenons sa revanche» (in “Terrorisme et Communisme”: La Commune
de Paris et la Russie des Soviets).
b. Immaturité du Parti
communiste
La “spontanéité révolutionnaire” du prolétariat ne peut suffire pour remporter la victoire sur la bourgeoisie centralisée, impitoyable et dotée du pouvoir économique. L’insurrection armée et la conduite militaire de la guerre civile ne peuvent être laissées au hasard de la mobilisation des masses. Le fait que, comme le souligne Trotsky, dans des conditions qualitativement semblables, les Bolchéviks de 1917 aient réussi ce que les communards de 1871 ont manqué, met en pleine lumière le rôle primordial d’un parti révolutionnaire implanté. Déjà Marx, dans la deuxième adresse de l’Internationale, conseillait aux ouvriers parisiens de s’organiser en profitant de la liberté apportée par la République. Nous ne devons surtout pas chanter avec Kautsky la gloire du “spontanéisme” des communards, qui constitua en fait leur perte.
Comme nous l’avons déjà vu plus haut, il n’y avait pas de théorie prolétarienne pleinement développée dans le mouvement ouvrier français de l’époque, et ceci justement parce qu’il n’y avait pas encore un parti complètement autonome, un parti de classe comme l’entendent Marx et Engels. Ainsi dans une lettre à G.Trier du 18 février 1888 (in “La Commune”, 10/18, p.15), Engels affirme: «Pour qu’au jour de la décision, le prolétariat soit assez fort pour vaincre, il est nécessaire qu’il se constitue en un Parti autonome, un parti de classe conscient, séparé de tous les autres. C’est ce que Marx et moi n’avons cessé de défendre depuis le Manifeste de 1848».
Mais au XIXème siècle, le capitalisme en France était peu développé. Son prolétariat était donc faible, mal organisé, comme nous l’explique Lénine, dans “A la mémoire de la Commune” (1911, tome 17, p.135): «Le capitalisme en France était encore peu développé et la France était surtout un pays de petit-bourgeois (artisans, paysans, boutiquier, etc). Par ailleurs, il n’existait pas de parti ouvrier; la classe ouvrière n’avait ni préparation, ni long entraînement, et, dans sa masse, elle n’avait même pas une idée très claire de ses tâches et des moyens pour les réaliser. Il n’y avait ni sérieuse organisation politique du prolétariat, ni syndicats ou associations coopératives de masse».
Le parti marxiste français naîtra après l’accès des socialistes français au socialisme scientifique. Dans la Commune, seul Frankel était initié aux théories de Marx, et Vaillant lors de son exil londonien les diffusera dans les milieux blanquistes.
C’est encore Trotsky qui nous précise dans le texte déjà cité sur la Commune de Paris comment l’action d’un parti marxiste aurait été déterminante.
En comparant le mouvement révolutionnaire de 1871à celui de novembre 1917, Trotsky nous montre admirablement comment la Commune de Paris souffrit de l’absence de parti réellement marxiste. Il définit ainsi le “parti ouvrier”: «Le parti ouvrier – le vrai – n’est pas une machine à manoeuvres parlementaires, c’est l’expérience accumulée et organisée du prolétariat. C’est seulement à l’aide du parti qui s’appuie sur toute l’histoire de son passé, qui prévoit théoriquement les voies du développement, toutes ses étapes et en extrait la formule de l’action nécessaire que le prolétariat se libère de la nécessité de recommencer toujours son histoire: ses hésitations, son manque de décision, ses erreurs. Le prolétariat de Paris n’avait pas un tel parti».
Trotsky nous précise ensuite méthodiquement comment l’action d’un parti ouvrier aurait changé radicalement le cours des évènements. D’abord, la Commune est venue trop tard 80. Elle avait toutes les possibilités de prendre le pouvoir le 4 septembre, ce qui aurait permis au prolétariat de Paris de se mettre à la tête des travailleurs dans leur lutte contre les forces du passé, contre Bismarck et contre Thiers. Les masses tâtonnaient, et l’absence d’un parti eut donc comme résultat que la révolution éclata six mois trop tard alors que Paris était encerclé: six mois s’écoulèrent avant que le prolétariat eût rétabli dans sa mémoire les leçons des révolutions passées, et s’emparât du pouvoir. «Ces six mois furent une perte irréparable. Si, en septembre 1870, à la tête du prolétariat de France, s’était trouvé le parti centralisé de l’action révolutionnaire, toute l’histoire de la France et avec elle toute l’histoire de l’Humanité, aurait pris une autre direction» (p.25).
En effet, le rôle du parti est de choisir le moment le plus propice à la révolution et évidemment en liaison avec les masses: il intervient consciemment. Or si le prolétariat de Paris s’empara du pouvoir, il ne le fit pas consciemment mais parce que ses ennemis prirent l’initiative de lui lancer un défi en le lui abandonnant. «La révolution tomba sur lui sans qu’il s’y attendît» (p.25) 81.
Avec le parti à la tête de la révolution, la dictature prolétarienne aurait été plus sévère: «En présence de grands évènements d’ailleurs, de telles décisions ne peuvent être prises que par un parti révolutionnaire qui attend une révolution, s’y prépare, ne perd pas la tête, par un parti qui est habitué d’avoir une vue d’ensemble et n’a pas peur d’agir» (p.26).
Nous avons déjà vu plus haut comment un parti marxiste serait mieux intervenu pour faire de la Garde nationale une armée rouge. Trotsky ajoute: «Il faut une forte direction du Parti. Le prolétariat français plus qu’aucun autre prolétariat a fait des sacrifices à la révolution. Mais plus qu’aucun autre aussi a-t-il été dupé (...) Ces lutteurs de 1871 ne manquaient pas d’héroïsme. Ce qui leur manquait, c’était la clarté dans la méthode et une organisation dirigeante centralisée. C’est pourquoi ils ont été vaincus» (p.32).
Mais n’oublions pas que ce texte a été écrit en 1921, alors que le PCF vivait déjà ses premiers drames et ses premières carences. En insistant sur la nécessité d’un parti dépositaire de l’expérience du prolétariat international, centralisé et clair dans la théorie, il lance un avertissement au PCF.
Il est évident que nous ne pouvons simplement conclure que l’échec de la Commune relève directement de l’absence d’un parti communiste dirigeant le mouvement, mais avec Marx, Engels, Lénine nous affirmons que la situation sociale de la France de 1871 n’était mûre ni pour un succès révolutionnaire, ni par conséquent pour la formation d’un parti prolétarien conscient de sa tâche révolutionnaire. La France ne pouvait produire ceci à ce moment-là. La Commune de 1871 fut le présage de la révolution prolétarienne mondiale, mais ce fut un “assaut au ciel”; et la révolution russe de 1917 put s’aider de l’expérience de la Commune, de ses apports et de ses erreurs, et naquit de conditions matérielles plus propices à l’explosion d ’un mouvement révolutionnaire communiste et donc au développement d’un Parti Communiste.
En effet, les conditions en France n’étaient pas mûres pour une
révolution
prolétarienne; et Marx qui pressentait l’insurrection de 1871 n’y était
donc guère favorable. Lénine (“Les enseignements de la Commune”,
tome 13, p.499) conclut: «Mais, malgré toutes ses fautes, la
Commune
est le modèle du plus grandiose mouvement prolétarien du XIXème siècle».
La portée historique de la
Commune
Laissons la parole encore une fois à Lénine: «Marx ne se contenta d’ailleurs pas d’admirer l’héroïsme des communards“montant à l’assaut du ciel”, selon son expression. Dans le mouvement révolutionnaire de masse, bien que celui-ci n’eût pas atteint son but, il voyait une expérience historique d’une portée immense, un certain pas en avant de la révolution prolétarienne universelle, un pas réel bien plus important que des centaines de programmes et de raisonnements. Analyser cette expérience, y puiser des leçons de tactique, s’en servir pour passer au crible sa théorie telle est la tâche que Marx se fixa» (“L’État et la Révolution”, tome 25, p.477).
Et Lénine nous rappelle encore une fois en quoi consiste ce pas
en avant, ce «nouveau point de départ d’une importance
historique
mondiale» (comme Marx l’écrit à Kugelmann, le 17 avril 1871):
«Marx apprécia hautement la portée historique de la Commune: si au
moment où la clique versaillaise tentait perfidement de s’emparer des
armes du prolétariat parisien, les ouvriers les avaient abandonnées
sans
combat, le préjudice de la démoralisation que cette faiblesse eût semée
dans le mouvement prolétarien eût été infiniment plus grave que les
pertes subies par la classe ouvrière au combat, dans la défense de ses
armes. Si lourds qu’aient été les sacrifices de la Commune, ils sont
compensés par l’importance qu’elle a pour la lutte générale du
prolétariat:
elle a profondément remué le mouvement socialiste en Europe; elle a
révélé
la force de la guerre civile; elle a dissipé les illusions patriotiques
et brisé la foi naïve dans les aspirations nationales de la
bourgeoisie.
La Commune apprit au prolétariat européen à poser concrètement les
problèmes de la révolution socialiste» (“Les enseignements de
la Commune”, tome 13, p.499).
L’impulsion donnée au
mouvement
Les massacres de la Commune et la répression internationale de l’AIT désorientèrent un moment le mouvement ouvrier, mais pour peu de temps. Quelques années après l’écrasement de la Commune, le mouvement ouvrier français renaissait: «La bourgeoisie était contente. “Maintenant, s’en est fait du socialisme et pour longtemps!”, disait son chef, le nabot sanguinaire Thiers (...) Quelques six ans après l’écrasement de la Commune, alors que nombre de ses combattants croupissaient encore au bagne, le mouvement ouvrier renaissait déjà en France (...) Et quelques années plus tard, le nouveau parti ouvrier et l’agitation qu’il avait déclenchée dans le pays obligeaient les classes dominantes à remettre en liberté les communards restés aux mains du gouvernement» (1880) (Lénine, A la mémoire de la Commune).
La Commune permit aussi le démarrage fulgurant du mouvement ouvrier allemand naissant qui prend la relève et s’appuie sur la théorie marxiste du prolétariat, elle-même la synthèse des mouvements ouvriers européens. Engels écrivait en 1874 (Préface à La Guerre des paysans), texte cité par Lénine (tome 5 p.377): «Les ouvriers allemands ont sur ceux du reste de l’Europe deux avantages essentiels. Premièrement, ils appartiennent au peuple le plus théoricien de l’Europe (...) Le second avantage, c’est que les Allemands sont venus assez tard au mouvement ouvrier, presque les derniers. De même que le socialisme théorique allemand n’oubliera jamais qu’il s’est élevé sur les épaules de Saint Simon, de Fourier, d’Owen, trois hommes qui, malgré toute la fantaisie et l’utopie de leurs doctrines, comptent parmi les plus grands cerveaux de tous les temps et ont anticipé génialement sur d’innombrables idées dont nous montrons à présent la justesse scientifiquement, de même le mouvement ouvrier pratique allemand ne doit jamais oublier qu’il s’est développé sur les épaules des mouvements anglais et français, qu’il a pu simplement profiter de leurs expériences chèrement acquises et éviter, à présent, leurs erreurs alors pour la plupart inévitables. Sans le passé des trade-unions anglaises et des luttes politiques ouvrières françaises, sans l’impulsion gigantesque donnée particulièrement par la Commune de Paris, où en serions-nous aujourd’hui?».
En effet, avec la Commune, le mouvement ouvrier français passa le flambeau à celui allemand, permettant ainsi l’affirmation de la prépondérance de la théorie marxiste sur celle de Proudhon. Le 20 juillet 1870, Marx écrivait à En gels: «La prépondérance sur le théâtre du monde de la classe ouvrière allemande sur la française signifierait du même coup la prépondérance de notre théorie sur celle de Proudhon».
Et Engels ajoutera en effet, dans son introduction de 1891 à “La guerre civile...”, que «la Commune fut le tombeau de l’école proudhonienne du socialisme» (p.299).
Enfin, la magnifique révolution russe n’a pas oublié les leçons de
la Commune de Paris, et s’est considérée comme son héritière directe.
Lénine le répète de nombreuses fois: «La leçon que le prolétariat
a reçue ne sera pas oubliée. La classe ouvrière en fera son profit
comme
elle l’a déjà fait en Russie pendant l’insurrection de décembre»
(tome13, p.499).
«Les révolutions russes de 1905 et de 1917, dans un cadre différent,
dans d’autres conditions, continuent l’oeuvre de la Commune et
confirment
la géniale analyse historique de Marx.
«Nous sommes dans d ’autres conditions parce que grimpés sur
les épaules de la Commune de Paris
et profitant du long développement
de la social-démocratie allemande, nous pouvons voir clairement ce que
nous faisons en créant le pouvoir des Soviets» (“L’État et la
Révolution”, tome 25, p.467).
Et si les Bolcheviks se sont revendiqués de la Commune de Paris,
nous
nous référons aujourd’hui à l’État russe prolétarien qui est notre
modèle pour demain, et jetons à la face de la bourgeoisie ces mots de
Marx (exposé au Conseil général du 23 mai 1871): «Mais si la
Commune est battue, le combat est simplement différé. Les principes de
la Commune sont éternels et ne peuvent être détruits: ils resurgiront
toujours de nouveau jusqu’à ce que la classe ouvrière soit émancipée».
Circulaire adressée par M.
le
Ministre des Affaires Étrangères Jules Favre aux agents diplomatiques
7 Juin 1871
Sur les causes de la Commune.
Monsieur,
La formidable insurrection que la vaillance de notre armée vient de vaincre a tenu le monde entier dans de telles anxiétés, elle l’a épouvanté par de si effroyables forfaits, qu’il me semble nécessaire de dominer l’horreur qu’elle inspire, pour essayer de démêler les causes qui l’ont rendue possible. Il importe que vous soyez éclairé sur ce point, afin de pouvoir rectifier des opinions erronées, mettre les esprits en garde contre les fâcheuses exagérations et provoquer partout le concours moral des hommes sensés, honnêtes, courageux, qui veulent résolument restaurer le principe de l’autorité, en lui donnant pour base le respect des lois, la modération et la liberté.
(...) La France, comme on le répète trop légèrement, n’a point reculé vers la Barbarie; elle a été, par une série de fautes volontaires, jetée en dehors des voies du juste et du vrai. Elle subit aujourd’hui la plus cruelle et la plus logique des expiations.
Qui peut nier, en effet, que l’acte du 2 décembre et le système qui en a été la consécration n’aient introduit dans le sein de la nation un élément actif de dépravation et d’abaissement! En ce qui concerne plus particulièrement la ville de Paris, il n’est pas un esprit sérieux qui n’est compris et prédit les inévitables malheurs que préparait la violation audacieuse de toutes les règles économiques et morales, conséquences inévitables des travaux à outrance nécessaires à l’existence de l’Empire. On peut se reporter à de récentes discussions, et l’on verra avec quelle précision étaient dénoncés les périls que contestaient intrépidement les trop dociles approbateurs de ces criminelles folies. Paris était condamné par le régime que lui avait fait le gouvernement impérial à subir une crise redoutable; elle aurait éclaté en pleine paix; la guerre lui a donné les caractères d’une horrible convulsion.
Il n’en pouvait être autrement. En accumulant dans l’enceinte de la capitale une population flottante de près de trois cent mille travailleurs, en y multipliant toutes les excitations des jouissances faciles et toutes les souffrances de la misère, l’Empire avait organisé un vaste foyer de corruption et de désordres où la moindre étincelle pouvait allumer un incendie. Il avait créé un atelier national alimenté par une spéculation fiévreuse, et qu’il était impossible de licencier sans catastrophe.
Quand il commit le crime de déclarer la guerre, il appela sur Paris la foudre qui devait l’écraser cinq semaines après. Nos armées étaient détruites, et la grande cité restait seule en face de huit cent mille Allemands qui inondaient notre territoire. Le devoir de la résistance animait toutes les âmes. Pour le remplir à Paris, il fallut armer sans distinction tous les bras; l’ennemi était aux portes, et sans cette témérité nécessaire, il les aurait franchies dès son premier choc.
Il fallut aussi nourrir tous ceux qui manquaient de travail, et le nombre en dépassa six cent mille. C’est dans ces conditions périlleuses que commença le siège. Nul ne le croyait possible.
On annonçait que la sédition livrerait la ville au bout de quelques semaines. La ville a tenu quatre mois et demi, malgré les privations, malgré les rigueurs d’une saison cruelle, malgré le bombardement, et la famine l’a obligée à traiter. Mais nul ne saurait dire la violence des perversions morales et physiques auxquelles cette malheureuse population fut en proie. Les exigences du vainqueur y mirent le comble. A l’humiliation de la défaite vint se joindre la douleur des sacrifices qu’il fallait subir.
Le découragement et la colère se partagèrent les âmes. Nul ne voulut accepter son malheur, et beaucoup cherchèrent la consolation dans l’injustice et la violence. Le déchaînement de la presse et des clubs fut poussé jusqu’aux dernières limites de l’extravagance. La garde nationale se désagrégea. Un grand nombre de ses membres, chefs et soldats, quittèrent Paris.
Coupé en deux par la réunion de l’Assemblée à Bordeaux, le gouvernement restait sans force. Il en aurait acquis par sa translation à Versailles, si les agitateurs n’avaient choisi ce moment pour allumer l’insurrection.
N’ayant à leur opposer que quelques régiments à peine organisés, le gouvernement couvrit l’Assemblée, et commença la partie terrible qu’il a définitivement gagnée, grâce surtout à la sagesse, à la fermeté, au dévouement sans bornes de son chef. Il fallut, en dépit de tous les obstacles, réunir une armée assez nombreuse pour assiéger les forts et Paris, et les réduire; contenir l’étranger toujours disposé à intervenir; calmer les impatiences légitimes de l’Assemblée; déjouer les intrigues qui se nouaient chaque jour; pourvoir, sans trésor, à d’effroyables dépenses de guerre et d’occupation étrangère (...)
Les prisonniers, qui gémissaient en Allemagne sont rentrés; au lieu du repos auquel ils avant tant de droits, ils ont trouvé le péril et le sacrifice. La patrie le commandait; tous, depuis le plus illustre jusqu’au plus humble, ont obéi. Ils ont de nouveau prodigué leur vie à la défense du droit, de l’entreprise que leurs rivaux jugeaient impossible, ils l’ont accomplie. Les forts de l’enceinte ont été emportés d’assaut, et la rébellion, poursuivie pied à pied, a succombé dans son dernier repaire.
Mais à quel prix; grand Dieu! L’histoire ne pourra le raconter sans épouvante. La plume tombera plusieurs fois de ses mains quand il faudra qu’elle retrace les hideuses et sanglantes scènes de cette lamentable tragédie, depuis l’assassinat des généraux Lecomte et Clément Thomas jusqu’aux incendies préparés pour embraser tout Paris, jusqu’à l’abominable et lâche massacre des saintes victimes fusillées dans leurs prisons.
Toutefois, l’indignation et le dégoût ne peuvent arrêter les hommes politiques dans l’accomplissement du devoir d’investigation que leur imposent de si extraordinaires forfaits.
Les détester et les punir n’est point assez. I l faut en rechercher le germe et l’extirper.
Plus le mal est grand, plus il est essentiel de s’en rendre compte et de lui opposer la coalition de tous les gens de bien.
Je viens d’expliquer sommairement comment l’état général de la ville de Paris constituait par lui-même une prédisposition au désordre, et comment il s’était aggravé dans les proportions les plus menaçantes par l’anarchie du siège.
Un petit groupe de sectaires politiques avait, dès le 4 septembre, tenté, heureusement en vain, de profiter de la confusion pour s’emparer du pouvoir; depuis, ils n’avaient cessé de conspirer.
Représentant la dictature violente, la haine de toute supériorité, ils furent dans la presse, dans les réunions, dans la garde nationale, des artisans audacieux de calomnies, de provocations et de révolte. Vaincus le 31 octobre, ils se servirent de l’impunité pour se glorifier de leurs crimes et en reprendre l’exécution le 22 janvier. Leur mot d’ordre fut la commune de Paris, et plus tard, après le traité des préliminaires, la fédération de la garde nationale.
Avec une rare habilité, ils préparèrent une organisation anonyme et occulte qui bientôt se répandit sur la cité tout entière. C’est par elle que le 18 mars, ils saisirent le mouvement, qui d’abord semblait n’avoir aucune portée politique. Les élections dérisoires auxquelles ils procédèrent ne furent pour eux qu’un masque; maîtres de la force armée, détenteurs de ressources immenses en munitions, en artillerie, en mousqueterie, ils ne songèrent plus qu’à régner par la terreur et à soulever la province.
Sur plusieurs points du territoire éclatèrent des insurrections, qui un instant encouragèrent leurs coupables espérances. Grâce à Dieu, elles furent réprimées; néanmoins, dans plusieurs départements, les factieux n’attendaient que le succès de Paris, mais Paris demeura le seul champion de la révolte. Pour entraîner sa malheureuse population, les criminels qui siégeaient à l’Hôtel de Ville ne reculèrent devant aucun attentat. Ils firent appel au mensonge, à la proscription, à la mort. Ils enrôlèrent les scélérats tirés par eux des prisons, les déserteurs et les étrangers. Tout ce que l’Europe renferme d’impur fut convoqué. Paris devint le rendez-vous des perversités du monde entier. L’Assemblée nationale fut vouée aux insultes et à la vengeance.
C’est ainsi qu’on parvint égarer un grand nombre de citoyens et que la cité se trouva sous le joug d’une poignée de fanatiques et de malfaiteurs. Je n’ai point à détailler leurs crimes. Je voulais seulement montrer par quel concours de circonstances fatales leur règne honteux a été possible. Ils se sont emparés d’une population déshabituée du travail, irritée par le malheur, convaincue que son gouvernement la trahissait: ils l’ont dominée par la terreur et la fourberie. Ils l’ont associée à leurs passions et leurs forfaits; et quant à eux, enivrés de leur éphémère pouvoir, vivant dans le vertige, s’abandonnant sans frein à la satisfaction de leurs basses convoitises, ils ont réalisé leurs rêves monstrueux, et se sont abîmés comme des héros de théâtre dans la plus épouvantable catastrophe qu’il ait été donné à l’imagination d’un scélérat de concevoir.
Voilà, messieurs, comment je comprends ces évènements qui confondent et révoltent, et qui paraissent inexplicables quand on ne les étudie pas attentivement. Mais j’omettais un des évènements essentiels de cette lugubre histoire, si je ne rappelais qu’à côté des jacobins parodistes qui ont eu la prétention d’établir un système politique, il faut placer les chefs d’une société, maintenant tristement célèbre, qu’on appelle l’Internationale, et dont l’action a peut-être été plus puissante que celle de leurs complices, parce qu’elle s’est appuyée sur le nombre, la discipline et le cosmopolitisme.
L’Association Internationale des Travailleurs est certainement l’une des plus dangereuses dont les gouvernement ont à se préoccuper. La date de sa formation est déjà éloignée. On l’a fait ordinairement remonter à l’Exposition de 1862. Je la crois plus ancienne. Il est naturel et légitime que les ouvriers cherchent à se rapprocher par l’association. Il y a plus de quarante ans qu’ils y songent, et si leurs efforts ont été contrariés par la législation et par les tribunaux, ils n’en ont pas moins persévéré avec constance. Seulement, dans les dix dernières années, la sphère de leur action s’est singulièrement étendue, et leurs idées ont pris un caractère dont il est permis de s’inquiéter. Comme l’indique le titre même de leur association, les fondateurs de l’Internationale ont voulu effacer et confondre les nationalités dans un intérêt commun supérieur.
On pouvait croire tout d’abord cette conception uniquement inspirée par un sentiment de solidarité et de paix.
Les documents officiels démentent complètement cette supposition.
L’Internationale est une société de guerre et de haine. Elle a pour base l’athéisme et le communisme, pour but la destruction du capital et l’anéantissement de ceux qui le possèdent, pour moyen la force brutale du grand nombre qui écrasera tout ce qui essayera de résister.
Tel est le programme qu’avec une cynique audace, les chefs ont proposé à leurs adeptes: ils l’ont publiquement enseigné dans leurs congrès, inséré dans leurs journaux. Car, en leurs qualités de puissance, ils ont leurs réunions et leurs organes. Leurs comités fonctionnent en Allemagne, en Belgique, en Angleterre et en Suisse. Ils ont des adhérents nombreux en Russie, en Autriche, en Italie et en Espagne. Comme une vaste franc-maçonnerie, leur société enveloppe l’Europe entière.
Quant à leurs règles de conduite, ils les ont trop de fois énoncées pour qu’il soit nécessaire de démontrer longuement qu’elles sont la négation de tous les principes sur lesquels repose la civilisation.
«Nous demandons, disent-ils dans leur feuille officielle du 25 mars
1869, l’abolition des cultes, la substitution de la science à la foi,
et de la justice humaine à la justice divine, l’abolition du mariage...
«Elle demande avant tout l’abolition du droit d’héritage, afin qu’à
l’avenir la jouissance soit égale à la production de chacun, et que,
conformément à la décision prise par le dernier congrès de Bruxelles,
la terre, les instruments de travail, comme tout autre capital,
devenant
la propriété collective de toute la société, ne puissent être utilisés
que par les travailleurs, c’est-à-dire par les associations agricoles
et industrielles».
Tel est le résumé de la doctrine de l’Internationale, et c’est pour anéantir toute action comme toute propriété individuelle, c’est pour écraser les nations sous le joug d’une sorte de monarchisme sanguinaire, c’est pour en faire une vaste tribu appauvrie et hébétée par le communisme que des hommes égarés et pervers agitent le monde, séduisent les ignorants et entraînent après eux les trop nombreux sectateurs qui croient trouver dans la résurrection de ces inepties économiques des jouissances sans travail et la satisfaction de leurs plus coupables désirs.
Ce sont là, en effet, les perspectives qu’ils étalent aux yeux des gens simples qu’ils veulent tromper:
«Ouvriers de l’univers, dit une publication du 29 janvier 1870,
organisez-vous
si vous voulez cesser de souffrir de l’excès de fatigue ou de
privations
de toutes sortes».
«Par l’association internationale des travailleurs, l’ordre, la
science,
la justice remplaceront le désordre, l’imprévoyance et l’arbitraire».
«Pour nous, est-il dit ailleurs, le drapeau rouge est le symbole de
l’amour humain universel: que nos ennemis songent donc à ne pas le
transformer
contre eux-mêmes en drapeau de la terreur».
En présence de ces citations, tout commentaire est inutile. L’Europe est en face d’une oeuvre de destruction systématique dirigée contre chacune des nations qui la composent, et contre les principes mêmes sur lesquels reposent toutes les civilisations.
Après avoir vu les coryphées de l’Internationale au pouvoir, elle n’aura plus à se demander ce que valent leurs déclarations pacifiques. Le dernier mot de leur système ne peut être que l’effroyable despotisme d’un petit nombre de chefs s’imposant à une multitude courbée sus le joug du communisme, subissant toutes les servitudes, jusqu’à la plus odieuse, celle de la conscience, n’ayant plus ni foyer, ni champ, ni épargne, ni prière, réduite à un immense atelier, conduite par la terreur et contrainte administrativement à chasser de son coeur Dieu et la famille.
C’est là une situation grave. Elle ne permet pas aux gouvernements l’indifférence et l’inertie. Ils seraient coupables, après les enseignements qui viennent de se produire, d’assister impassibles à la ruine de toutes les règles qui maintiennent la moralité et la prospérité des peuples.
Je vous invite donc, monsieur, à étudier avec l’attention la plus minutieuse tous les faits qui se rattachent au développement de l’Internationale, et à faire de ce sujet le texte d’entretiens sérieux avec les représentants officiels de l’autorité; je vous demande à cet égard les observations les plus détaillées et la vigilance la plus exacte. La prudence conseille de ne pas se décider à la légère; par là même elle commande de ne négliger aucun moyen de s’éclairer. Les questions sur lesquelles je provoque vos investigations tendent à des problèmes difficiles, et qui depuis longtemps ont agité le monde. Leur solution complète dans l’ordre de la justice supposerait la perfection humaine qui est un rêve, mais dont une nation peut plus ou moins se rapprocher.
Le devoir des hommes de coeur consiste à ne jamais désespérer ni de leur temps ni de leur pays, et à travailler, sans se laisser décourager par les déceptions, à faire prévaloir les idées de justice.
Si ce devoir est le nôtre, comme je n’en doute pas, si c’est seulement par son accomplissement sincère et désintéressé que nous pouvons réparer les maux de notre malheureuse patrie, n’est-il pas urgent de rechercher les causes qui ont permis aux erreurs professées par la Société internationale un si rapide et si funeste empire sur les âmes?
Ces causes sont nombreuses et diverses, et ce n’est pas par les châtiments et la compression seulement qu’on les fera disparaître. Introduire dans les lois les sévérités que réclament les nécessités sociales, et appliquer ces lois sans faiblesse, c’est une nouveauté à laquelle il faut que la France se résigne. C’est pour elle une affaire de salut. Mais elle serait imprudente et coupable si, en même temps, elle ne travaillait pas énergiquement à relever la moralité publique par une saine et forte éducation, par un régime économique libéral, par un amour éclairé de la justice, par la simplicité, la modération, la liberté.
Sa tâche est immense; elle n’est pas au-dessus de ses forces; si elle en comprend la grandeur, au lieu de se perdre dans des intrigues personnelles, qu’elle s’inspire du sentiment de sa propre vitalité. Qu’elle entreprenne de réagir par elle-même et par elle-même, en prenant toujours pour guide a justice, le droit et la liberté; et, quelques redoutables que soient ses épreuves, elle les surmontera. Elle reprendra son rang dans le monde, non pour menacer, mais pour modérer et pour protéger. Elle redeviendra l’alliée des faibles, elle essayera d’élever la voix contre la violence, et son autorité sera d’autant plus grande pour la combattre, qu’elle aura davantage souffert de ses excès.
Je serai heureux, Monsieur, de recevoir, en échange de ces réflexions, la communication de celles qui vous seront inspirées, soit par vos propres méditations, soit par l’étude des faits et les renseignements que serez mieux à même de me transmettre.
Veuillez agréer, etc...
Cette circulaire suit de quatre jours une autre par laquelle le ministre des affaires étrangères demandait l’extradition des insurgés parisiens qui avaient tenté de se réfugier en Italie. Ayant reçu ces circulaires, le ministre de l’intérieur italien, Giovanni Lanza, envoya une dépêche au préfet de Naples, foyer du mouvement socialiste, pour l’alerter contre les dangers de subversion des associations ouvrières!
Cette circulaire est un “bel” exemple de la haine de classe et du front de classe de la bourgeoisie contre le prolétariat international!
Cette circulaire du 7 juin 1871 a été recopiée depuis le site internet de la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France: gallica.bnf.fr.
Dictature proletarienne et parti de classe
in “Battaglia Comunista” 3,4,5 de 1951.
- “La guerre civile en France”, Marx, 1872.
- Introduction d’Engels de 1891 à “La guerre civile
en France”.
- Les deux “Adresses du Conseil Général de l’AIT”.
- Correspondance Marx-Engels.
- Lettres de Marx à Kugelman (Lénine déclarera, tome
12 p.106, que «Le jugement que Marx porte sur la Commune est le sommet
de sa correspondance avec Kugelmann»).
- “Écrits Militaires”, textes de Marx et Engels,
Edition de l’Herne 1970.
- “Le mouvement ouvrier français”, textes de Marx
et Engels, Edition Maspéro, 1974, tome II.
- “La Commune de Paris”, textes de Marx et Engels.
Editions 10/18.
- Les oeuvres complètes de Lénine, Éditions sociales.
- “Terrorisme et Communisme” de L. Trotsky.
- Introduction de L. Trotsky au livre “La Commune de
1871” de Talès, 1921: “Les leçons de la Commune”. Traduit dans
“Il Programma Comunista” n.6 de 1971.
- “Il Programma Comunista” n.3,4 de 1966: compte-rendu
de la réunion générale des 31 octobre et 1er
novembre 1965 à Florence.
- “Il Programma Comunista” n.12,13 de 1966:
compte-rendu
de la réunion générale des 2-3 avril à Milan: la question militaire,
phase de constitution du prolétariat en classe dominante (La commune de
Paris, 1871).
- “K. Marx, L’histoire de sa vie”, de F. Mehring.
1 Depuis le début de 1870, les grèves succédaient aux fermetures d’usine. Ainsi la grève du Creusot où les mines de charbon et les forges étaient tenues par la famille Schneider. Benoît Malon et Eugène Varlin y furent les représentants de la Ière Internationale. La période de 1869-1871 est la deuxième apogée du mouvement social en France après celle de 1848-51. Une vague de grèves déferle sur le pays dont celle au Creusot qui éclate en janvier 70 après le licenciement de 3 ouvriers élus dont Assi. La répression fut féroce et le travail reprit. Le journal “La Marseillaise” publia le 27 janvier 1870 un Manifeste des sections parisiennes de l’Internationale. Le 21 mars, 1500 mineurs reprirent la grève contre la baisse de leurs salaires. 25 grévistes furent arrêtés, jugés et condamnés.
2 Guillaume 1er n’était pas partisan de la guerre. Bismarck imposa sa tactique en instrumentalisant la question du trône d’Espagne et surtout en parvenant à ce que la Prusse n’apparaisse pas aux yeux de l’opinion allemande, surtout celle des États du Sud – hostiles à la Prusse – et européenne, l’instigatrice du conflit!
3 Le Maréchal Patrice de Mac Mahon, comte de Mac Mahon, monarchiste convaincu, participa à la guerre franco-allemande où son commandement s’avéra désastreux, à la répression sauvage de la Commune de Paris dès mars 1871; il devint Président de la République après la chute de Thiers, de 1873 à 1879.
4 En 1891, la dépouille de Victor Noir, devenu un symbole républicain, sera transférée au Père Lachaise.
5 Le 3 août 1870, Engels écrivait à Marx: «Si le noble Bonaparte avait livré bataille vendredi, peut-être serait-il encore arrivé jusqu’au Rhin. Mais mardi l’alignement devrait être achevé. La meilleure chance d’offensive lui a échappé par sa propre faute, autrement dit par celle du bas Empire, de la gabegie dans l’intendance militaire, qui lui a fait perdre cinq jours et l’a probablement obligé à se présenter aujourd’hui avec une armée qui n’est pas tout à fait prête» (“La Commune”, p.48). Et le 5 août 1870: «On n’a jamais vu de gâchis pareil» (“Opacité”, p.56).
6Auguste Blanqui (1785-1881). Dès la chute de Napoléon III, il créa un club et un journal «La Patrie en danger» qui soutint Gambetta en tant que défenseur de la patrie, mais disparut en décembre 70 faute de crédits. Il fit partie du groupe insurrectionnel qui occupa l’Hôtel de Ville. Thiers le fit arrêter le 17-3-71 alors que malade, il se reposait chez un ami médecin dans le lot. Les Versaillais refusèrent de l’échanger contre les otages de la Commune. Il fut ramené à Paris, jugé et condamné à la perpétué en 1872. Interné à Clairvaux, dans le nord est de la France, puis au château d’If près de Marseille, il fut gracié et libéré en 1879. Il mourut en 1881 et ses obsèques furent suivies par 100 000 personnes jusqu’au cimetière du Père Lachaise à Paris.
7 Après la défaite de Sedan, Gambetta quitta en ballon Paris assiégé en octobre afin de former de nouvelles armées. Il arriva d’abord à Tours. Kératry fut chargé d’établir pour les volontaires bretons un camp à Conlie près du Mans, en novembre 1870 pour y former une armée de Bretagne. 25 OOO hommes s’y trouvèrent confrontés à l’incurie! Gambetta, doutant de la fiabilité de ces troupes, voire d’un péril chouan, abandonna l’armée de Bretagne. Avec la pluie, le camp se transforma en un véritable bourbier où les enrôlés subirent le froid, les maladies, les pénuries de ravitaillement et autres. Des milliers de soldats moururent de faim, de froid et de maladie. Le camp fut fermé le 7 janvier 71 et 19 000 bretons affaiblis par deux mois de privation, mal armés, furent taillés en pièce par les divisions prussiennes lors de la bataille du Mans le 10 janvier!!
8 La Garde nationale est une milice armée née durant la Révolution française et composée de simples citoyens chargés de maintenir l’ordre dans leur ville et leur quartier; le 16 juillet 1789, la milice bourgeoise ptarisienne prend le nom de Garde nationale destinée à protéger la Nation, puis dès 1791 elle servit au ministère de l’Intérieur pour le maintien de l’ordre. En 1792, elle fut écartée au profit des gendarmes et de l’armée, fut supprimée en 1827, puis rétablit en 1830, et persista jusqu’en 1870. La plupart des gardes nationaux doivent justifier qu’ils payent l’impôt et acheter eux-mêmes leur équipement. Elle participa aux journées révolutionnaires de juillet 1830 et de février 1848 mais participa à la répression en juin 1832 ou en juin 1848. En 1870, les hommes valides de moins de 40 ans furent incorporés dès le 8 août dans la Garde nationale de Paris. Le travail s’interrompt, les entreprises périclitent, le chômage s’étend, privant de salaire les femmes aussi. Dès le 12 septembre 1870, un décret est pris qui établit un subside de 1franc50 par jour aux gardes nationaux (il fallait 6 francs par jour pour une famille de 2 enfants pour subsister à Paris à la fin du second Empire. Le prix des denrées avait déjà beaucoup augmenté dès 1868 pour atteindre des taux jamais vus durant le siège. Un oeuf valait un franc en janvier 71!). Par le décret du 28 novembre 70, le gouvernement de la Défense nationale alloua une 2ème subvention de 75 centimes par tête à allouer aux femmes des gardes nationaux. La Garde nationale fut supprimée après le 14 mars 1872 et la bourgeoisie préféra s’en tenir à une armée de métier!!
9 Dans la Revue “La Commune” 1975, n.1, le colonel Rol Tanguy, ancien chef de résistance et militant du PCF, analyse les combats militaires de la Commune de Paris.
10 Cf idem.
11 Le phénomène de francs tireurs débuta durant les combats de Sébastopol, en Crimée en 1854, assiégée par les armées britanniques, françaises et sardes, et qui dura onze mois. Les armées connurent la faim et les maladies. Le franc tireur est un combattant qui ne fait pas partie d’une armée régulière, qui peut être un tireur d’élite. En 1945, on utilisa le mot de partisan! En 1870, le corps des francs tireurs est estimé à 50 000 hommes selon le colonel Rol Tanguy.
12 Gabriel Ranvier (1828-1879), blanquiste, ami de G.Flourens, était peintre sur porcelaine. Il est élu commandant du 141 ème bataillon de la Garde nationale le 4 septembre 70, puis délégué du CC, maire du 20 ème arrondissement et donc élu de la Commune.
13 Durant le siège de Metz, Bazaine essaya de négocier avec les allemands pour être autorisé à sortir, regagner Paris pour“sauver la France” de la poussée républicaine. Le capitaine Louis Rossel sous ses ordres, fervent patriote, s’opposa à lui et rejoignit le 19 mars 1871 la Commune de Paris! En 1873, Bazaine fut désigné comme un responsable de la défaite et fut condamné pour avoir capitulé à Metz à 20 ans de prison, et ce par Mac Mahon, battu à Sedan! Il s’évada en 1874 et s’enfuit en Espagne.
14 Aprés l’échec de Sedan, Ducrot s’évada avec 2 officiers pour regagner Paris. Il commanda la sortie des armées de Paris du 31 novembre au 3 décembre 70 et sa dernière bataille fut celle de la désastreuse sortie de Buzenval le 19 janvier 1871!
15 De même l’Angleterre et les USA ne restèrent pas étrangers au complot bourgeois. Le gouvernement anglais, d’abord allié à la France, passera du côté allemand, parce qu’il est peu enclin à reconnaître la République du 4 septembre, rejoignant le camp des bourgeoisies allemande et française. Toute la bourgeoisie internationale sera liguée contre les insurgés parisiens. L’Amérique bourgeoise participa aussi à l’assassinat des prolétaires parisiens, comme Marx l’explique en dénonçant les agissements de l’ambassadeur des USA à Paris. L’Internationale bourgeoise faisait face à celle ouvrière! Après la Commune, elle poursuivit les membres de l’AIT.
16 Gambetta, opposé à la capitulation, démissionna du gouvernement (une partie du gouvernement se trouvant à Bordeaux) en février 71. En effet, le 31 janvier, le gouvernement avait promulgué un décret privant du droit de vote les personnalités ayant occupé de hautes fonctions dans le gouvernement bonapartiste, ceci en vue des élections pour l’Assemblée. Bismarck protesta contre ce décret, et le gouvernement de Paris, “prisonnier de Bismarck” l’annula. Gambetta démissionna alors. Voir à ce propos la lettre de Marx à Lafargue du 4 février 1871 (“La Commune”, p.112).
17 Ils seront totalement payés dès le printemps 1873, permettant le départ des occupants allemands, mais au prix d’un fort endettement de l’État français!
18 Cf Wikipédia.
19 Lié au coup d’État de décembre 1851 de Napoléon III.
20 Il s’agit d’une salle de spectacle du 10ème arrondissement de Paris qui fut alors utilisée pour les réunions politiques.
21 Jules Henri Bergeret (1830-1905), correcteur d’imprimerie, fut capitaine du 8ème bataillon de la Garde nationale, membre du CC, élu e la Commune pour le 20ème arrondisement, délégué à la Commission de la guerre et à la commission exécutive.
22 L’ “Affiche noire” (elle est bordée d’un liseré noir en signe de deuil) est placardée à Paris le 28 février 71: elle invite les Parisiens à éviter des manifestations hostiles à l’occupant le 1er mars. Il n’y eut pas d’incident.
23 Emile Zola fait le voyage avec elle depuis Bordeaux et continue de suivre ses séances pour le compte du journal “La Cloche” (qui sera interdit mi-avril 71 par la Commune). Dans son roman “Jacques Damour”, Zola dépeint les communards comme des êtres intéressés et couards!
24 Jules Vallès décrit dans son oeuvre “L’insurgé” le local de la Corderie (“Livre de poche”, p.179).
25 Jules Babick (1820-1902), parfumeur et chimiste, né en Pologne, adhère à l’AIT en 1871 et signe l’Affiche rouge.
26 Le Château rouge était en fait une grande bâtisse construite en 1780 au milieu d’un grand parc et habitée par des grands bourgeois. Comme il était en brique et au milieu d’un parc, il fut appelé Château rouge. En 1844, il sera transformé en salle de bal où se côtoient ouvriers et bourgeois et il servira aussi de lieu de réunions politiques. En août 1870, il est transformé en caserne de la Garde nationale. Il sera démoli en 1881 pour y construire 13 immeubles (n°42 à 54 de la rue Clignancourt).
27 Colonel de la Garde nationale de la Seine, il réprima durement les républicains lors du soulèvement de juin 48. Il s’opposa à Napoléon III et dut s’exiler. Il revint à Paris le 4 septembre 1870 et fut nommé commandant en chef de la Garde nationale de la Seine. Il participa à la désastreuse sortie de Buzenval du 20 janvier 1871 et il démissionna le 14 février. Le 18 mars, habillé en civil, il fut reconnu alors qu’il repérait l’emplacement des barricades de Montmartre.
28 La rue des rosiers (18ème arrondissement) fut supprimée en 1885 et remplacée par la rue du chevalier de la Barre.
29 Paul Antoine Brunel, officier de l’armée impériale, en a démissionné en 1864. Il participe au soulèvement blanquiste contre le gouvernement de défense nationale le 31-10-70.. Le 24 mars 1871 il sera élu général de la Commune avec Emile Eudes et Emile Victor Duval puis il sera élu au Conseil de la Commune par le VIIe arrondissement. Après la semaine sanglante, il s’enfuira en Angleterre où il mourra en 1904.
30 C’est au milieu de ces combats que Victor Hugo fit enterrer au cimetière du Père Lachaise son fils Charles, mort le 13 mars d’une apoplexie à Bordeaux. Depuis la place de la Bastille jusqu’au cimetière, le convoi fut salué tout le long du parcours par les bataillons de la Garde nationale, présentant les armes et drapeaux et sonnant du clairon.
31 Le fort fut construit en 1840 sur la colline de 162 m de hauteur du Mont Valérien (lieu de culte et de pèlerinage du christianisme en Gaule), située à quelques Km à l’ouest de Paris sur les communes de Saint Cloud, Suresnes, Rueil Malmaison, Nanterre, et donc protégeant à la fois Paris et Versailles.
32 Suivant l’ordre de Thiers de quitter Paris, l’intendance militaire abandonna 6000 malades dans les hôpitaux; «Il n’était pas jusqu’au service des cimetières que M. Thiers n’eût essayé de détraquer» (Lissagaray).
33 Cf “Encyclopaedia Universalis”, t4 p.760 sur la Commune de Paris.
34
Comment
les insurgés ont-ils pu prendre au sérieux Lullier qui pour certains
présentait des signes de folie! En effet, comme officier de marine, il
avait été sanctionné plusieurs fois pour indiscipline, conduites
“immorales”
(beuveries, scandales avec des prostituées, bagarres, etc...). Il avait
été plusieurs fois emprisonné. Ami de beuveries de Flourens et
Rochefort,
il se présente aux élections législatives de 1869 comme candidat
socialiste
dans la 3e circonscription de la Seine. Il voue une grande admiration à
Jules Favre à qui il enverra des lettres le 18 mars 71!! Le 3 mai 70,
il est élu au conseil général de l’AIT! Le 11 septembre 70, il est
plébiscité
comme chef de deux bataillons de Ménilmontant. Le 15 mars 71, comme
Garibaldi
n’arrive pas, il est proposé par plusieurs délégués de la Garde
nationale
réunis à la salle Vauxhall comme commandant en chef de la Garde
nationale.
Le 22 mars, il est démis, arrêté le 23
et encore le 2 mai car il affirma que la Commune est devenu un “régime”
tyrannique. Il envoie plusieurs courriers à Versailles se targuant de
«balayer la Commune, de coffrer les braillards, les satrapes de l’Hôtel
de ville». Pendant la semaine sanglante, il se cache mais il sera
arrêté
le 4 juin, condamné à mort puis aux travaux forcés. En 1881,
bénéficiant
de la loi d’amnistie, il s’en prend à plusieurs anciens communards. Il
se rallie au général Boulanger en 1888 et meurt à Panama en 1891.
35 Lissaggaray (p.148) excuse ainsi le CC: «Que leurs services les absolvent d’avoir laissé sortir l’armée. On dit qu’ils auraient dû marcher le 19 ou le 20 sur Versailles (...) Les bataillons populaires étaient trop mal préparés pour tenir en même temps cette ville ouverte et Paris».
36 Le 16ème arrondissement était le quartier le moins peuplé de Paris avec 42 187 habitants, et le 11ème le plus peuplé avec 149 641.
37 Auteur du chant prolétarien “L’Internationale”, qu’il écrivit après le Commune; il soutint les jacobins.
38 Pour Engels (Introduction de 1891 à “La guerre civile...”), la Commune se composait d’une majorité de blanquistes et d’une minorité d’internationalistes, pour la plupart socialistes proudhoniens.
39 Jules Vallès, journaliste, écrivain, admirateur de Proudhon, membre de l’AIT; animateur et fondateur le 22-2-71 du journal “Le cri du peuple”, organe d’information du peuple parisien où s’exprimaient toutes les nuances d’opinion. Il appartint à la tendance minoritaire de la Commune, hostile à toute violence.
40 Edouard Vaillant (1840-1915) fut un militant des premières heures. D’origine bourgeoise, ingénieur et médecin, il adhéra à l’AIT en 1867, et rejoignit Paris dès la déclaration de guerre franco-allemande. Durant le siège il fit connaissance avec Auguste Blanqui. Il sera de toutes les luttes: il participa au CC des 20 arrondissements, au CC de la Garde Nationale, à la rédaction de l’Affiche Rouge qui appelle à la formation d’une Commune à Paris. Le 26 mars, il est élu dans le 20ème arrondissement. Après mai, il s’enfuit à Londres où il entre au secrétariat de l’Internationale, mais il s’en sépare dès 1872 pour se rapprocher des milieux blanquistes. En 1905, il participera à la fondation de la SFIO, mais se ralliera à l’Union sacrée en 1914 après la mort de Jaurès. Il mourra en 1915.
41 Les élus de la Commune, les fonctionnaires, les officiers de la Garde nationale sont donc révocables!
42 Almicare Cipriani se battit aux côtés de Garibaldi dès 1860. Il rejoignit Paris à la demande de son ami Flourens en 1870. Nommé chef d’état major pendant la Commune,il fut de tous les combats. Il sera déporté en Nouvelle Calédonie.
43
Pendant
la guerre franco-allemande de 1870-1871, les comités de Défense
nationale,
sous l’impulsion de Gambetta, font appel à Garibaldi. En 1870, il met
son épée au service de la France lors de la guerre franco-allemande.
Les 25 et 26 novembre, avec ses deux fils, Ricciotti et Menotti, à la
tête de 10 000 tirailleurs français de l’armée des Vosges, il remporte
une victoire à Dijon.
En février 1871, Garibaldi est élu, sans
avoir été candidat, à l’Assemblée nationale française comme député
de la Côte-d’Or, de Paris, d’Alger et de Nice. À Paris, il arrive en
quatrième position derrière Louis Blanc, Gambetta et Victor Hugo. Il
décline pourtant ses mandats, blessé par l’accueil de la nouvelle
majorité
monarchiste de la Chambre, ce qui entraîne la démission de Victor Hugo
de son propre mandat en signe de soutien. Le 10 mars, le corps des
volontaires
garibaldiens est dissous. Le 15, il retourne à Caprera. Le 24, les
insurgés
de la Commune de Paris font appel à Garibaldi pour prendre leur tête,
mais le vieil héros décline la proposition.
44 Les gardes nationaux comptaient de nombreux polonais. Dombroski fut nommé commandant de la Place de Paris et fut tué sur les barricades le 23 mai 1871. Walery Wroblewski fut nommé aussi général par la Commune. En avril 71 il obtient le commandement de la cavalerie des Fédérés sur la rive gauche de la Seine. Après l’échec de la Commune, il s’enfuit à Londres où Marx et Engels l’aidèrent financièrement.
45 Léo Frankel fera office de premier ministre du Travail. Membre élu de la Commune et nommé à la Commission du Travail et de l’Échange, il est à l’initiative des premières mesures sociales du mouvement de la Commune, comme la suppression du travail de nuit dans les boulangeries et l’exploitation, par l’association coopérative des ouvriers, des ateliers abandonnés par leurs propriétaires. Intéressé par le sort des femmes, il est en relation avec la jeune russe, correspondante de Marx, Elisabeth Dmitrieff.
46 Louise Michel, institutrice militante rue Saint Vincent sur la colline de Montmartre, participa au comité de vigilance du 18ème arrondissement avecThéo Ferré, et le 18 mars participa à la reprise des canons sur l’emplacement du square Nadar à Montmartre (sur ce lieu fut érigé en 1873 le Sacré Coeur!). Elle fut déportée en Nouvelle Calédonie comme Nathalie Lemel.
47 Elisabeth Dmitrieff, émigrée russe, adhéra à la section russe de l’AIT à Genève et rallia la tendance marxiste. Elle rencontra Marx à Londres en 1870 et partit au début 1871 pour Paris chargée d’une mission d’information. Après la semaine sanglante, elle s’enfuit en Russie où elle fut déportée.
48 De son vrai nom Victorine Leodile Bera, (1824-1900), Leo André (du nom de ses deux fils) est une romancière et journaliste issue d’une famille bourgeoise. Elle milita au sein du mouvement ouvrier international et laissa de nombreux ouvrages féministes.
49 Le
comité
de vigilance des citoyennes du 18 ème arrondissement, présidé par une
couturière Sophie Doctrinal, se distingua par sa grande activité et
combativité.
Le comité avait été créé par Clémenceau après le 4 septembre 70.
Louise Michel et Anna Jaclard (jeune russe mariée à Victor Jaclard,
membre
de l’Internationale et colonel de la 17 ème légion fédérée) en
faisaient
partie.
50 “Les
mains de Jeanne Marie” écrit en 1871 est un hymne de Rimbaud à la
gloire
des femmes de la Commune. Elles sont une réincarnation moderne des
sorcières
du Moyen âge: brutales et douces, terribles et désirées.
Ce sont des ployeuses d’échines,Rimbaud écrivit d’autres poémes en mai 1971: “Chant de guerre parisien”, “L’orgie parisienne ou Paris se repeuple” et “Le coeur volé”:
Des mains qui ne font jamais mal,
Plus fatales que des machines,
Plus fortes que tout un cheval!Remuant comme des fournaises,
Et secouant tous ses frissons,
Leur chair chante des Marseillaises
Et jamais les Eleisons!Ça serrerait vos cous, ô femmes
Mauvaises, ça broierait vos mains,
Femmes nobles, vos mains infâmes
Pleines de blancs et de carmins.
...
Mon triste coeur bave à la poupe,51 Jean Baptiste Clément dédia le dernier couplet de sa chanson “Le temps des cerises” à Louise Michel:
Mon coeur couvert de caporal:
...Quand ils auront tari leurs chiques,
Comment agir, ô coeur volé?
Ce seront des hoquets bachiques:
Quand ils auront tari leurs chiques:
J’aurai des sursauts stomachiques,
Moi, si mon coeur est ravalé:
Quand ils auront tari leurs chiques,
Comment agir, ô coeur volé?
J’aimerais toujours le temps des cerises,52 Ces statistiques sont fournies par G.Duby (“Encyclopédie d’histoire”, chapitre sur la Commune de 1871).
c’est de ce temps-là que je garde au coeur
une plaie ouverte!
Et dame fortune en m’étant offerte,
ne pourra jamais calmer ma douleur.
53 Marx, dans une lettre à Beesly du 19 octobre 1870 écrit à ce propos: «Pour ce qui est de Cluseret, il se comporta en fou et en lâche» (“La Commune”, 10/18, p.108).
54 Revue “La Commune”, n.1 de 1975 où le colonel Rol Tanguy écrit l’article intitulé: “Les aspects militaires de la Commune”.
55 Les fuyards versaillais, les francs-fileurs, comme Marx les appelait, revenus en foule, avaient réoccupés Paris et festoyaient bruyamment dans les restaurants, les cabarets, rouverts, au milieu des combats furieux et des massacres.
56 Théophile Ferré (1846-1871) était un militant blanquiste qui collabore en septembre 1870 au journal de Blanqui “La Patrie en danger”. Il sera délégué au CC républicain des 20 arrondissements, dirigera la défense des canons du 18ème arrondissement, sera élu le 26 mars pour cet arrondissement, siégera à la commission de la Sûreté générale, votera pour la création du Comité de Salut Public, et le 24 mai donnera son consentement pour l’exécution des otages. Il sera condamné le 2 septembre 1871 et exécuté à Satory le 28 novembre avec Louis Rossel.
57 Cf “Le Peuple français”, nouvelle série: n.2-1978: “L’Isère en 1870-71”; n.5-1979: “La Ligue du Midi de 1870”; n.8 1979-80: “La Commune de 1871 à Marseille”.
58 Cf “Le Peuple Français”, n.3 -1978: “L’oeuvre sociales de la Commune”.
59 Le parti de l’Ordre avait remporté la majorité aux élections législatives de mai 1849. Il était composé de monarchistes légitimistes et surtout d’orléanistes et il avait soutenu la candidature de Napoléon III pour l’élection présidentielle de 1848. Sous la deuxième République (1848-1851), les personnalités dominantes de ce parti sont Adolphe Thiers, le comte de Montalembert, Alexis de Tocqueville.
60 Surnom satyrique donné à Napoléon III.
61 Dans sa lettre au Comité de Brunswick de septembre 7O, Marx prévoyait que l’annexion de l’Alsace-Lorraine serait source de conflits continuels entre les deux pays, jetterait la France dans les bras de la Russie, et ferait de cette dernière l’arbitre de l’Europe. Par contre, une paix honorable délivrerait l’Europe de la dictature moscovite.
62 Et non l’inverse comme cela fut le cas!
63 Marx fait allusion à sa conclusion du “18 Brumaire...”.
64 L’Alsace Lorraine
65 Marx fait allusion à celle du 10 aout 1792.
66 La guerre de 1914-18!
67 Paul Lafargue (1842-1911), marié à Laura Marx, est membre du Conseil Général de l’Internationale où il représente l’Espagne. Il rentre en France en 1870 et rejoint Bordeaux où son père, malade, lui demande de venir. Il participera aux mouvements de Bordeaux et partira pour Paris du 7 au 18 avril 71 comme délégué de Bordeaux. Il s’enfuira en Espagne le 4 août.
68 Dès le 5 septembre, il y eut de puissantes manifestations soutenues par les syndicats à Londres, Birmingham, Newcastle pour soutenir la République française. Mais ce n’est qu’après la formation du gouvernement contre-révolutionnaire de Thiers en février 71 que le gouvernement anglais reconnut la République française.
69 Lors de la signature à Francfort du traité de paix le 10 mai 1871, Bismarck et Favre conclurent un accord secret prévoyant une collaboration franco-prussienne contre la Commune. L’accord établissait que les troupes versaillaises seraient autorisées à traverser les lignes allemandes “en vue de rétablir l’ordre à Paris”, à restreindre l’approvisionnement de Paris en vivres, et à imposer par le truchement du commandement allemand le désarmement des fortifications que la Commune tenait autour de Paris.
70 Félix Pyat (1810-1883), est journaliste, avocat et écrivain dramaturge. Il participe à la révolution de 1848, adhère à l’AIT en 1864, s’exhile en Angleterre, revient en France après le 4 septembre 1870. Il est élu le 26 mars 71 au Conseil de la Commune, fiat partie de la Commission exécutive, de la commission des Finances, du Comité de Salut Public. Il part à Londres avant la semaine sanglante. Marx lui reprocha ses “effets de théâtre” et se heurta à luis dans l’AIT (cf Lettre de Marx à Kugelmann du 5 decembre1868).
Jean François Paschal Grousset (1844-1909), originaire de Corse, est journaliste. Rédacteur en chef du journal d’Henri Rochefort “La Marseillaise”. S’estimant diffamé dans un article signé de Pierre Napoléon Bonaparte, cousin de Napoléon III, Grousset lui envoie ses collaborateurs dont Victoir Noir pour convenir d’une réparation par les armes, et qui se terminal mal! Le 26 mars 1871, il est élu membre de la Commune par le 18 ème arrondissement, délégué aux Relations extérieures et membre de la Commission exécutive, partisan du Comité de Salut Public. Déporté en Nouvelle Calédonie, il s’en échappa en 1874 avec Henri Rochefort et se réfugia en Angleterre jusqu’à l’amnistie de 1880.
Pierre Vésinier (1830-1902) est un journaliste qui adhère à l’AIT en 1864. Il participe à l’insurrection du 31-10-70, est élu au Conseil de la Commune par le 1er arrondissement, est directeur du Journal Officiel, et vote pour la création du Comité de Salut public. Il se réfugie à Londres après la Commune.
71 Dr Ludwig Kugelman (1830-1902) est un ami de Marx avec qui il échangea des lettres de 1862 à 1875. Membre de l’AIT, il fut membre du parti social démocrate allemand (SPD).
72 Sous
le
Second Empire le mouvement des réunions publiques à Paris s’était
énormément
développé. On compte ainsi 1000 réunions publiques de juin 1868 à mai
1870 à Paris, dans de très nombreuses salles, où les thèmes les plus
courants étaient la critique contre la bourgeoisie, le bonapartisme,
etc...
La Commune de Paris fut ainsi préparée par ce mouvement des réunions
publiques et par des grèves, émeutes de 1869 et 1870 qui débouchèrent
sur les procès de l’AIT et de Blois.
Ce sont déjà des clubs rouges dont les
plus célèbres resteront sous la Commune surtout ceux des quartiers
prolétariens
de Montmartre, Belleville et du centre: les clubs de l’Ecole de
médecine,
Favié à Belleville, de la salle Valentino rue saint Honoré, de la
République
rue Cadet, de la Reine Blanche à Montmartre qui deviendra le Moulin
rouge
en 1889, de la Marseillaise rue d’Arras, de l’Elysée Montmartre, etc...
73 Plus loin, Trotsky cite Marx au sujet de la question des otages: «Quand Thiers, comme nous l’avons vu, dès le début du conflit, établit la pratique si humaine d’abattre les communards prisonniers, la Commune,pour protéger leur vie, n’eut plus d’autre ressource que de recourir à la pratique des Prussiens de prendre des otages. (..) Comment leur vie eût-elle pu être épargnée plus longtemps, après le carnage par lequel les prétoriens de Mac Mahon avaient célébré leur entrée dans Paris?».
74 Marx écrira plus loin p.126: «Ce n’est que sous le second Bonaparte que l’État semble être devenu complètement indépendant. La machine d’État s’est si bien renforcée en face de la société bourgeoise qu’il lui suffit d’avoir à sa tête le chef de la société du 10 décembre».
75 “Le Manifeste” de 1848 affirme: «L’État, c’est-à-dire le prolétariat organisé en classe dominante». Dans leur préface au “Manifeste” de 1872, Marx et Engels précisent que ce dernier n’est pas à la page sur ce point, celui de l’État: «La Commune, notamment, a fourni la preuve que la classe ouvrière ne peut pas simplement prendre possession du mécanisme politique existant et le mettre en marche pour la réalisation de ses propres buts».
76 Cf “Volkstaat” du 26-6-1874, article publié dans le recueil intitulé “Le mouvement ouvrier français” édition Maspéro, tome 2 p.72.
77 Le général marquis de Gallifet (1830-1909), prisonnier à Sedan, retourne en France pour commander la brigade de cavalerie de l’armée de Versailles. Lors des représailles contre les communards, sa férocité le fit surnommé “marquis aux talons rouges”!
78 Adresse de la Banque de France à Paris.
79 Il s’agit de la préface du livre de Talès: “La Commune de 1871”, préface republiée en français par Maspéro, en classique rouge n.8 (1971) et en italien dans notre presse d’alors, “Il Programma Comunista”, n.6, 1971.
80 Plus loin, faisant la comparaison avec la révolution de 1917, Trotsky dira qu’à Paris les chefs étaient à la queue des évènements, les enregistrant quand ces derniers s’étaient déjà accomplis, alors qu’à Pétrograd le parti alla fermement à la prise du pouvoir.
81 Marx,
premier
essai à “La guerre civile...”, (p.207) écrit: «Si la Commune
avait remporté la victoire au début de novembre 1870 (...) elle aurait
sûrement trouvé un écho et se serait étendue à toute la France (...)
Elle serait devenue la guerre de la France républicaine hissant
l’étendard
de la Révolution sociale du XIX ème siècle, contre la Prusse,
porte-drapeau
de la conquête et de la contre-révolution».
Comme dans le numéro précédent, nous donnons un bref compte-rendu
de nos dernières réunions générales.
Ces rencontres fréquentes, indifférentes à l’ambiance extérieure
peu réceptive aux positions révolutionnaires, que nous tenons
régulièrement
tous les quatre mois environ, selon un rythme et avec une méthode que
nous pouvons considérer comme très expérimentés et donnant de bons
résultats, et ce malgré le nombre réduit des participants, ces
rencontres
donc, ont la prétention de représenter un type de travail collectif
communiste.
Par cette formule, nous n’entendons pas un fait esthétique ou
abstraitement
moral, dans le sens où le parti serait formé d’individus qui se
considéreraient
comme des apôtres ayant hérité d’une vocation particulière et de
volonté; nous ne considérons pas non plus notre façon communiste de
faire comme une reproduction tout autant volontariste, entre les quatre
murs de nos locaux, du futur universel de l’humanité, comme une
expérience
réservée à quelques «conscients». Les façons de travailler du parti
ne découlent d’aucune règle absolue, même pas de type rationnel,
égalitariste
ou humanitaire, comme le prétend – sans jamais réussir à y parvenir
– l’hypocrite société bourgeoise.
Notre méthode de travail se caractérise simplement par le dépassement historique des limites idéales du monde bourgeois, dans sa négation, joyeuse et sans regret. Le pilier sur lequel s’appuie la société bourgeoise est le mercantilisme, et son reflet dans le culte réactionnaire de la Personne. C’est là la première entrave à l’évolution historique, que la doctrine prolétarienne abat et qui peut être dépassé dans le parti qui n’est pas, dans la conscience qu’il a de lui, parti d’idées, mais parti de classe.
Toutes les contradictions irrémédiables couvant dans la société de l’argent, qui s’expriment dans la guerre des intérêts opposés et qui figent sa vie et sa pensée dans l’opposition éternelle Bien-Mal, Liberté-Nécessité, Démocratie-Autorité, Majorité-Minorité, Gouvernement-Opposition, sont finalement dépassables – et les preuves historiques en sont nombreuses – même dans les organisations immédiates de lutte prolétarienne, dans les moments brefs mais déterminants d’affrontements violents avec l’ennemi de classe, et, toujours, dans le parti.
Notre parti, donc, sur l’exemple plus que séculaire de la Commune parisienne insurgée, qui n’était pas marxiste, se définit organe de travail et non de débat, en ce sens que le poids des opinions individuels est nul: le parti justifie sa fonction de la revendication d‘un programme et d’une tradition de guerre sociale unique et interprétable d’une seule façon, de la même manière que les intérêts de la classe qu’il représente sont tendanciellement convergents. L’ambiance du parti est complètement nouvelle par rapport au monde bourgeois; l’adhésion du militant ne lui confère pas un atome de conscience de plus, mais, beaucoup plus simplement, lui apporte une énergie et une capacité de travail en plus à insérer dans un projet déjà existant, dont les lignes sont définies et définitives; les nouvelles forces qui viendront adhérer à ce plan collectif le feront s’accélérer, mais ne pourront en modifier la trajectoire. Le militant met à la disposition du parti son travail gratuit, et non pas ses points de vue personnels. C’est par cette méthode de recherche et d’intervention, qui est vraiment scientifique car impersonnelle et désintéressée, que le parti réussit avec le coefficient de rendement maximum dans le travail apparemment difficile de liaison des éléments doctrinaux et programmatiques avec les évènements changeants de la lutte de classe contingente.
C’est encore selon cette méthode que nous constatons l’avancement de notre travail, non par le «niveau du débat» comme il est d’usage chez toutes sortes d’intellectuels, mais par l’exposition – même par un seul camarade – des résultats du travail collectif de parti, en comprenant par là tant l’activité de propagande et demain d’agitation que l’étude de notre passé et de notre science. Les rapports exposés ne sont ni discutés ni critiqués, car nous savons qu’ils sont un résultat de toute façon imparfait du travail d’une organisation dont l’extension de ses forces est indépendante de sa volonté, et parce que le réseau de camarades du parti est toujours tenu à l’améliorer, à le préciser de manière plus rigoureuse pour relier au corps des principes la masse des faits de l’aujourd’hui si peu enthousiasmant au jour le jour.
Ci-dessous un bref résumé du contenu des rapports exposés lors des
deux dernières réunions.
Sept exposés se sont succédés.
Comme d’habitude, le premier rapport présentait les tableaux statistiques régulièrement mis à jour sur le cours de l’économie mondiale à travers 7 principaux pays: USA, URSS, Japon, RFA, Grande Bretagne, France, Italie, confirmant la profondeur de la crise traversée. Ensuite un tableau mettait en lumière la croissance énorme de l’interpénétration des trois blocs USA, Japon, CEE. Les pays européens sont les plus dépendants (notamment la RFA et l’Italie), confirmant leur «maturité» économique internationale, et donc révolutionnaire.
Le rapporteur suivant, prenant prétexte des résultats avoués comme étant nuls de la récente conférence sur la population (Mexico), opposait le schéma marxiste du problème, en termes de modes de production: il ne s’agit pas d’adapter le nombre des consommateurs aux marchandises consommables, mais aux dimensions du capital. S’appuyant sur le chapitre 23 du premier livre du Capital, le rapporteur démontrait le caractère insoluble de la question pour le capitalisme qui se débat entre le besoin croissant de prolétaires et l’impossibilité de les nourrir à travers l’alchimie de la distribution mercantile.
Le rapport suivant sur l’Histoire de la Gauche s’est centré sur le Vème Congrès de l’Internationale Communiste, soi-disant «tournant à gauche», en fait simple et autre oscillation tactique, en attendant la suivante. Ce fut le congrès de la victoire de l’appareil étatique russe, pour qui la force des partis communistes ne résidait plus dans la tactique correcte découlant des principes, mais dans leur structure (généralisation des cellules d’entreprise). La «bolchévisation» ne visait pas au succès révolutionnaire, c’est au contraire l’impossibilité du succès qui la justifia.
Enfin, fut exposée l’étude sur la critique marxiste de la
théorie
de la connaissance, qui débuta par un index commenté résumant le
contenu des travaux parus dans la presse du parti sur la question.
Partant
de l’exemple du fait physique du plus grand et du plus petit, le
rapporteur
a montré les phases de l’évolution historique de sa représentation
dans la conscience sociale: de la notion claire de la philosophie
grecque
à l’approche mystico-religieuse qui interdit d’en parler, des
intuitions
infinitésimales des penseurs de la Renaissance et de la Réforme aux
solutions
actuelles des problèmes représentatifs grâce au calcul différentiel,
au-delà duquel la bourgeoisie corrompue ne peut se hisser et en est
même
à reculer.
Le matin, ont été exposés deux rapports sur le thème de la tactique
communiste face à la guerre, dans la suite des réunions passées.
Le premier étudiait la période 1870-1905, de la Commune de Paris
à la flambée révolutionnaire de la Russie tsariste, évènements liés
à des guerres entre États (franco-prussienne et russo-japonaise).
Partant
du tournant historique de 1871, qui met un point final au soutien du
prolétariat
à la formation historique progressive des États nationaux en Europe de
l’Ouest (voir ce numéro de la revue), l’auteur rappela les évènements
de la période pour aboutir au programme du courant bolchévique en 1905.
Le second rappelait la perspective de reprise révolutionnaire énoncée déjà plusieurs fois par le parti: reconstruction – crise économique mondiale- renaissance du parti communiste et resurgissement de la lutte et des organisations de classe-guerre ou révolution – en tentant d’approfondir les liens entre chaque pôle, à l’aide de nombreuses citations, surtout d’Engels et de Lénine, et enfin de la Gauche, pour conclure sur le bilan, de manière complexe, négatif de l’influence de la guerre impérialiste sur la lutte révolutionnaire de classe.
L’après-midi, le dernier rapport poursuivait l’étude, déjà présentée
à la réunion de janvier 84, sur la formation des États nationaux en
Amérique latine: les rapports économiques liant l’Espagne, les
capitalismes
européens naissants et les colonies d’outre Atlantique (et l’Afrique)
l’évolution de la forme de propriété et de location agraire (de
l’encomienda
à l’hacienda), la formation dans les colonies de classes économiquement
homogènes de propriétaires fonciers créoles qui, d’en haut, arrivèrent
à l’indépendance nationale formelle et à la constitution d’États.
Ceux-ci sont aux mains de deux classes, propriétaires fonciers et
bourgeoisie
commerciale et industrielle: c’est dans l’affrontement entre ces deux
classes que se trouve la clé des évènements tourmentés de ces pays,
classes dépendantes de l’impérialisme, anglais d’abord, des USA
ensuite,
terrorisées par la puissance des révoltes des classes petites
bourgeoises
misérables des paysans pauvres et sans terre et, de plus en plus, par
la présence d’un jeune prolétariat industriel.
A partir d’un tableau reportant les valeurs annuelles, de 1970 à 1984, de grandeurs significatives pour trois pays (USA, RFA, Italie), le premier exposé a pu donner une vue d’ensemble des 15 dernières années de crise, grave en 1975 et les 4 dernières années. Point commun aux trois pays: l’oscillation continuelle des productions, avec de grands écarts entre les minima et les reprises.
A la suite de la réunion de septembre, sur le thème communisme et guerre, le 2ème rapport embrassait l’arc de temps allant de 1905 à 1915, s’attardant longuement sur l’action des bolchéviques et de Lénine en reparcourant le fil des évènements tragiques et glorieux qui virent l’écroulement de la puissante IIème Internationale et les premières réactions classistes à la trahison social-démocrate (Zimmerwald). De la répression qui suivit 1905 à la reprise et l’extension des grèves de 1911 à 1914 en Russie, le parti bolchévique se fixa pour objectif, en l’absence de partis démocratiques bourgeois, de conduire lui-même l’assaut contre la forteresse féodale aristocratique, avec, pour seul allié de la classe ouvrière, le paysan. Où était le socialisme dans tout cela? Dans la liaison avec la révolution socialiste internationale! Mais l’occident ne répondit pas aux révolutionnaires russes, faisant triompher l’Union sacrée. Les bolchéviques réaffirmèrent les mots d’ordre: caractère impérialiste de la guerre, pour toutes les parties; guerre à la guerre; défaitisme et fraternisation; transformation de la guerre impérialiste en guerre civile, mots d’ordre qui avaient le mérite de combattre les trahisons des chefs sociaux-démocrates passés à l’ennemi de classe.
Le troisième rapport poursuivait l’exposé sur le thème de la théorie de la connaissance en donnant une présentation synthétique de l’ensemble du travail théorique sur la question, tel qu’il parut dans la presse du parti à partir du milieu des années 50, depuis les formes de science ayant précédées le rationalisme jusqu’à la description du communisme vivant aujourd’hui dans le parti non comme intelligence du demain, mais plutôt comme sa puissante intuition.
La question de la stratégie diplomatico-militaire de l’impérialisme a ensuite été réétudiée, afin d’analyser les tendances générales de la politique des plus grands États impérialistes, dans le cadre de l’étude générale du capitalisme que notre parti s’impose afin de toujours mieux connaître l’ennemi à combattre et à abattre. La suprématie du géant américain, puissance maritime, sur le russe, puissance terrestre, est toujours indiscutable, bien qu’il faille suivre attentivement la RFA et le Japon qui semblent se confirmer de nouveau comme “pays-clés” dans le prochain déchaînement de la nouvelle crise belliciste.
Sur l’Histoire de la Gauche, fut décrite l’attitude des camarades de la Gauche du Parti Communiste d’Italie face aux évènements de l’Aventin, suite au meurtre de Matteotti. Ma crise de l’Aventin fut jugée alors par la Gauche comme le primer essai (réussi) de cet antifascisme qui sera le pire produit du phénomène mussolinien; la Gauche dénonça nettement la très grave erreur commise par tous ceux qui adhérèrent aux oppositions, au front unique de toutes les gauches dans la défense de la démocratie, dans la conciliation… contre le prolétariat.
Enfin, une camarade parisienne reprenait le rapport sur l’histoire du mouvement ouvrier en France, de 1871 à la fin du siècle. Après la répression sanglante de la Commune et une certaine reprise économique capitaliste, naquit en 1882 le Parti Ouvrier Français, formé de membres de l’émigration qui avaient pris contact avec Marx en Angleterre. La gauche marxiste du parti dirige la Fédération nationale des chambres syndicales, alors que se déroule le débat sur la grève générale, repoussée dans sa formulation absolue par les marxistes. La fusion avec les Bourses du travail a lieu en 1893 et donne l’occasion aux réformistes d’éloigner les communistes de la direction du mouvement syndical.